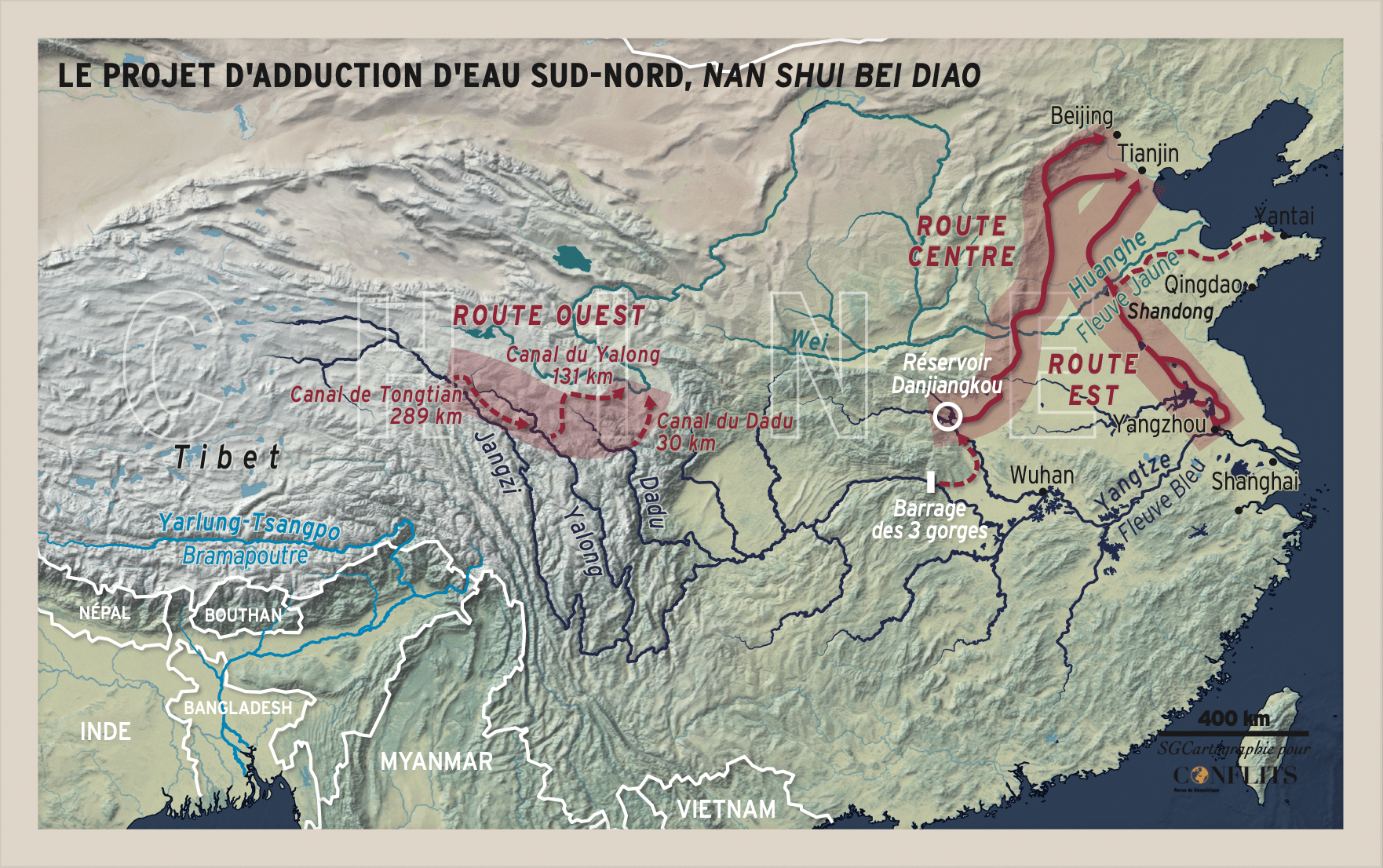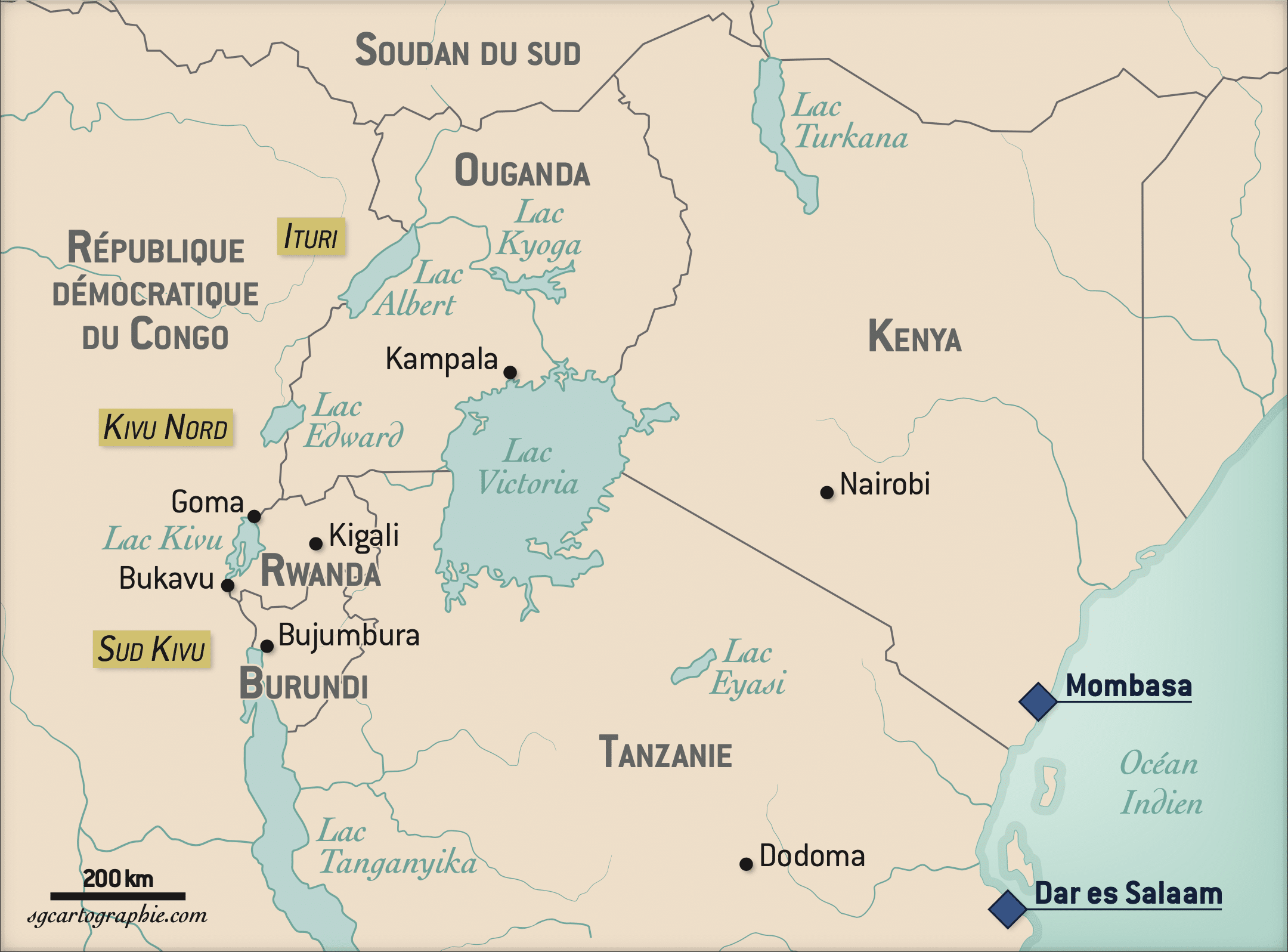Pétrole et gaz naturel constituent encore plus de la moitié de la consommation énergétique mondiale, malgré les exigences de la « transition » énergétique et écologique. La production de pétrole est aujourd’hui moins rapide que celle de gaz qui est une énergie pleine d’avenir.
La question de l’après-pétrole s’est posée depuis les années 1970, mais n’est pas encore advenue, comme on l’a vu précédemment. La raison principale est qu’il demeure essentiel dans le secteur des transports, où il couvre 90 % des besoins en carburants. Plus largement, étant liquide, il est plus facile à produire, à transporter et à utiliser : c’est le premier produit échangé au monde, pour un montant d’environ 3 000 milliards de dollars annuels.
Le pétrole toujours roi
La production mondiale de pétrole a augmenté d’un milliard de tonnes au milieu des années 1970 à près de quatre milliards de tonnes au milieu des années 2000, et ce malgré une tendance lourde au relèvement des prix. La croissance a été freinée par la crise financière de 2008, puis elle est repartie à la hausse et environ 4,5 milliards de tonnes sont produites annuellement aujourd’hui.
La capacité de raffinage mondiale est d’environ 90 millions de barils par jour. 84 millions de barils sont consommés chaque jour. L’« intoxication pétrolière » demeure une réalité.
À lire aussi : Angola : rien sans le pétrole
Les réserves prouvées ont beaucoup augmenté depuis les années 1970, s’établissant à 250 milliards de tonnes, soit approximativement 1 700 milliards de barils. Cela correspond à plus de 50 ans de consommation, soit davantage que dans les années 1970. La théorie du Peak Oil a ainsi été démentie, au moins pour l’instant.
Production concentrée, consommation éclatée
En termes de production, le Moyen-Orient détient environ 50 % des réserves pétrolières prouvées et produit un tiers du pétrole mondial. L’Arabie Saoudite a été détrônée récemment par les États-Unis comme premier producteur mondial, devant la Russie. La Russie présente des réserves prouvées de l’ordre de 6 % du total mondial, mais il est difficile de les évaluer précisément, car il s’agit d’un « secret d’État » en vertu d’un décret présidentiel récent. L’Amérique latine est désormais la deuxième zone au monde pour les réserves avec 20 % des réserves mondiales prouvées, auxquelles il faut ajouter les découvertes récentes au large du Brésil : PeMex, PDVSA et Petrobras se classent parmi les 10 premières entreprises pétrolières mondiales. L’Afrique vient après avec les gisements d’Afrique de l’Ouest et du golfe de Guinée (7,5 %), mais les découvertes vont bon train (Mozambique). Dans cet ensemble, les pays de l’OPEP représentent 72 % des réserves.
En termes de demande, le pétrole est un produit universellement consommé et les plus gros importateurs sont les pays les plus développés et industrialisés : OCDE et pays émergents. Mais un changement historique est en train de se produire : les États-Unis étaient les plus gros importateurs de pétrole depuis les années 1945-1950, une dépendance assumée car ils sécurisaient leurs approvisionnements ; mais, avec la révolution des pétroles et gaz de schiste, ils sont en passe de devenir autosuffisants et laissent à la Chine le rang de premier importateur, du fait de sa forte croissance et d’une efficacité énergétique encore insuffisante : pour produire 1 000 dollars de PNB, la Chine consomme un baril et demi, soit le double de la moyenne mondiale. Derrière elle pointent les pays d’Europe, le Japon et les autres pays émergents.
La répartition de la capacité de raffinage mondiale donne une idée de cette géographie de la consommation, elle s’établit grossièrement comme suit : 30 % pour l’Europe et la Russie, 26 % pour l’Asie-Pacifique, 24 % pour l’Amérique du Nord.
Le gaz, une énergie en plein développement
Le gaz est une énergie de plus en plus utilisée qui constitue une solution alternative au pétrole. Ses usages sont variés : production d’électricité, chauffage domestique et industriel, fabrication d’engrais, transports, sous forme de butane, gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié (GNL). Il peut ainsi apparaître comme une solution alternative au pétrole. Le gaz naturel partage la même nature chimique que le pétrole, combinant des molécules de carbone et d’hydrogène issus de la décomposition des matières organiques de type plancton dans des formations géologiques sédimentaires. Les méthodes pour découvrir gaz et pétrole sont donc les mêmes : exploration des bassins sédimentaires (on-shore ou off-shore), travaux sismiques et de prospection, enfin forage parfois à des milliers de mètres, ce qui constitue un coût très élevé sans assurance du résultat. Parfois on découvre des gisements de gaz, parfois de pétrole, parfois des deux. Les coûts d’exploration et de production sont donc à peu près équivalents. Mais c’est une énergie plus « propre » que le pétrole et a fortiori le charbon : pour la même quantité d’électricité produite, le charbon émet deux fois plus de CO2 et le pétrole 50 % de plus. Sa combustion rejette surtout du gaz carbonique et de l’eau : à énergie dégagée équivalente, l’utilisation du gaz naturel permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit ainsi d’un « pont vers le futur » selon une formule de l’AIE dans un rapport de 2012 sur l’énergie mondiale, un outil de la transition vers une énergie moins carbonée.
Le gaz a connu un développement plus tardif que le pétrole, mais aujourd’hui plus rapide. Les premières exploitations à grande échelle démarrent dans les années 1930 aux États-Unis, mais c’est surtout à partir des années 1950 que son utilisation se développe sous l’effet de progrès dans les transports terrestres (gazoducs de larges diamètres) et maritimes avec la mise au point de chaînes d’approvisionnement (usines de liquéfaction, navires méthaniers, usines de regazéification), alors que les coûts d’extraction sont intéressants. Avec le renchérissement considérable du pétrole à partir des années 1970, le gaz devient plus compétitif et connaît une forte croissance, si l’on excepte de légères baisses en 1982 et au début des années 1990 en raison des difficultés de l’ex-URSS, passant d’un peu plus de 1 milliard de m3 en 1970 à 3 milliards de m3 quatre décennies plus tard. Le gaz est ainsi devenu la troisième source d’énergie au monde avec 22 % du bilan énergétique mondial.
À lire aussi : Les grands marchés de l’énergie aujourd’hui et demain
Un marché mondial est même en train de se constituer grâce aux progrès des transports et à la baisse concomitante de leurs coûts, là où les marchés ont été longtemps essentiellement régionaux. Le transport du gaz par méthanier se développe rapidement (+ 6 % par an) et il représente désormais plus de 25 % des échanges mondiaux de gaz. Cependant, pour les ¾, il s’agit encore de transport terrestre. Le plus grand pipeline de gaz du monde transporte le gaz russe de l’océan Arctique à la frontière tchèque sur 4 450 km (avec un diamètre de 1,42 m).
Entre pétrole et gaz, on assiste ainsi à une sorte de « transition dans la transition ». Un argument supplémentaire est que pour extraire les pétroles non conventionnels on a besoin de beaucoup de gaz, au moment de l’extraction des huiles, puis au moment du raffinage. D’ici à 2040, selon les statistiques de BP, la hausse de la demande en pétrole devrait être très ralentie, tandis que celle de gaz aura augmenté de 45 %. Le gaz devrait alors constituer 25 % de l’énergie consommée dans le monde. Certains pays investissent massivement dans cette technologie, à l’image de l’Australie qui envisage de devenir bientôt le premier fournisseur mondial de GNL pour répondre à l’immense demande du marché chinois.
Les réserves mondiales de gaz sont gigantesques. Elles sont estimées entre soixante et soixante-dix ans pour les réserves conventionnelles, soit davantage que le pétrole. Sans compter les réserves non conventionnelles, comme le gaz de schiste aux États-Unis : ceux-ci réalisent aujourd’hui environ la moitié de la production mondiale de gaz de schiste, dans le cadre de milliers d’entreprises (la législation américaine fait que la propriété du sous-sol est privée), avec des prix très bas : environ 20 dollars pour un volume équivalent à un baril de pétrole. Certains spécialistes évoquent 200 ans d’exploitation, car beaucoup de champs gaziers restent à découvrir, mais ces chiffres doivent être pris avec beaucoup de précautions.
Comme pour le pétrole, les réserves ont été beaucoup réévaluées depuis 1973 : on annonçait alors un peu moins de 45 ans de réserves. Encore plus que pour le pétrole, les ressources non conventionnelles suscitent de grands espoirs chez les géologues, mais il faut rappeler que certaines sont très difficiles et chères à exploiter, comme l’hydrate de méthane qui correspond à des molécules de gaz piégées par la glace (notamment en Sibérie, en Alaska, dans la mer d’Okhotsk ou la mer Caspienne…).
La géographie du gaz est comparable à celle du pétrole
À la différence près que la consommation est plus concentrée dans les principaux pays producteurs et dans les « pays avancés ». On retrouve une forte concentration géographique des zones de production. Le Moyen-Orient c’est 40 % des réserves, dont 15 % pour l’Iran, à peu près autant pour le Qatar, mais nettement moins pour l’Arabie Saoudite avec 4 %. Bien que doté d’immenses réserves, le Moyen-Orient ne fournit qu’une faible quantité de gaz, avec une production qui toutefois augmente régulièrement : Iran, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite.
La Russie en revanche est un acteur majeur des marchés gaziers avec près de 20 % des réserves mondiales (juste avant l’Iran et le Qatar) et occupe le rang de premier exportateur avec un quart du total, suivi du Qatar, de la Norvège, du Canada et de l’Algérie. Les États-Unis ont réussi quant à eux une percée exceptionnelle depuis quelques années avec leur gaz de schiste. En Europe, Pays-Bas (Groningue) et Royaume-Uni (mer du Nord) se classent encore parmi les 10 premiers producteurs mondiaux, mais régressent. Il existe parallèlement de petits gisements en Italie, Allemagne et France (le gaz de Lacq qui est pratiquement épuisé).