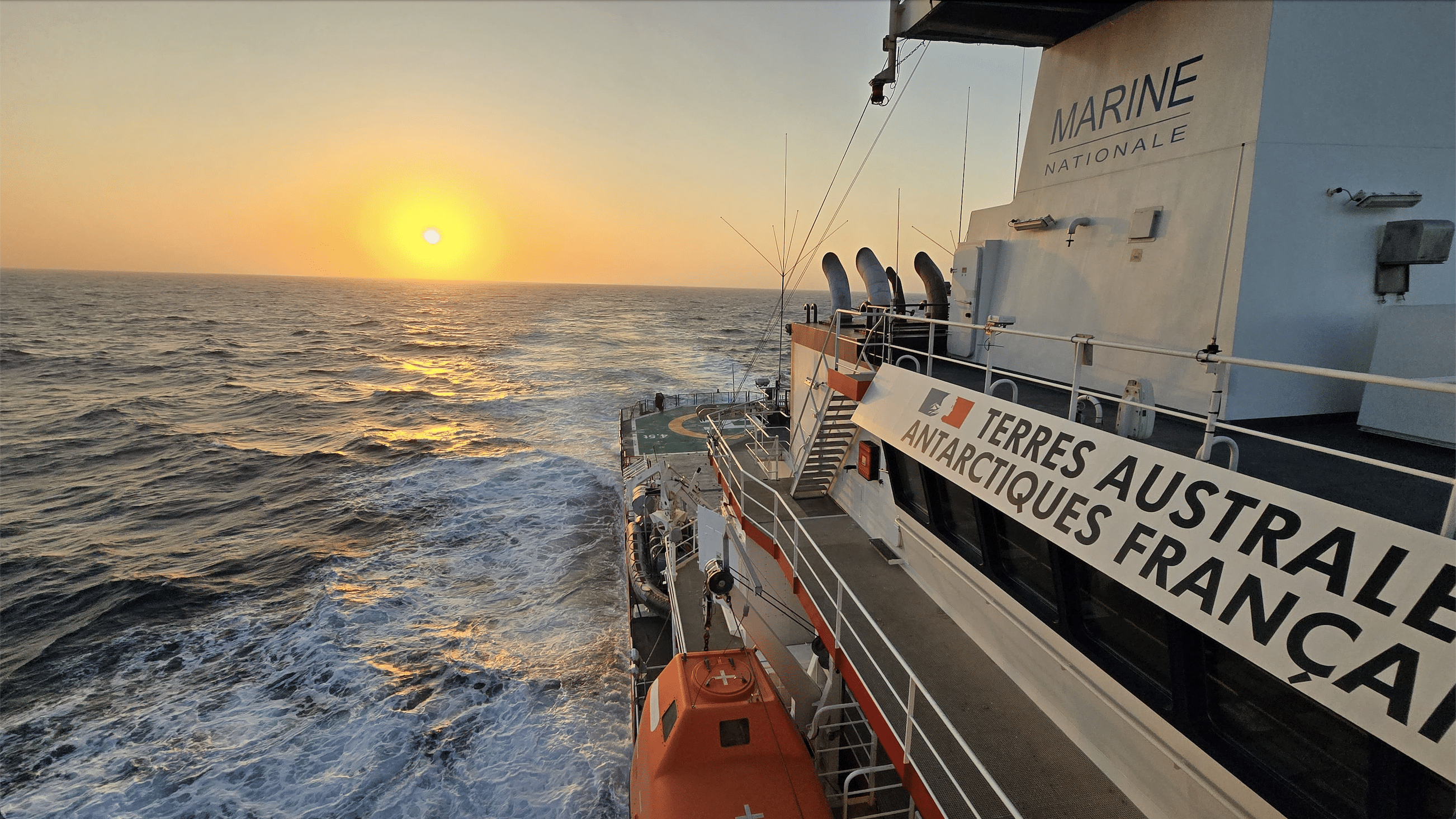Les penseurs de la stratégie navale ont adapté leurs réflexions aux évolutions de la flotte. Après une première partie consacrée à la stratégie navale jusqu’aux temps modernes, analyse des réflexions contemporaines.
Enseigne de vaisseau Marion Soller
À partir de la révolution industrielle du XIXe siècle, les navires s’émancipent du bon vouloir des vents. En à peine plus d’un siècle, la propulsion navale passe de la voile à la vapeur, puis au pétrole et, pour certains depuis les années 1950, au nucléaire. Ce formidable progrès énergétique permet aux bâtiments d’être plus lourds, et les premiers bateaux en métal, les cuirassés, apparaissent dès le milieu du XIXe siècle. L’armement naval bénéficie aussi de nombreuses avancées, et l’on voit se développer obus, mines et torpilles. Durant plusieurs décennies, l’innovation navale se fait ainsi l’arène de la surenchère du canon contre la cuirasse.
La révolution industrielle
Jusqu’au début du XXe siècle, les cuirassés demeurent cependant des navires largement expérimentaux et peu opérationnels. C’est la création du navire britannique HMS Dreadnought qui consacre le cuirassé : l’unité est si réussie qu’elle donne son nom au modèle générique de ces bâtiments, lesquels fleurissent alors dans toutes les grandes marines de l’époque. Ils forment l’épine dorsale des flottes de la première moitié du XXe siècle, et l’augmentation du tonnage voit naître de véritables forteresses flottantes jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, à l’image des cuirassés français Richelieu (43 832 tonnes), allemand Bismarck (45 172 tonnes) ou américain Iowa (52 751 tonnes).
Ces révolutions techniques inspirent un mouvement de pensée prospère en France à la fin du XIXe siècle, baptisé Jeune École. Ses partisans partent du postulat que Paris, devant entretenir une grande armée face à la menace allemande, ne peut financer une marine équivalente à celle de l’Angleterre[1]. Plutôt que de lourds cuirassés destinés aux batailles rangées, il convient au contraire de privilégier la défense du littoral et une forme de guerre au commerce, marquant une continuité historique avec la posture française de guerre de course[2]. Opposés au courant de pensée majoritaire qui favorise alors les unités lourdes, ils considèrent que les armes nouvelles comme la mine ou la torpille rendent caducs les principes stratégiques traditionnels. Pour la Jeune École, le combat naval doit être redéfini autour de navires légers et rapides centrés sur ces armes nouvelles, comme les torpilleurs (pour l’attaque des ports) ou les croiseurs à vapeur (contre les navires de commerce). À l’aube du XXe siècle, le débat stratégique français est ainsi dominé par la question technique, à laquelle s’opposent les tenants d’une vision plutôt mahanienne centrée sur les cuirassés. Cette dernière est notamment défendue par l’École supérieure de la marine, et connaît un regain de crédibilité après la guerre russo-japonaise et la « bataille décisive » de Tsushima en 1905.
À lire également
Colloque « La marine en guerre : 1914-1918 »
Après une « fin de siècle » marquée par plusieurs décennies de paix, les deux guerres mondiales soumettent ces technologies nouvelles à l’épreuve du feu, concomitamment à l’entrée en jeu des deux autres milieux que sont les airs et les fonds marins.
Le sous-marin apparaît sur le champ de bataille pendant la Grande Guerre. S’attaquant aux grandes unités de surface, il incarne une version moderne de la logique asymétrique du faible au fort : grâce à sa discrétion, il peut toucher les navires sans les affronter en bataille rangée. Les sous-marins sont alors principalement dédiés à l’attaque des voies de ravitaillement, renouvelant une sorte de guerre de course des temps modernes. Cela se révèle particulièrement efficace durant les deux Guerres mondiales : en 1940 par exemple, les U-Boat allemands portent des coups conséquents aux forces Alliées, manquant de peu de faire capituler une Angleterre exsangue. Stratégiquement néanmoins, le choix d’attaquer les convois civils s’est plutôt révélé une erreur, la guerre sous-marine à outrance ayant poussé les États-Unis à entrer en guerre en 1917, changeant l’équilibre des forces au détriment de l’Allemagne.
Le second conflit mondial marque aussi le déclin des géants des mers qu’étaient les cuirassés. Cibles de choix pour l’ennemi, ils deviennent au fil du temps extrêmement vulnérables aux attaques aériennes. Les plus grandes unités allemandes – Bismarck – ou japonaises – Yamato – n’eurent en effet qu’une utilité marginale au combat. Elles eurent néanmoins le mérite d’assurer une forme de dissuasion conventionnelle, selon le concept de fleet in being (« flotte en vie » en français) : une flotte, même sans combattre et demeurant au port, fait peser une menace sur les voies de transit locales, fixant les marines adverses à proximité.
La Seconde Guerre mondiale consacre quant à elle la centralité du porte-avions. Ce nouvel élément devient incontournable dans la Bataille du Pacifique, à l’image de la bataille de Midway qui oppose quatre porte-avions japonais à trois porte-avions américains. Pensé initialement pour assurer une bulle de défense aérienne mobile, il se révèle également fort utile au bombardement des littoraux et comme arme antinavire. Il apporte aux flottes une profondeur stratégique inégalée jusqu’alors, démultipliant leur portée en ajoutant le rayon d’action des avions embarqués au déplacement propre du navire. La bataille de la mer de Corail illustre cette nouvelle réalité, étant la première bataille où les navires ennemis s’affrontent sans se voir, par-delà l’horizon.
Les marines post-1945
Après 1945, la guerre froide alimente une course aux armements navals, les deux blocs renforçant leurs flottes et rivalisant en innovations techniques en vue d’un éventuel conflit. Néanmoins, aucune guerre directe n’advient entre les géants américain et soviétique, qui se tiennent à distance par le développement de l’arme atomique ou s’affrontent indirectement lors de conflits périphériques, mais pas sur les mers.
L’âge nucléaire
Le nucléaire change radicalement la donne stratégique. Bien que la notion de « dissuasion » lui soit antérieure, le nucléaire en fait sa spécialité puisqu’il s’agit d’une arme – quasiment toujours – pensée comme une arme de non-emploi, destinée à exclure les conflits ouverts.
Ce bouleversement concerne directement la dimension navale, qui en constitue l’une des trois composantes grâce aux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), aux côtés des bombardiers et missiles terrestres. Ces précieuses unités sont les garantes de la « capacité de seconde frappe » nécessaire à la posture dissuasive : la propulsion nucléaire autorise en outre des patrouilles de plusieurs mois, dont dépend la capacité de riposte. Aujourd’hui, seuls les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l’Inde possèdent des SNLE. Pour les États dotés, la composante nucléaire s’est imposée comme la clef de voûte de leurs marines.
Les opérations de précision à longue portée
En à peine plus d’un siècle, l’armement naval change radicalement de dimension en matière de précision et de portée. Avant l’invention de la tourelle au milieu du XIXe siècle, les canons étaient fixes, donc à direction unique, obligeant les navires à manœuvrer pour viser. Lors de la Première Guerre mondiale, les probabilités des meilleurs canonniers allemands de toucher un navire ennemi dépassaient à peine 3 %. Durant la bataille de Midway, la première vague de bombardiers américains B-17 largue toutes ses bombes sans toucher un seul navire japonais, et la plupart des torpilles utilisées par la suite n’explosent pas.
Quelques années seulement après le second conflit mondial, pourtant, l’apparition des premiers missiles bouleverse la stratégie militaire et particulièrement navale. Adossé aux progrès réalisés en matière de détection et de suivi de cibles (évolution des radars, plus tard apparition de systèmes infrarouges, de désignation de cibles à distance et de soutien électronique), ce vecteur d’une portée, d’une puissance et d’une précision inégalées permet de frapper un ennemi sans le voir. Les premières utilisations de missiles antinavires datent de 1967, avec la destruction de la frégate israélienne Eliath durant la guerre des Six Jours. À partir des années 1980 intervient d’ailleurs une révolution comparable à l’invention des sabords : les lanceurs de missiles ne sont plus inclinés sur le pont des navires, mais disposés en-dessous dans des silos verticaux (VLS pour Vertical Launching System en anglais), ce qui permet d’en augmenter le nombre et de varier plus facilement le type de munitions. Aux anciens navires spécialisés succèdent alors des bâtiments multi-missions, tels que de lourds destroyers, à l’image de la flotte américaine, ou bien de corvettes légères, prisées par les Russes. En 2015, ce dernier type d’unité a par exemple frappé le désert syrien depuis la mer Caspienne, grâce à des missiles de croisière Kalibr tirés depuis des navires de moins de 1 000 tonnes.
Les missiles aéroportés bénéficient aussi de ces améliorations en portée et en précision, conservant au porte-avions sa centralité dans les opérations contemporaines. En 1991, six groupes de porte-avions américains participent à l’opération Tempête du Désert de la guerre du Golfe. Suivant la « théorie des cinq cercles », les navires ciblent les infrastructures stratégiques ennemies par des bombardements, tant grâce aux missiles de croisière Tomahawk que par les attaques de l’aviation embarquée. Ces opérations anéantissent les forces aériennes irakiennes, et l’efficacité de cette courte guerre fit date, inspirant notamment la pensée militaire chinoise contemporaine[3]. La composante navale des interventions occidentales en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en Syrie ou en Irak repose de la même manière largement sur l’action de l’aéronavale (à l’image des missions françaises Arromanches contre l’organisation terroriste Daech).
Le missile redéfinit ainsi toutes les missions navales : lutte antinavire, lutte anti-aérienne, frappe au sol et même lutte anti-sous-marine, devenant progressivement le principal système d’armes des navires de guerre. Les capacités de frappes dans la profondeur offertes par les missiles de croisière ou par l’aviation embarquée, plus spécifiquement, consacrent le rôle cardinal de la marine en matière de projection de puissance. Ces actions « chirurgicales » permettent d’atteindre rapidement et précisément presque n’importe quel point du globe. Les interventions navales offrent une liberté de mouvement incomparable (notamment d’approche des territoires visés par la mer) en limitant au maximum l’engagement de troupes au sol, suivant le mouvement général des attaques de précision comme modèle des conflits contemporains. Outil stratégique par excellence, le missile de croisière naval renforce ainsi la posture de dissuasion conventionnelle des marines qui en sont dotées.
L’espace, 4e milieu
En matière technologique, la période contemporaine a été particulièrement marquée, enfin, par l’évolution rapide des systèmes d’information et de communication. L’essor de l’informatique et l’élongation des communications a radicalement changé le cadre d’action des marines, qui bénéficient à la fois de liaisons permanentes avec leurs centres de commandement terrestres et de capacités de partage instantané d’informations au sein d’une force (grâce aux liaisons de données tactiques, notamment). La maîtrise des moyens de communication devient de ce fait un enjeu majeur, les systèmes d’armes et de navigation modernes reposant au quotidien sur leur disponibilité[4]. Ceci sera encore accentué par la mise en œuvre de drones, intrinsèquement dépendante des capacités de contrôle et d’échanges d’informations à distance. La permanence des communications et la capacité d’intégration de différents sous-systèmes constituera d’ailleurs la principale gageure de la future « guerre en réseaux », dont le programme SCAF[5], visant à associer chasseurs traditionnels et drones aériens autonomes, est une illustration.
Cette connectivité permanente est aujourd’hui permise par l’usage croissant de l’espace, véritable quatrième dimension des opérations navales. Historiquement, les marines d’État n’étaient reliées aux centres de décision que par des missives aux trajets longs et aléatoires – aussi les vaisseaux déployés à l’autre bout du globe étaient-ils largement coupés de la métropole. Au siècle dernier, les progrès en communications radiophonique et télégraphique limitèrent cet isolement, fluidifiant les transmissions d’ordres et de compte-rendus, principalement au niveau tactique à courte distance. Mais la véritable bascule intervint avec l’usage de l’espace, qui partage avec le milieu marin d’être intrinsèquement un espace de liberté régi par un cadre juridique spécifique[6]. Dans le domaine naval, le développement des satellites a deux implications majeures, permettant d’une part les communications à longue élongation, d’autre part la surveillance de l’espace maritime[7], le tout à une échelle globale. Les communications satellitaires offrent en effet une telle élongation qu’elles assurent aujourd’hui une couverture mondiale, contre quelques dizaines de kilomètres de portée pour les antennes radiophoniques. Le débit est également sans commune mesure, permettant le transfert instantané de contenus numériques divers[8]. Ces capacités de communication constituent un changement majeur dans l’histoire des marines : l’ancien isolement des vaisseaux était l’autre facette de leur liberté, la liaison permanente avec les centres de commandement limitant de facto l’autonomie décisionnelle du commandant du navire, qui n’est plus « seul maître à bord après Dieu » !
Les marines aujourd’hui : une mutation des objectifs stratégiques ?
La chute de l’URSS a marqué une rupture dans l’histoire récente des marines de guerre. Tandis que la flotte russe subit un net déclassement dans les années 1990, les États occidentaux ont quant à eux moins investi dans leurs armées, les « dividendes de la paix » justifiant l’arrêt de nombreux programmes d’armement. En termes relatifs et absolus, les États-Unis ont ainsi vu s’accroître leur supériorité militaire et technologique, notamment en matière navale. Elle est l’une des principales composantes de l’« hyperpuissance américaine » théorisée en 1998 par l’ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, seulement remise en cause aujourd’hui par l’essor de la Chine.
Dans le cadre d’un ordre international visant par ailleurs à restreindre le recours à la force armée, les conflits interétatiques ouverts se sont alors faits plus rares, supplantés par une succession de crises, guerres civiles ou conflits larvés souvent réunis sous l’acception de « zones grises ». Si ce nouvel ordre mondial s’est traduit par une disparition des conflits navals de haute intensité entre puissances équivalentes, les marines sont néanmoins largement engagées dans la résolution de ces crises. Les opérations contemporaines comprennent en effet quasi-systématiquement un volet naval, lequel offre les capacités de frappe mais également de transport de troupes, de blocus, de renseignement ou simplement de logistique inégalables[9]. La stratégie contemporaine se voit ainsi marquée par une imbrication croissante de l’élément marin dans les opérations aéroterrestres. L’amiral Raoul Castex écrivait à ce titre dans ses Théories stratégiques que « l’influence de la puissance de mer dans les grandes crises de ce monde est fonction de la force aéroterrestre qu’elle est capable de déployer et l’influence de la puissance de terre se mesure aux mêmes moments à la force aéronavale qu’elle peut jeter dans la balance »[10].
Parallèlement, les marines sont plus largement employées à assurer la sécurité maritime mondiale en deçà du seul spectre militaire, via des opérations de lutte contre une criminalité plus ou moins organisée (piraterie, pêche illégale, trafics ou terrorisme). Aux côtés des bâtiments de premier rang, les moyens de souveraineté ont été largement renforcés (navires de surveillance, patrouilleurs, bâtiments amphibies, navires hôpitaux, etc.). Les différents documents stratégiques nationaux ont traduit cette évolution du contexte stratégique, en intégrant par exemple la notion d’« opérations militaires autres que la guerre », présente dans la doctrine américaine[11] ou dans le Livre blanc de la Défense chinois de 2008. La dimension navale est prégnante dans ces opérations, qui consistent par exemple en des évacuations de ressortissants[12] ou de soutien humanitaire[13].
La prédominance des engagements asymétriques n’a pourtant pas freiné le perfectionnement de l’armement destiné au combat naval de haute intensité. Parmi les avancées les plus novatrices – et les plus commentées – figurent notamment les drones, la guerre en réseaux (« network-centric warfare » aux États-Unis, « informationized warfare »[14] dans la doctrine chinoise), l’intelligence artificielle, le cyberespace, l’hypervélocité ou encore l’électromagnétisme (railguns ou catapultes). Si la rapidité des évolutions techniques suscite des réflexions quant à de possibles ruptures stratégiques, il est encore tôt pour prédire leur efficacité opérationnelle, les plans résistant rarement à l’épreuve du feu[15]. Seul un conflit entre puissances équivalentes permettrait de mesurer les bouleversements doctrinaux et tactiques induits par l’usage de telles technologies et de leurs possibles parades.
Cette incertitude participe de la vivacité de querelles doctrinales touchant au format actuel des flottes. L’une des plus vivaces aujourd’hui concerne le porte-avions, déclassé selon certains analystes par le développement de missiles antinavires de plus en plus rapides, précis, et d’une portée accrue. Associé à une logique efficacité-coût, le débat fait notamment rage aux États-Unis : en 2019, un cadre du Pentagone soutenait par exemple que « 2 000 missiles » effraieraient peut-être plus la Chine qu’un porte-avions vulnérable face au missile DF-26, pour un budget similaire[16]. Dans la même veine, le développement de moyens de déni d’accès (anti-access/area denial, ou « A2/AD »), tels que des batteries antinavires et antiaériennes côtières, nourrit des argumentaires prônant le recours à des navires légers, plus mobiles et plus nombreux, plutôt qu’à des flottes structurées autour d’unités puissantes mais lourdes, coûteuses et donc en nombre restreint – ce qui n’est pas sans rappeler le début du XXe siècle et la Jeune École. Pourtant, le porte-avions demeure un outil inégalé de projection de puissance, en plus de figurer un outil diplomatique majeur. Le débat est loin d’être clos, comme le montrent les efforts des grandes marines mondiales pour s’équiper de porte-avions ou de porte-aéronefs s’en approchant, à l’image de la Chine, de l’Inde, du Japon, de la Corée du Sud ou encore de la Turquie.
Ces questions stratégiques se posent aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité que l’on souligne le retour de la violence en mer, possible prélude à de futurs conflits navals. L’amiral Prazuck, alors chef d’Etat-Major de la marine français, déclarait en 2018 que « l’hypothèse tactique d’une confrontation de flottes en haute mer redevient une hypothèse réaliste »[17]. Lui succédant, l’amiral Vandier incitait quant à lui dès sa prise de fonctions les élèves officiers à se préparer à « connaître le feu à la mer »[18].
À lire également
Nouveau hors-série : Armée de terre, le saut vers la haute intensité
Quels objectifs stratégiques pour la guerre navale du XXIe siècle ?
Comme par le passé, les forces navales peuvent servir des logiques d’expansion territoriale, nombre de contestations de souveraineté actuelles touchant en effet des territoires insulaires[19]. En mer de Chine méridionale particulièrement, les États riverains s’opposent quant aux archipels des Spratly et des Paracells, rivalités dégénérant régulièrement en épreuve de force. En janvier 1974 déjà, les forces vietnamiennes furent délogées par une attaque chinoise navale et amphibie des îles Paracells, toujours occupées par la Chine. Depuis lors, les altercations se sont multipliées dans cette aire maritime, opposant régulièrement les navires chinois, notamment la force des garde-côtes, aux pêcheurs vietnamiens ou philippins pour le contrôle des îlots ou récifs de la zone. Sur le théâtre asiatique toujours, la question de Taïwan occupe une place centrale dans le discours stratégique de Pékin, les livres blancs de la Défense rappelant chaque année l’objectif d’intégration de l’île à la Chine continentale. Si les éléments de langage soulignent d’ordinaire une méthode de « réunification pacifique », la réalité de l’industrie navale et des démonstrations de force dans la zone font craindre un possible affrontement ouvert dans le détroit de Formose à l’avenir.
Par ailleurs, si le contrôle des communications maritimes a toujours été stratégique, la mondialisation et sa dépendance aux échanges maritimes renforce ce phénomène, et la puissance d’un État peut se mesurer à sa maîtrise de certaines voies de communication mondiales.
Dans le domaine économique, la logique de « guerre de course » est néanmoins quelque peu tombée en désuétude. Avec l’internationalisation des marchés, il devient en effet difficile aujourd’hui de viser un État spécifique en attaquant des paquebots dont le propriétaire, l’armateur, l’équipage et les marchandises viennent la majeure partie du temps de pays différents. Au contraire, la dépendance économique mondiale au transit maritime incite tous les États à participer à sa sécurité, via notamment des missions anti-piraterie dans les passages stratégiques. La Chine concourt par exemple depuis 2008 à la lutte contre la piraterie au large de la corne de l’Afrique ; en janvier 2020, c’étaient les marines japonaise et russe qui tenaient leurs premiers exercices navals conjoints en mer d’Arabie. Le possible blocus de passages stratégiques, comme le détroit de Malacca ou celui d’Ormuz, offrent alors un immense pouvoir de nuisance en affectant l’économie mondiale, mais même les États mis au ban de la communauté internationale, tels que l’Iran ou la Corée du Nord, n’ont que peu d’intérêt (sinon dans une logique dissuasive) à voir ces communications arrêtées, dépendant eux-mêmes de leurs échanges maritimes.
Un phénomène nouveau introduit néanmoins une véritable rupture stratégique : « l’infrastructuration »[20] de la mer, c’est-à-dire l’occupation croissante de l’espace maritime. Milieu autrefois vide, la mer se couvre aujourd’hui de pipelines, de câbles sous-marins et de plateformes offshores, autant de structures dédiées aux communications ou à l’exploitation des océans, à l’heure où s’épuisent les réserves terrestres[21]. Cette importance croissante des ressources marines s’accompagne d’une volonté de « territorialisation » alimentée en partie par le droit issu de la Convention des Nations-Unis sur le droit de la Mer, dite « Convention de Montego Bay » (1982). Celle-ci a en effet juridiquement consacré les « zones économiques exclusives », assorties d’un monopole d’exploitation de leurs ressources. Les États rivalisent alors pour asseoir leur souveraineté sur ces zones maritimes afin d’en capter les ressources, parfois aussi pour y affirmer leur juridiction, jusqu’à chercher à y restreindre la liberté de navigation. Si les différends se déroulent souvent dans la sphère juridique, les flottes militaires prennent part à cette rivalité. La politique du fait accompli à l’œuvre en mer de Chine méridionale ou la pression exercée par la marine turque au large de Chypre sont autant de tentatives de contrôle par la force de ces zones maritimes.
L’actuelle « maritimisation »[22] du monde fait ainsi jouer aux forces navales un rôle de premier plan. En investissant la scène internationale dont les océans constituent l’environnement propice, les navires offrent un moyen primordial d’expression de la puissance étatique, par leurs seuls déploiements et la démonstration de leurs capacités[23]. La présence navale participe ainsi de la politique d’influence de tout État qui entend peser dans le jeu des négociations internationales et de définition de l’ordre mondial[24]. Hervé Coutau-Bégarie écrivait à cet égard : « Auparavant simple théâtre des conflits, la mer est devenue objet de conflits ».
À lire également
Bataille des cieux, batailles navales
[1] Cet argument sort en outre renforcé de la guerre de 1870 qui justifie un investissement conséquent dans la fortification de la frontière orientale.
[2] L’amiral Aube notamment réfute la Déclaration de Paris de 1856 qui interdit la guerre de course : pour lui, la marine française doit viser les ports et les paquebots de commerce ennemis pour ébranler l’économie anglaise.
[3] Les colonels chinois Quiao Liang et Wang Xiangsui ont publié en 1999 un ouvrage traduit en français sous le titre La guerre hors limites (2003). Ils y analysent la guerre du Golfe, révélatrice à leur sens d’un changement de paradigme consistant en l’avènement d’un nouvel ordre international marqué par la suprématie militaire américaine. S’ils soulignent la réussite américaine dans les domaines technique, militaire ou économique, les États-Unis servent également d’anti-modèle : contrairement à Washington, présenté comme préférant les « guerres directes » incitant à la surenchère, les auteurs défendent une stratégie chinoise de « guerre indirecte », privilégiant la ruse et les actions politiques ou économiques pour vaincre sans combats.
[4] Aujourd’hui par exemple, le mode normal de navigation tant civile que militaire repose sur le positionnement par satellite (via le système GPS). Cette dépendance crée du même coup une vulnérabilité nouvelle, face aux possibilités de brouillage, d’intrusion informatique adverses ou plus simplement d’avaries matérielles.
[5] « Système de combat aérien du futur », coopération industrielle entre la France, l’Allemagne et l’Espagne.
[6] Le traité de 1967 sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique consacre en effet le principe de non-appropriation de l’espace. Les États sont ainsi libres de mettre des satellites en orbite, lesquels peuvent servir un usage civil autant que militaire. Cette non-appropriation, si elle s’oppose au principe de souveraineté, n’empêche évidemment pas la surenchère des rivalités.
[7] Sur le second aspect, l’imagerie satellitaire permet en effet de relocaliser des forces navales déployées, dans la limite de la fréquence des passages de satellites sur zone et des capacités d’exploitation des informations collectées.
[8] Si les premiers programmes spatiaux (tels que l’« Initiative de Défense stratégique » de Reagan en 1983) étaient surtout à visée stratégique (pour contrer la menace balistique nucléaire), le tournant des années 1990 vit l’apparition de l’usage tactique des liaisons satellitaires, permettant le partage de données au plus près du terrain aux unités en opération.
[9] À l’image de la base navale de Tartous, site stratégique de l’intervention russe en Syrie permettant des transits maritimes réguliers depuis la base de Sébastopol pour le soutien logistique.
[10] Raoul Castex, Théories stratégiques, Paris, Economica, 1997.
[11] Dès 1995 dans la Joint Doctrine for Military Operations Other Than War, par exemple.
[12] Opération américaine Eastern Exit, Somalie, 1991 ; évacuation de ressortissants en Libye par la marine chinoise, 2011.
[13] Intervention de la marine française après le passage de l’ouragan Irma dans les Antilles, 2017 ; volet naval de l’opération Résilience, 2020 ; intervention au Liban d’un porte-hélicoptères amphibie français après une explosion dans le port de Beyrouth en août 2020 (opération Amitié).
[14] J. Michael Dahm, « Beyond “Conventional Wisdom”: Evaluating The PLA’s South China Sea Bases in Operational Context », War on the Rocks, 17 mars 2020.
[15] Selon la formule bien connue du stratège prussien Moltke selon lequel « aucun plan de bataille ne survit au contact de l’ennemi ».
[16] « Are Aircraft Carriers Obsolete? The Pentagon R&D Chief Takes on the Topic », Dailymotion, 6 septembre 2019.
[17] Audition du chef d’État-Major de la Marine devant la Commission de la défense nationale, Compte-rendu n°2, mardi 24 juillet 2018, séance de 14 heures.
[18] Cité par Laurent Lagneau, « Général Lecointre : « L’histoire nous apprend que le risque le plus grave est celui qu’on ne veut pas voir venir » », Zone Militaire, 13 septembre 2020.
[19] Rivalité entre Iran et Émirats arabes unis sur les îles Grand Tunb et Petite Tunb dans le golfe Persique, par exemple, ou encore les nombreux contentieux territoriaux des archipels asiatiques (outre la mer de Chine méridionale, on peut citer les différends opposant Chine et Japon autour des îles Senkaku, le Japon et la Russie autour des îles Kouriles, entre autres).
[20] Lars Wedin, Stratégies maritimes au XXIe siècle. L’apport de l’amiral Castex, Nuvis, Paris, 2015.
[21] Entretien avec Lars Wedin, « Castex et la maritimisation du monde », rédaction de DSI, Défense et Sécurité Internationale, 11 juin 2018.
[22] Entretien avec l’amiral Christophe Prazuck, « La mondialisation est en réalité une maritimisation », propos recueillis par Alain Léauthier et Natacha Polony, Marianne, 21 février 2020.
[23] Illustrant l’opposition historique entre « res communis » et « res nullius » : si la seconde acception fait du milieu marin avant tout un espace de liberté, la première sous-entend une responsabilité partagée entre États. Dans les faits, peu de nations ont en réalité les moyens d’assumer cette responsabilité par l’emploi de marines hauturières opérationnelles, et, partant, d’affirmer leurs valeurs sur les théâtres maritimes.
[24] Cromwell écrivait déjà au XVIIe siècle qu’un « navire de guerre est le meilleur des ambassadeurs ».