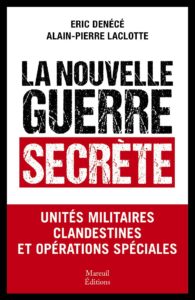Deux ouvrages récemment publiés presque sous le même titre parlent de guerre secrète. L’un passe en revue les unités clandestines actuellement chargées de lutter contre le terrorisme, l’autre traite des moyens et des méthodes employés depuis plus d’un siècle pour mener ces combats dans l’ombre.
Marie-Catherine et Paul Villatoux, Guerres secrètes. Renseignement et opérations spéciales de la Grande Guerre à l’Afghanistan, Saint-Pierre-du-Perray, Memorabilia, 2021, ill., 239 p.
Eric Dénécé et Alain-Pierre Laclotte, La nouvelle guerre secrète – Unités militaires clandestines et opérations spéciales, Paris, Mareuil éditions, 431 p.
Après une introduction succincte aux caractéristiques et à l’évolution récentes de la guerre, l’ouvrage d’Éric Dénécé et d’Alain-Pierre Laclotte se présente comme le Who’s who minutieux d’unités très spéciales, militaires et clandestines, britanniques, américaines, israéliennes et françaises dont il retrace la progression depuis, très approximativement, les années 1970.
Combattants de la guerre secrète
Créées dans le cadre de la lutte contre-terroriste et d’abord rodées au Royaume-Uni et en Israël, elles ont été adoptées par d’autres États qui leur ont confié des missions de surveillance, de traitement des sources et d’intervention qui ne cessent de croître. Qui sont-elles, que savent-elles faire ? Les sources accessibles — témoignages, documents déclassifiés, ouvrages publiés — permettent rarement de répondre à cette autre question : ont-elles satisfait aux attentes qui les ont fait naître ?
Leur existence et leur mode d’action résultent de l’histoire des États dont elles relèvent, et la diversité des contextes rend dès lors toute comparaison difficile. Pour le Royaume-Uni, ce furent la Seconde Guerre mondiale, puis des interventions en Asie et en Afrique, et, surtout, le long conflit qui a rongé l’Ulster. Pour les États-Unis, les guerres de Corée et du Vietnam, puis, la Guerre froide achevée, des interventions au Moyen-Orient et en Afghanistan. En Israël, la place de ces unités procède des conditions de création, de survie et d’expansion de l’État hébreu. Quant à la France, la formation reçue en Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale, puis les expériences de l’Indochine, de l’Algérie et des OPEX sont à l’origine des structures dépendant certaines du renseignement et d’autres de l’armée.
Le sujet israélien a été souvent traité, notamment par l’un des auteurs[1], et la situation française, abordée en deux chapitres, semble poursuivre des discussions propres au milieu militaire[2] plus qu’elle n’apaise la curiosité des lecteurs. Restent les unités américaines, dont la riche matière a donné lieu à la publication d’un hors-série de la revue RAIDS[3], et les unités britanniques dont on peut tirer des leçons dans l’art d’externaliser les responsabilités.
À lire également
Nouveau Numéro : Nucléaire l’atome, futur des armées et de l’énergie ?
Le « laboratoire » de l’Ulster
Commencées durant la Seconde Guerre mondiale, éprouvées en Malaisie, puis au Kenya, dans le sultanat d’Oman, à Aden et Bornéo, également en RFA dans le cadre de la Guerre froide, les interventions britanniques les plus marquantes se sont produites dans le « laboratoire » d’Irlande du Nord auquel est consacré un développement précis et justement critique. On demandait alors à des unités militaires d’intervenir clandestinement sur le territoire même du Royaume-Uni. Toute action devenait délicate, mais on fit en sorte que la responsabilité des exécutions et des interventions illégales fussent attribuées aux forces loyalistes de l’Ulster, de préférence aux milices plutôt qu’aux forces de l’ordre.
Selon le même principe d’externalisation des risques d’une compromission, des armées privées ont pris le relais pour des interventions hors du Royaume-Uni, et David Stirling, célèbre fondateur des SAS qui servirent de modèle aux parachutistes de la France libre, a été à l’origine de plusieurs d’entre elles. « Ces sociétés, toujours en contact étroit avec les autorités et très suivies par le MI5 et le MI6, offrent la possibilité au gouvernement britannique de nier son implication dans certaines actions si celles-ci devenaient politiquement embarrassantes ou lorsque la situation diplomatique ne permet pas d’intervention directe[4]. »
Échapper à la surveillance du Congrès
Les chapitres consacrés aux structures clandestines nord-américaines exigent du lecteur une certaine dextérité dans le déchiffrage des acronymes : depuis la Seconde Guerre mondiale qui a fait naître l’OSS (Office of Strategic Services) à laquelle a succédé la CIA (Central Intelligence Agency), ces unités se sont multipliées, leur appellation fréquemment changée afin de dépister les observateurs. Deux moments apparaissent décisifs : après 1980, les échecs subis en Iran ont obligé à une révision des moyens sinon des doctrines et, vingt ans plus tard, l’attentat du 11 septembre a exacerbé les rivalités entre la CIA et le Pentagone, suscitant une débauche de moyens en faveur des forces spéciales. Les développements consacrés à celles qui dépendent du JSOC, le Joint Special Operations Command, sont particulièrement éclairants et précis[5].
Créé par le Pentagone, le JSOC s’est chargé de missions clandestines que l’Agence exécutait moins bien que lui. En deux décennies, il s’est affirmé comme « l’instrument majeur du renseignement américain », de mieux en mieux pourvu, de plus en plus indépendant. Une arme que les présidents G. W. Bush et Barak Obama « ont largement employée au fil des ans, avec peu ou pas de contrôle du Congrès[6] ».
« Depuis le 11 septembre 2001 […], le JSOC a connu une augmentation majeure de ses activités, de ses effectifs, de ses moyens et de ses budgets. Son quartier général a doublé de taille. Il a acquis toutes les caractéristiques d’une armée secrète autonome. […] De 1 800 soldats en 2001, le JSOC est devenu une force de 25 000 hommes aujourd’hui[7]. »
Les interventions attendues de ces unités ont obéi aux règles imposées par « la déclaration de guerre au terrorisme (GWOT) » : on n’envisage plus de chercher un arrangement et de passer des compromis avec l’adversaire pour mettre fin à un conflit, il s’agit d’éliminer le plus grand nombre d’ennemis et de parer le prochain coup. Engagée ainsi, l’affaire peut durer longtemps. Mais l’intervention et l’avis du Congrès ne sont pas souhaités et beaucoup d’ingéniosité et de moyens passent à programmer des couvertures, obtenir des budgets secrets, monter des sociétés-écrans. Afin d’implanter des institutions et des valeurs démocratiques dans des pays qui n’y tiennent pas plus que ça, les États-Unis auront montré leur efficacité à développer des forces préoccupées d’échapper au contrôle parlementaire.
La ruse, la surprise et l’intoxication
L’ouvrage de Marie-Catherine et de Paul Villatoux traite moins d’actualité que d’invariants tels que la ruse et l’intoxication (ou désinformation), en donnant de multiples éclairages sur les procédés non-orthodoxes de la guerre secrète, « l’une des formes les plus subtiles et les plus abouties de l’art militaire ». Sera donc déployé l’éventail de ses moyens : le renseignement, la propagande blanche et noire, l’influence, la subversion, la guérilla, la contre-insurrection, ainsi que des opérations clandestines allant du sabotage et de l’assassinat au coup d’État.
L’exploitation de la troisième dimension a beaucoup élargi ce domaine. L’aérostat est apparu en France dès la fin du XVIIIe siècle et le dirigeable dans les premières années du XXe, en Allemagne. Londres a fait les frais des premières expériences de bombardement aérien durant la Première Guerre mondiale. Au même moment, l’aviation servit à déposer des agents à l’arrière des lignes adverses, chargés de sabotage ou de renseignement. Le livre retrace plaisamment l’histoire de deux « as » champions de ces missions audacieuses, Jules Védrines et Anselme Marchal. C’est également entre 1914 et 1918 que la guerre des codes est apparue ainsi que la photographie aérienne. L’aviation de reconnaissance était née. Le renseignement se perfectionna durant la Seconde Guerre mondiale et un chapitre revient sur l’histoire des radios dont le rôle dans la résistance est célébré.
Au lendemain de la guerre, Berlin devint un enjeu et l’existence de l’aérodrome français de Berlin-Tegel, peu connu du public, a joué son rôle dans l’approvisionnement de la ville durant le blocus de 1948-1949. Tegel servit alors comme une structure d’urgence efficace en temps de crise autant qu’une vitrine de la technologie française qui avait besoin de s’affirmer. Ce fut aussi à Berlin que s’effectua l’apprentissage de l’escadrille Dunkerque de surveillance électronique, les « grandes oreilles »[8].
Un chapitre des plus originaux de l’ouvrage traite de l’aviation française des opérations spéciales devenues l’escadrille Vaucluse, ancêtre du GAM 56, qui permit d’exfiltrer des personnalités de l’Est, missions confiées aux parachutistes du 11e choc, dont certaines échouèrent du fait d’une une « taupe » jamais démasquée ou dont l’identité n’a pas été rendue publique. L’escadrille fut ensuite employée à des interventions tout aussi clandestines durant la guerre d’Algérie, aux frontières du Maghreb.
De nombreuses photographies inédites illustrent les différents chapitres et des annexes dressent le portrait de quelques espions célèbres qui ont travaillé pour l’URSS, à l’exception de Gary Powers, pilote de l’U2 abattu par un missile soviétique en 1960 : Richard Sorge et Kim Philby, qui restera l’archétype de la taupe, et Georges Pâques, pendant trente ans agent soviétique improbable et médiocre dont les auteurs suggèrent qu’il aurait servi de fusible à de plus hauts responsables[9].
Ces deux ouvrages, aux ambitions différentes, sont complémentaires en ce qu’ils contribuent à enrichir la connaissance de certains aspects de la guerre irrégulière.
À écouter également
Podcast. Parachutistes en Algérie. Marie-Danielle Demélas
[1] Eric Denécé et David Elkaïm, Les services secrets israéliens : Mossad, Aman, Shin Beth, Paris, Taillandier, 2020.
[2] Alimentées par l’ouvrage du général Christophe Gomard, Soldat de l’ombre. Au cœur des forces spéciales, Paris, Taillandier, 2020, 384 p.
[3] RAIDS, « Les unités militaires clandestines américaines », hors série n° 81, premier trimestre 2022.
[4] E. Dénécé, A.-P. Laclotte, La Guerre secrète, p. 112.
[5] L’essor du JSOC et des unités qui en dépendent est si récent qu’il ne figure pas dans l’Encyclopédie du renseignement et des services secrets de Jacques Baud (Lavauzelle, 2002, dernière édition, 740 p.).
[6] E. Dénécé, A.-P. Laclotte, La Guerre secrète, p. 233.
[7] Ibid., p. 223.
[8] Les deux ouvrages évoquent la mission militaire de liaison de Potsdam qui joua un rôle important dans le renseignement durant la Guerre froide sur la zone de contact entre l’Est et l’Ouest, mais ne citent pas un témoignage indispensable (Général Patrick Manificat, Propousk ! Missions derrière le rideau de fer (1947-1989), Paris, Lavauzelle, 2008, 512 p.).
[9] Les accusations portées par Philippe Thyraud de Vosjoli, qui dut chercher asile aux États-Unis (cas unique d’un Français réfugié politique), furent tenues pour des affabulations (Lamia, Montréal, éditions de l’Homme, 1972, 463 p.). Condamné à perpétuité en 1964, Pâques fut gracié six ans plus tard.