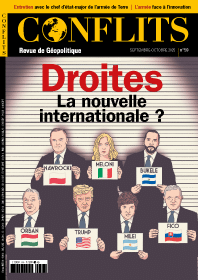L’impôt sur les successions est sans conteste l’impôt qui suscite la controverse idéologique la plus vive. Rares sont, à son égard, les positions mesurées : on est soit pour sa suppression pure et simple, soit pour son renforcement (jusqu’à défendre parfois la confiscation intégrale des héritages).
Article paru dans le N°57 de Conflits.
Chez les libéraux mêmes, un schisme s’observe. Pour les uns, la protection du droit de propriété du défunt impose l’abrogation de toute fiscalité. Se plaçant du seul point de vue du léguant (tout en intégrant une dimension familiale), ils considèrent la taxation des successions comme immorale par principe. Le capital ayant été taxé à de multiples reprises tout au long du cycle de vie, l’État doit respecter la liberté de transmettre de l’épargnant, et donc ne « taxer ni la mort ni la vertu ». Ils soulignent que seuls 24 pays de l’OCDE sur 38 taxent l’héritage, et que c’est en France que les taux marginaux et le ratio recettes fiscales/PIB sont parmi les plus élevés. Pour les autres, l’égalité des chances et les incitations au travail doivent primer. Se plaçant du seul point de vue du légataire (tout en négligeant cette fois-ci la dimension familiale), ils assimilent l’héritage à un revenu d’aubaine qui fausse la concurrence et réduit les offres de travail (c’est l’« effet Carnegie »).
Les deux séries d’arguments ne sont pas sans limites, et leur validité dépend en grande partie du motif de transmission, difficile à évaluer empiriquement. Si le legs est altruiste (« Je sacrifie une partie de ma consommation immédiate pour accumuler du capital afin de pouvoir le transmettre à mes enfants ») ou stratégique (« Je laisse entrevoir à mes enfants le bénéfice d’un héritage afin qu’ils prennent soin de moi lors de mes vieux jours »), la taxation de l’héritage nuit au bien-être individuel et collectif ; elle est condamnable aussi bien philosophiquement qu’économiquement, dès lors qu’elle a une incidence sur l’accumulation de capital dans l’économie. En revanche, si le legs est accidentel (l’épargnant n’a aucune motivation altruiste et se moque bien de transmettre son patrimoine à sa descendance) ou capitaliste (l’épargnant accumule de son vivant pour l’indépendance et le pouvoir que lui procure la détention d’un capital), la taxation de l’héritage ne pose pas de problème philosophique particulier et permet de surcroît à l’État de générer des recettes fiscales sans coût pour l’économie.
En réalité, il semble qu’il y ait toujours un panachage inextricable de ces différents motifs. La limitation de la liberté testamentaire par la « réserve héréditaire » codifiée en 1804 par le Code civil fait que, contrairement aux pays anglo-saxons, la France n’a pas la culture du testament. Difficile dès lors de connaître les intentions profondes des épargnants. Dans le doute, il semble que la suppression des droits de succession ne soit pas la priorité des réformes, vu la structure de notre système d’imposition et l’importance des distorsions fiscales parfaitement identifiées par ailleurs. Au demeurant, les comparaisons internationales sont à prendre avec des pincettes en la matière. Un grand nombre de pays ayant supprimé l’impôt sur l’héritage l’ont en fait intégré à leur impôt sur le revenu.
À lire aussi : En France, seuls la dette et les impôts augmentent
L’Italie offre en l’espèce un compromis intelligent. Après avoir abrogé leurs droits de succession en 2001, les Italiens les ont réintroduits en 2006 sous forme d’une flat tax au taux de 4 % pour les membres de la famille proche et de 8 % pour les autres bénéficiaires. Cette différenciation est à la fois simple et légitime, aussi bien philosophiquement qu’économiquement, le degré d’altruisme étant supposé d’autant plus fort que les liens de consanguinité sont resserrés. Notons ici que, lorsque les droits de succession ont été instaurés par la Révolution française en 1791, il s’agissait aussi d’une flat tax. La proportionnalité de l’impôt permet de rémunérer le service rendu par l’État, garant de l’ensemble des transactions sociales. Autre intérêt du modèle italien : l’Italie a fait le choix d’exonérer complètement les transmissions d’entreprises familiales. Or, en France, malgré le pacte Dutreil, le taux marginal d’imposition de la transmission du patrimoine professionnel pour les entreprises familiales reste de 5,63 %, au détriment parfois de la pérennité de l’actionnariat et de l’emploi local.