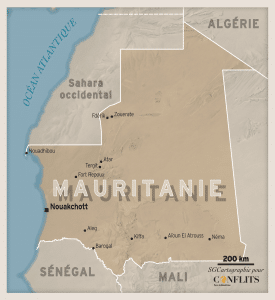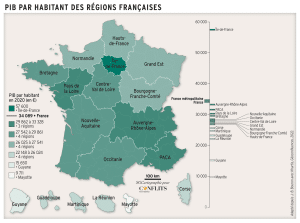Fallait-il réagit aux événements du 13 novembre dernier ?
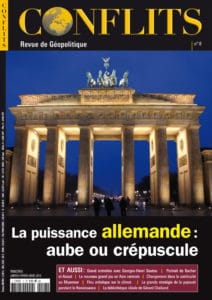
La puissance allemande : aube ou crépuscule
Nous n’avons pas cru utile de modifier dans l’urgence notre dossier afin de coller à l’actualité. Nous avions peu de temps, et surtout nous n’avions pas le recul nécessaire. Il n’était pas question de réagir dans l’instant, au risque de faire passer nos sentiments avant nos raisons. La hâte et l’émotion sont mauvaises conseillères.
Nous concevons autrement notre rôle. Donner à nos lecteurs des éléments de réflexion sur le long terme. Nous l’avions fait dans le numéro 6 de Conflits en réagissant à l’affirmation pour le moins rapide d’un géopoliticien : « Comme toujours le terrorisme sera vaincu ». Tout dépend, disions-nous, du soutien que les terroristes peuvent trouver à l’intérieur et à l’extérieur du pays, des réseaux dont ils disposent, de l’adhésion qu’ils peuvent susciter – oui, je le répète, de l’adhésion qu’ils peuvent susciter, malgré ou à cause de l’ampleur des massacres. Ces remarques gardent toute leur actualité et il est regrettable que les décideurs ne s’interrogent pas à leur sujet, sans doute par peur de ce qu’ils pourraient découvrir.
Les derniers attentats devraient les conduire à une autre question qui ne les rassurera certainement pas. Comment se fait-il que des individus de nationalité française, nés dans ce pays, passés par son éducation nationale, biberonnés aux idées républicaines et baignés par les charmes de la société de consommation, se soient transformés en bombes humaines, introduisant des méthodes de combat inconnues dans notre pays – puisqu’ils se considèrent comme des combattants – jusqu’à se faire exploser pour rien, si l’on ose dire, comme les terroristes du stade de France quand ils ont constaté l’échec de leur mission ? Cette référence à des idées et des pratiques venues du Proche-Orient et, pour tout dire, étrangères, constitue un fait qu’il faudra décanter, expliquer, interpréter. Nous y consacrerons un prochain dossier, quand nous estimerons disposer de suffisamment de recul.
C’est que les relations entre la réflexion géopolitique et la survenue des événements sont complexes. La géopolitique s’efforce d’analyser les rapports de force dans le temps long. On attend d’elle qu’elle détermine l’avenir en une sorte de journal du lendemain, or elle en est incapable. Dans le faisceau des possibilités qu’elle constate, elle n’arrive pas à discerner celles qui s’imposeront au détriment des autres ni avec quel délai. Elle ne connaît ni le jour, ni l’heure, ni même l’événement.
Ainsi elle ne peut pas affirmer péremptoirement quels possibles se réaliseront et lesquels resteront (provisoirement ?) à l’état de simple virtualité, ceux qui se manifesteront rapidement et ceux qui prendront leur temps. Elle est une science des probabilités. Sa marge d’incertitude correspond très exactement à la liberté que conserve le politique. « Géo », elle part du temps long de la planète et de l’humanité ; « politique » elle dépend de ceux qui détiennent le pouvoir, de de leurs choix changeants, de la façon dont ils réagissent à l’imprévu.
J’en suis désolé pour tous ceux qui attendent d’elle beaucoup plus, mais la plus belle géopolitique du monde ne peut donner que ce qu’elle a.
Pascal Gauchon
Crédit photo : Maya-Anaïs Yataghène via Flickr (cc)
Conflits n°8, actuellement en kiosque ! #géopolitique #histoire #Allemagne #Europe #Myanmar #Syrie pic.twitter.com/VAQ0JrTYOo
— Revue Conflits (@revueconflits) 11 Janvier 2016
[divider]
Boutique. Voir l’intégralité des numéros : cliquez ici
[product_category category= »numero-papier » orderby= »rand » per_page= »4″]