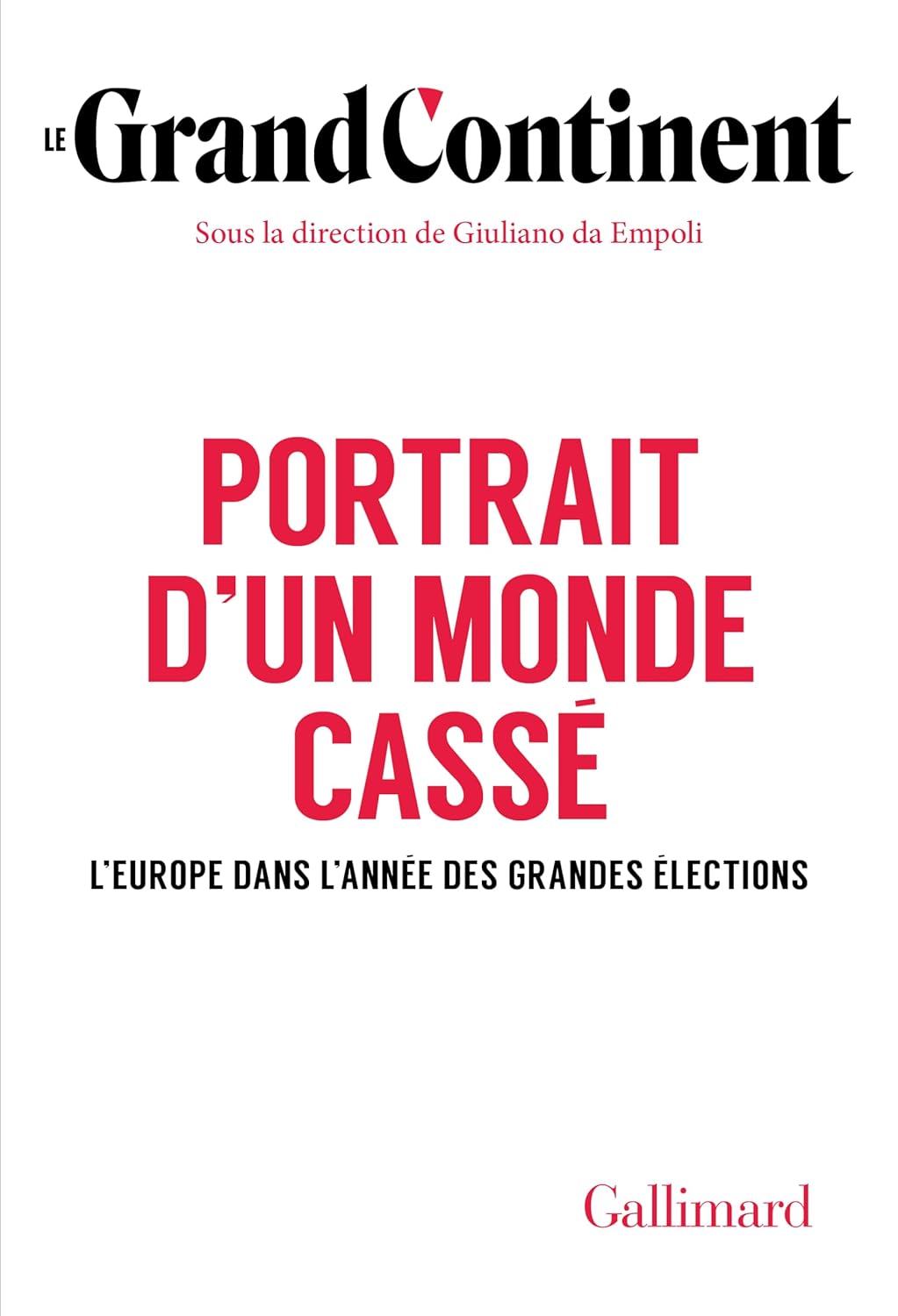Sur quels critères choisir ceux qui ont le pouvoir, qu’il soit économique, politique ou intellectuel ? Quelle place accorder aux meilleurs et qui peut élaborer la liste de ces meilleurs ? Autant de questions qui touchent à l’essence de la démocratie et que des auteurs aussi variés qu’Aristote, Pascal et Tocqueville ont tenté d’élucider. C’est ce que démontre Adrien Louis dans son dernier ouvrage, Les meilleurs n’auront pas le pouvoir.
Adrien Louis est docteur en philosophie et auteur de Les meilleurs n’auront pas le pouvoir, (Presses universitaires de France, 2021). Entretien réalisé par Alexis Carré, docteur en philosophie. Ses travaux portent sur les mutations de l’ordre libéral dans son rapport à la violence et à la guerre. Le suivre sur Twitter.
De tous les problèmes qui fracturent les démocraties à ce jour, pourquoi choisir celui de l’excellence et du mérite ?
Tout simplement parce que notre capacité à surmonter ces problèmes va tenir, selon toute vraisemblance, à l’excellence de nos gouvernants ! Ce qui suppose que la plupart des citoyens puissent reconnaître le mérite de ceux qui se présentent à leur suffrage. Ce qui suppose encore que nos régimes aient le souci un peu marqué de développer l’excellence intellectuelle des citoyens. Bref, comme le montre suffisamment la colère ambiante contre nos élites libérales ou « technocratiques », dont le discrédit profite à des élites populistes qui ne sont guère plus réjouissantes, le sort d’une cité ou d’une nation dépend étroitement de la possibilité de faire émerger une élite digne de ce nom, susceptible d’être reconnue comme telle par le corps civique.
Cette préoccupation pour l’excellence et le mérite est donc très directement sollicitée par notre situation. Mais en tant que telle, elle est au cœur de la philosophique politique, et notoirement de la philosophie politique ancienne. L’œuvre de Platon, par exemple, m’apparaît comme un effort tenace pour discerner ce qu’est l’intelligence politique. Ses dialogues nous plongent dans cette cité athénienne où les prétentions de l’intelligence à gouverner les hommes n’ont jamais été aussi exacerbées. Cette prétention est d’abord celle des jeunes Athéniens de bonne famille qui aspirent à la gloire de commander une cité d’hommes libres. Ces jeunes trouvent leurs maîtres dans les professeurs de rhétorique, puisque c’est par leur capacité de persuader qu’ils pourront espérer parvenir à leur fin. Mais constatant que cette merveilleuse puissance de la parole s’opère dans une coupable ignorance du Bien, le philosophe prend en charge la seule question véritable : quel est ce Bien, ou qu’est-ce que le Juste dont la connaissance est le seul vrai titre à gouverner les hommes ?
Ainsi, malgré leur hostilité au régime de leur cité, c’est probablement à la démocratie que Socrate et Platon doivent l’apparition et le sens de leur questionnement. C’est la démocratie, le désir de se gouverner soi-même, qui rendent impérieuse l’enquête sur la nature de l’intelligence ou de l’excellence politique.
À lire également
Nouveau Numéro : Mer de Chine, Taïwan prochaine prise ?
Parmi les trois auteurs que vous avez choisis pour explorer cette question que vous jugez urgente pour la démocratie libérale, Aristote et Pascal n’ont pas connu la forme mature de ce régime. Qu’ont-ils à nous apprendre sur notre situation ?
Aristote me semble captivant parce qu’une de ses grandes préoccupations est de concilier la défense de l’excellence humaine, comme moyen et comme fin de gouvernement, avec la participation du plus grand nombre aux affaires politiques. Or concilier le nombre et la raison, assurer la vertu des représentants en même temps que leur dépendance vis-à-vis des représentés, ce fut aussi un grand problème du gouvernement représentatif moderne. Ajoutez à cela qu’Aristote considère toutes les parties « naturelles » de la cité que sont les riches, les pauvres, la classe moyenne, et les bien-éduqués.
Toutes ces parties, qui contribuent à la vie et au bien de la cité, revendiquent légitimement une part d’honneur et de richesse. Mais que valent ces revendications, et comment les accorder dans un régime à la fois stable et favorable au bonheur de l’homme ? Bref, il me semble qu’entre notre régime politique et les préoccupations d’Aristote, il y a une grande continuité.
On pourrait presque dire que l’intérêt de Pascal est exactement inverse. Vous savez ce qu’il dit d’Aristote et de Platon, qui n’auraient traité de politique que pour se divertir à régler un hôpital de fous. Or les fous sont assurément peu disposés à être gouvernés par la raison. Selon Pascal, ce serait même « un jeu sûr pour tout perdre » que de vouloir asseoir l’ordre politique et social sur une raison supposément éclairée. Le problème est en particulier qu’aucune raison ne pourra rendre compte de manière convaincante de l’inégale répartition des richesses et des honneurs, alors que cette répartition est au cœur de tout ordre social.
Or les fondateurs du régime représentatif, ou les meneurs de la Révolution française ont fait cela même que Pascal jugeait être de la pure folie : ils ont voulu rendre l’ordre politique et social conforme à la raison et aux droits naturels de l’homme. Ils ont cru que la société pouvait être fondée sur l’égalité et la liberté des individus, et que l’attribution du pouvoir pouvait reposer sur la reconnaissance populaire du mérite. Or nous voyons que nos principes premiers sont toujours opposables à la réalité de notre vie sociale, et que le jeu des élections est loin de produire l’assentiment au pouvoir et la stabilité recherchée. En débusquant par avance la folie de nos prétentions, Pascal nous aide donc puissamment à comprendre les fragilités qui minent notre régime.
Vous prenez souvent soin de souligner les désordres que cause la rétribution du mérite. Qu’est-ce qui, en dépit de ces difficultés, rend la référence à celui-ci indispensable ?
La rétribution du mérite contient un problème logique, et engage par ailleurs un problème psychologique. Le problème logique peut se résumer ainsi : contrairement à l’élection à la majorité des voix, au tirage au sort ou à l’hérédité, le « mérite » n’est pas un mode de désignation des dirigeants, mais un principe formel d’attribution du pouvoir. Je veux dire qu’un régime qui fait du mérite un critère d’accès au pouvoir doit immédiatement décider de ceux qui seront juges du mérite.
Mais alors, il semble que l’on tombe dans une sorte de régression à l’infini : car qui mérite d’être juge du mérite ? Le problème est d’autant plus insoluble que selon toute vraisemblance – et l’on rejoint ici le problème psychologique – chacun d’entre nous s’estime être un assez bon juge du mérite. Sur les questions politiques en particulier, chacun se trouve content de sa portion de bon sens et de son intelligence des problèmes. Le projet de donner le pouvoir en fonction du mérite ne peut donc aboutir qu’à la rivalité de toutes les prétentions et de tous les amours-propres. Avec un tel projet, nous dit Pascal, les guerres civiles seront sûres.
Mais ce n’est pas tout ! Car l’homme est ainsi fait qu’il a besoin de croire en la justice et au mérite de ceux qui le gouvernent. Pour le dire autrement, il faut que la répartition des honneurs et des richesses paraisse avoir quelque rapport avec la vertu et le mérite des puissants ou des Grands. Ainsi, la question du mérite concentre, chez Pascal, tout le paradoxe et, si l’on veut, toute la folie de l’ordre humain. Parce qu’il se sentirait avili en obéissant à un ordre injuste, l’homme a besoin de croire au mérite de ceux qui le dirigent. Mais parce qu’ils sont incapables de se mettre d’accord sur les critères du mérite, les hommes doivent se soumettre à un principe arbitraire d’autorité : c’est le Roi, c’est le grand nombre, ou ce sont les biens nés qui décideront seuls du mérite.
Pour répondre plus directement à votre question, je dirais que la référence au mérite est inévitable parce qu’y renoncer, c’est renoncer au seul principe susceptible de justifier les inégalités. En outre, la rétribution du mérite est à l’horizon de cette passion particulièrement forte qu’est l’amour-propre. Renoncer au mérite – par exemple en instituant une désignation des magistrats par tirage au sort – ce serait donc violenter l’apparence de la justice, et ce serait ôter à l’ambition humaine son motif le plus noble. À mon sens, plutôt que d’instruire une critique du mérite en lui-même, il vaut donc mieux réfléchir à la nature des véritables mérites.
L’accès aux fonctions de direction économique et politique n’a jamais autant dépendu de l’obtention d’un diplôme universitaire. Qu’est-ce qui distingue le mérite tel que vous le définissez de la compétence scolaire ou de l’expertise technocratique ?
Je vais répondre brièvement. L’excellence du bon gouvernant réside dans l’excellence de son jugement, et l’excellence de ce jugement dépend en grande partie de son excellence de caractère comme de sa compréhension des hommes. Or, de telles qualités dépendent bien plus d’une richesse d’expériences vécues et d’une certaine éducation morale, que d’un quelconque diplôme universitaire ou d’une quelconque expertise. Ce qui n’implique pas de dénigrer ces derniers, mais simplement de les mettre à leur place. L’homme fait pour diriger, comme disait de Gaulle, est avant tout un homme de caractère.
La reproduction sociale exclut-elle le mérite ? Je m’explique. On entend souvent dire qu’il n’est d’individu plus méritant que celui qui « réussit à partir de rien ». Cette idée n’est-elle pas trompeuse ?
Faire fructifier un héritage peut demander autant d’effort que de conquérir une place à partir de rien. Il n’est donc pas vrai que la reproduction sociale exclut le mérite. Mais on peut tout de même se demander si le mérite de ceux qui ne « partent de rien » ne devrait pas être, à certains égards, plus considéré que celui des héritiers. Au fond, ce problème renvoie au fait que la mesure du mérite a deux aspects : d’un côté, il se mesure en fonction d’un critère objectif et déterminé d’excellence, et d’un autre côté, il se mesure à l’effort investi pour atteindre cette excellence. Est-il oiseux, ou est-il légitime, de considérer ce dernier aspect du mérite ? Faut-il par exemple qu’une grande école réserve un nombre réservé de places à des élèves de milieux défavorisés ? Je préfèrerais, pour ma part, que les bons élèves issus de ces milieux bénéficient de soutiens institutionnels le plus tôt possible, pour qu’on puisse en toute équité, le moment venu, se prononcer sur leur seule excellence « objective ». Telle était tout de même la grande ambition de l’école républicaine. Mais il faut bien reconnaître que notre école est moins que jamais à la hauteur d’une telle ambition.
Finalement, quelle est la place spécifique du mérite dans l’ordre démocratique et libéral, et quelles dispositions doit-on prendre aujourd’hui afin de la restaurer ?
La dernière partie de votre question suggère que nous traversons actuellement une crise de la « méritocratie ». Cette crise pourrait s’entendre en deux sens : sous la pression d’un amour mal avisé de l’égalité, nous aurions progressivement sapé tous les ressorts de l’excellence et de la grandeur humaine. Mais subissant, par ailleurs, l’attrait exclusif des grandeurs matérielles, nous aurions également perdu le sens des qualités morales et intellectuelles qui méritent vraiment d’être honorées.
Cette crise me semble effectivement avérée, et si elle est grave, c’est justement dans la mesure où le mérite occupe une place centrale dans notre régime social ou politique. Seule une apparence de mérite peut nous faire accepter l’inégalité sociale ; seule une apparence de mérite nous fait désigner certains candidats aux plus hautes fonctions. La crise du mérite est donc la crise même de notre régime. Aussi, je comprends mal l’intention dernière de ceux qui accusent la « tyrannie du mérite ». Il y a assurément un dévoiement du mérite lorsqu’il est solidaire de critères arbitraires, et qui ne sont accessibles que sur la base de ressources matérielles considérables. Mais que pouvons-nous mettre à la place du mérite ? La seule option viable, à ce qu’il me semble, serait effectivement de restaurer et d’assainir notre rapport au mérite. Par quels moyens ? À cette question générale, je ne puis répondre que par des principes généraux : nous devons simplement savoir quels sont les titres réels à exercer une fonction déterminée (un diplôme de management donne-t-il par exemple un titre à diriger des ouvriers expérimentés ?) ; et nous devons cultiver le goût des diverses excellences humaines, au lieu de les sacrifier à l’amour de l’égalité, ou à une vision trop exclusive, trop scolaire ou trop étroite du mérite.
À lire également
Hegel et la philosophie du droit. Entretien avec Thibaut Gress