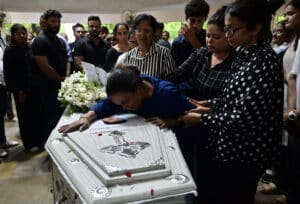À l’aube du xixe siècle, le naturaliste allemand Alexandre Humboldt et son homologue français, Aimé Bonplan, font leur premier pas en Amazonie. Fascinés par son exubérance naturelle, les deux scientifiques imaginent, non sans une certaine candeur, qu’elle deviendra un jour le grenier du monde. Croyaient-ils si bien dire en présageant le formidable destin qui allait effectivement être réservé à cette aire tropicale au cours des prochains siècles ?
François Soulard
Exceptionnellement dotée en ressources et géographie inséparable du nationalisme brésilien, l’Amazonie a traversé les âges en empilant un à un les enjeux stratégiques qui prirent forme au gré de la mondialisation. Depuis plusieurs décennies, elle est au centre d’une architecture de prédation d’un nouveau genre, dont le fonctionnement est inséparable de l’action des organisations non gouvernementales.
L’implantation du décor
Trois séquences historiques nous permettent de comprendre le décor dans lequel les ONG évoluent en tant que protagonistes majeures de l’aire tropicale sud-américaine.
La première a lieu au début du xxe siècle, lorsque la compagnie nord-américaine Ford est saisie d’engouement par la présence du caoutchouc naturel. L’hévéa constitue alors une matière première de l’industrie pneumatique destinée à un marché chimique et automobile en plein essor. Tandis que la cité ouvrière Forlândia émerge en pleine forêt tropicale, la société achète des terres en soudoyant les propriétaires et pratique la contrebande de semences d’hévéa, sous couvert de la fondation Ford qui sert de paravent à ces activités. Avant d’être pincée par les douanes, la manœuvre est dénoncée précocement en 1928 par le prêtre Cicero et le journal O Estado, qui s’alarment contre ce type de menace pesant sur le Brésil. L’apparition du caoutchouc synthétique après 1930 met un terme à l’affaire, mais n’entame en rien l’implantation de la fondation Ford.
La deuxième séquence nous projette en 1947, lorsque l’Unesco et l’administration brésilienne dressent les plans de l’Institut international de la forêt amazonienne. À l’inverse du protectionnisme défendu par les gouvernements antérieurs, l’exécutif du moment, conduit par le président libéral Eurico Gaspar Dutra, est favorable à l’initiative. Sur le papier, l’objectif de cet institut est de promouvoir des recherches scientifiques sur le patrimoine vivant dans la vague perspective de contribuer au développement socioéconomique de la région. Le projet constitue une priorité pour l’Unesco et a été conçu sous la bienveillance du nord-américain Julian Huxley, membre actif des courants eugénistes et malthusiens, plus tard fondateur du Fonds mondial pour la nature (WWF). Julian Huxley fait partie des prospectivistes anglo-saxons qui s’affairent à poser les bases d’un nouveau leadership mondial des États-Unis dans l’après-Seconde Guerre mondiale, en puisant dans différents corpus doctrinaires, notamment le post-nationalisme, l’eugénisme, l’écologie conservatrice et le malthusianisme. Au risque de contrarier notre sujet, l’institut n’est pas à proprement parler une organisation non gouvernementale, car il suppose un traité international établi entre les pays mitoyens de l’aire amazonienne[1]. À tort ou à raison, le projet est cependant perçu comme une manœuvre d’ingérence « néo-gouvernementale[2] » par une fraction nationaliste du pays. Cette dernière, qui trempe au même moment dans la campagne « O petróleo é nosso » (le pétrole reste à nous) impulsée par le président Getúlio Vargas, subodore une action d’internationalisation de l’Amazonie sous couvert de l’Unesco. Les parlementaires de Brasilia s’opposeront finalement au projet de l’institut.
Le troisième épisode se tient à la fin des années 1960, lors de la création du Centre brésilien d’analyse et de planification (Cebrap) et du décollage philanthro-capitaliste qui s’ensuivit. Au milieu de cette décennie, l’« Opération Amazonie » manifeste la volonté du gouvernement brésilien d’intégrer son versant occidental amazonien avec le reste du territoire, démontrant à nouveau une préoccupation nationaliste face aux risques d’internationalisation. Dans l’intervalle, de nouvelles ressources minières et pétrolières ont été identifiées en Amazonie et s’ajoutent à celles pourvues par sa biosphère. En écho au nouvel agenda de conservation plébiscité par l’Organisation des Nations unies, l’intelligence nord-américaine, adoubée par les compagnies Standard Oil et Shell, tente en vain de neutraliser le développement de la compagnie pétrolière brésilienne (Petrobras). Le bras de fer géoéconomique permet néanmoins aux États-Unis de tuer dans l’œuf l’important projet de pôle pétrochimique Petroquisa.
Dans la foulée, le Cebrap est fondé en 1969, en collusion[3] avec l’intelligence nord-américaine (CIA), la fondation Ford, et l’universitaire brésilien Ferdinand Henrique Cardoso, dont la carrière atteindra vingt ans plus tard la cime du pouvoir, sur fond de réticence non dissimulée envers la culture militaire brésilienne. En parallèle à la création du centre, la fondation Ford devient rapidement une plaque tournante locale en matière de formation des élites, d’élaboration de connaissances, de coopération multiacteur et de financement philanthropique. Les subventions qu’elle attribue sont multipliées par cinq de 1960 à 1964 (18 millions de dollars) et sont destinées non seulement à la société civile, mais aussi aux universités et certains projets gouvernementaux. Entre 1969 et 1975, le Cebrap perçoit une somme avoisinant un million de dollars de la part de la fondation Ford. Il forme les cadres du Parti des travailleurs (PT) et d’autres partis démocrates ou socialisants, en contradiction étonnante avec l’hostilité déclarée par le bloc ouest de la guerre froide envers tout élément marxisant. Après le lancement de la Commission trilatérale en 1973, il devient une cheville ouvrière de l’agenda des fondations Ford et Rockefeller, du Club de Rome et de l’ONU. Son agenda se positionne sur des enjeux relativement stratégiques : la démographie, l’éducation, la sécurité, la participation démocratique, l’indigénisme, la protection environnementale, le climat et les approches du développement. Dans les années 1990, l’arrivée de Fernando Henrique Cardoso au sommet de l’État conduit à ouvrir encore plus grand les vannes d’influence des ONG européennes et anglo-saxonnes.
À lire également
Podcast. Géopolitique de l’Amazonie
Le paysage contemporain
Ces trois étapes généalogiques ont la vertu de nous plonger dans les entrailles d’une ossature stratégique qui pivote intimement sur les acteurs non gouvernementaux. La séquence qui se déroule aujourd’hui sous nos yeux pourrait se résumer à une montée en gamme et à une maturité des mécanismes qui viennent d’être exposés. Les entités non gouvernementales, infiniment plus nombreuses et ramifiées, dessinent un véritable État parallèle, avec près de 100 000 ONG recensées[4] dans le périmètre de l’Amazonie brésilienne, tout type d’organisation confondu.
En matière de modus operandi, la mécanique d’ensemble poursuivie par cette superstructure rejoint celle de la logique duale du visage de Janus. La face visible, ostensiblement exposée, œuvre en continu à créer un cadre perceptif favorable et à blanchir, aux yeux de la société, les objectifs poursuivis par l’action non gouvernementale, en prise plus ou moins consistante avec les réalités amazoniennes et les défis planétaires. Nous avons vu que ce cadre perceptif est conditionné par un intense flux idéologique, construit du niveau local au niveau global. La deuxième face, occultée et inavouable, relève du continuum opérationnel qui se déploie entre les centres stratégiques des puissances tutélaires et les acteurs civils locaux, avec ce que cela suppose de cohésion, de transfert de ressources et de maillages intermédiaires. Les ONG qui prennent part à cet agenda qui forment l’interface entre ces deux réalités.
Les grands opérateurs, qui occupent la fonction essentielle de plaque tournante et de « blanchiment civil » de toute action transnationale offensive, se sont sensiblement diversifiés. La fondation Ford, pionnière en la matière, continue d’en être, aux côtés de l’Open Society, de l’USAID, du WWF, du National Endowment for Democracy, des fondations Rockefeller et Bill & Melinda Gates. Plus près de la population, une vaste constellation d’entités locales tisse une toile agencée selon des coalitions thématiques et territoriales. Celles-ci établissent un second et un troisième cercle opérationnel, ayant pignon sur rue avec les médias et l’opinion publique.
D’autres matrices d’influence se superposent avec cette hydre à deux visages. Si chacune mériterait d’être examinée à la loupe, la matrice anglo-saxonne remporte sans équivoque la palme d’or du grand dessein géopolitique. Elle excelle dans l’art de transformer subrepticement les soubassements stratégiques des États sud-américains, de manière coordonnée et pérenne sur le long terme, l’Amazonie constituant le centre de gravité d’une démarche offensive visant à neutraliser le développement des pays sud-américains et à en internationaliser les ressources.
À lire également
Le crime organisé colonise l’Amazonie. L’expansion d’un État parallèle
Bilan stratégique
Force est de constater que les effets de cette superstructure sont aussi pénétrants que remarquables. À défaut d’être placée sous tutelle, la « main de Janus » environnementale et l’indigénisme ont mis l’Amazonie sous emprise internationale. Près de la moitié de la superficie du Brésil est pour ainsi dire sanctuarisée par le truchement des dispositifs de protection de l’écosystème humain ou écologique, y compris de crédit carbone. Le dernier projet en date, banni par cette chape normative, fut le tronçon autoroutier BR-319[5], reliant Manaus à Porto Velho. Par ailleurs, l’action néo-gouvernementale sur les appareils législatifs et politiques a graduellement modifié les approches de planification. Les notions de responsabilité partagée, de devoir de coopération avec les pays développés et de gouvernance participative ont insufflé un nouveau référentiel de l’action publique. En sus de cet impact sur les modes d’action, l’agenda politique s’est élargi à l’ensemble des thématiques importées verticalement de la matrice d’influence.
L’effet le plus incisif concerne certainement la « reprogrammation » idéologique des élites sud-américaines. Dans le cas brésilien, l’actuel président Luiz Lula da Silva, la ministre de l’Environnement Marina Silva, ainsi que d’autres responsables politiques en exercice, ont été les fidèles serviteurs de la déclinaison de cet agenda transnational dans l’appareil stratégique brésilien. À partir des années 1990, ces idéologies exogènes ont été intériorisées par toute une génération de dirigeants et ont percolé dans l’appareil médiatique dominant. Une dépendance systémique de ce type relève davantage d’une guerre par le milieu social[6] que d’un simple agenda d’influence.
Une telle conflictualité n’est pas sans provoquer des résistances. En 1990, une commission d’enquête parlementaire pointa ouvertement les manœuvres internationales visant à « démoraliser et faire du Brésil un paria, blâmé pour son action destructrice de l’Amazonie et par conséquent de toute l’humanité ». En 2023, la commission parlementaire sur les ONG et des rapports de l’intelligence brésilienne débouchèrent sur des conclusions comparables. Devant de tels réflexes, l’arène politico-médiatique, traversée par des divisions faussement antagonistes, travaille en réalité de concert pour neutraliser la résurgence de toute figure nationaliste, comme ce fut le cas avec Jair Bolsonaro.
Soulignons enfin que cet agenda néo-gouvernemental est en recherche d’accélération. Il agite le spectre de l’urgence climatique et sanitaire autour de l’Amazonie pour pousser encore plus loin les ruptures normatives. Dans ce sens, les inondations de Rio Grande do Sul d’avril 2024 et les incendies en Amazonie[7] nous montrent une distance de plus en plus ténue entre les risques naturels et l’usage qui en est réalisé à des fins conflictuelles.
À lire également
L’Amazonie : un espace mal connu
[1] Brésil, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela, Suriname, Guyana et Guyane française.
[2] L’expression revient au sociologue Manuel Castells.
[3] CIA, Fundação Ford e Fernando Henrique Cardoso, https://mercado-global.blogspot.com/2008/02/eua-cia-e-brasil-o-preo-de-fernando.html
[4] https://mapaosc.ipea.gov.br
[5] https://www.opoder.com/executivo/ong-financiada-por-george-soros-impede-na-justica-obra-da-br-319
[6] Raphaël Chauvancy, « Le political warfare ou la guerre par le milieu social », https://www.revueconflits.com/le-political-warfare-ou-la-guerre-par-le-milieu-social/
[7] Voir François Soulard, « Brésil. Les flammes aux portes de São Paulo », site de Conflits, 29 août 2024.