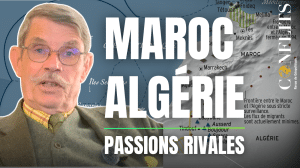Peu de batailles ont connu une issue aussi définitive que celle livrée au Maroc, le 4 août 1578, en particulier pour ses principaux protagonistes, puisqu’aucun des trois rois qui commandaient les armées n’y a survécu. Et ses conséquences géopolitiques ne furent pas moins décisives.
Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée
Les plus illustres parmi les quelque 18 000 victimes de cette journée étaient le roi de Portugal Sébastien Ier, qui n’avait pas 25 ans, son allié Muhamad al-Mutawakkil, ancien sultan du Maroc qui voulait reprendre le pouvoir, et leur adversaire du jour, le sultan en titre Abd al-Malik. Comme une partie d’échecs se terminant par un double – ou triple – mat[1] ! Longtemps dénommée de ce fait « Bataille des trois rois », ou bataille de Ksar el-Kébir, en Europe, elle mérite davantage son nom marocain, car le lieu du combat est à plus de 20 km de la ville fortifiée éponyme, au nord du pays, entre le fleuve Loukos et l’oued al-Makhazin, l’un de ses affluents.
L’empire du soleil levant
Nos souvenirs du xvie siècle sont dominés par les explorations ibériques et la conquête du Nouveau Monde, par le formidable élan créatif de la Renaissance et par le séisme de la Réforme protestante, rupture d’unité de la chrétienté dont les répliques déchirèrent l’Europe pendant plusieurs siècles. Mais dans l’esprit des contemporains, en particulier en Méditerranée, la préoccupation centrale fut sans conteste la montée en puissance de l’Empire ottoman et les rivalités qu’elle suscita avec les puissances chrétiennes : la République de Venise, la Papauté, ou encore l’Espagne, qui dominait aussi l’Italie du Sud, la Sicile et la Sardaigne. Fondée à la fin du xiiie siècle en Anatolie, la dynastie ottomane se lança à la conquête de l’Europe, occupant les Balkans à partir de 1354. Un siècle plus tard, Constantinople tombait entre ses mains avec les ultimes débris de l’Empire byzantin (1453). Sous Selim Ier (sultan de 1512 à 1520), l’expansion de l’empire, désormais solidement installé autour de la mer Égée et de la mer Noire, se tourne vers l’Orient (Syrie, Arabie) et vers l’Afrique du Nord (Égypte, Cyrénaïque). Selim reconnaît aussi le corsaire Barberousse[2] comme régent d’Alger pour faire face à la poussée de la présence espagnole dans le Maghreb, dans la foulée de l’achèvement de la Reconquista (1492, prise de Grenade).
Le fils de Selim, Soliman Ier (1494-1566) connu dans l’histoire comme « le Magnifique », poursuivit les conquêtes dans toutes les directions, achevant notamment celle de la Tripolitaine, soumettant ainsi la quasi-totalité du Maghreb à la suzeraineté turque, à l’exception de la régence de Tunis, tenue tant bien que mal par la dynastie hafside avec le soutien de l’Espagne, et du Maroc, où la dynastie saadienne, également aidée par Charles Quint et son fils Philippe II combat farouchement les poussées ottomanes depuis l’Algérie. Le sultan Mohammed ech-Cheikh (1544-1557) est d’ailleurs assassiné sur ordre de la Porte par des sbires venus d’Alger. Après le règne apaisé de son fils, Abdallah el-Ghalib (1557-1574), le fils de ce dernier, Al-Muttawakil, se proclame sultan malgré la règle successorale désignant son oncle, Abd-al Malik, qui le chasse avec l’appui d’une armée ottomane. Al-Muttawakil fuit alors au Portugal, où le jeune roi Sébastien Ier rêve de se lancer dans une croisade contre les Turcs.
La période semble en effet propice : la fin du règne de Soliman a été marquée par deux échecs, devant Malte (1565) puis dans une expédition vers Vienne, interrompue par la mort du sultan (1566). En 1571, la Sainte Alliance a remporté une grande victoire navale à Lépante[3] : les chrétiens ont le vent en poupe, mais les Ottomans reprennent l’offensive, obtiennent la cession de Chypre (1573) et réoccupent Tunis en 1574, alors que la ville avait été reprise l’année précédente par le vainqueur de Lépante, don Juan d’Autriche.
Sébastien, né en 1554, roi en titre depuis 1557, mais ayant laissé le pouvoir à des régents jusqu’à sa majorité, en 1568, est désireux de reconstituer l’empire portugais en Afrique du Nord, là où il a commencé, alors qu’il prospère désormais en Afrique australe et dans l’océan Indien. C’est en effet par la conquête de points d’appui sur la côte marocaine, dès 1415, que le Portugal a entamé le contournement de l’Afrique, achevé près d’un siècle plus tard par Bartolomeo Dias. Depuis, Vasco de Gama a gagné les Indes, mais le Maroc a récupéré la plupart des présides, ces points d’appui côtiers, à la fois ports et fortins, occupés par les Portugais, à l’exception de trois : Ceuta, Tanger et Mazagan (aujourd’hui El Jadida).
La dernière croisade
La combinaison du caractère belliqueux de Sébastien et d’une atmosphère mêlant exaltation religieuse et crainte du déclin de la puissance lusitanienne l’incite aux expéditions téméraires. Il s’efforce d’obtenir le soutien de Philippe II, mais le fils de Charles Quint conseille plutôt la prudence et préférerait préserver un Maroc indépendant. Il semble surtout préoccupé par l’insurrection des Provinces-Unies, qu’il espère réduire en envoyant don Juan d’Autriche comme gouverneur général et Alexandre Farnèse comme commandant militaire[4]. Il a d’ailleurs éconduit Al-Muttawakil, qui était venu le solliciter avant de se tourner vers le Portugal, où il trouve un accueil bien plus enthousiaste.
Pourtant, c’est un peu à contrecœur que les principaux dirigeants portugais acceptent de soutenir le projet royal. Aucune grande puissance du temps n’étant prête à aider le Portugal – l’Espagne ne veut pas remettre en cause le statu quo en Afrique et la France est absorbée par les guerres de religion –, il faut compter sur des volontaires de toute l’Europe et des mercenaires, notamment flamands. Le contingent des partisans du sultan déchu est très limité, ce qui fait que le corps expéditionnaire qu’emmène Sébastien depuis Lisbonne, le 24 juin 1578, compte sans doute tout juste 20 000 combattants, mais de nombreux suiveurs (femmes, serviteurs, religieux exaltés par l’idéal de la croisade…) qui pèseront sur la logistique improvisée de l’expédition.
La date même de l’appareillage prouve une impréparation coupable : conduire des opérations militaires en plein été au Maroc avec des soldats lourdement équipés et cuirassés et un contingent important de chevaux expose hommes et bêtes à un surcroît de fatigue et à des risques de pénurie de ravitaillement. Le même aveuglement conduira les Portugais à accepter de livrer bataille en pleine journée, le 4 août, après une semaine de marche dans l’intérieur du pays depuis leur point d’appui côtier.
Le débarquement portugais à Tanger ne prit pas le sultan au dépourvu : Abd-al Malik avait même proposé des concessions territoriales à Sébastien pour le dissuader d’intervenir. Face à l’invasion, il réunit une armée de 30 000 réguliers et d’environ 20 000 volontaires et proclame le djihad (la guerre sainte) pour mobiliser les populations. Malade, il laisse son frère assurer le commandement effectif de l’armée, mais tient à suivre les opérations tout en poursuivant des ouvertures diplomatiques qui ne font que conforter Sébastien dans la certitude de sa supériorité et de la peur qu’il inspire à son adversaire. Après avoir progressé le long de la côte jusqu’à Asilah, à mi-chemin entre Tanger et Larache, pour garder l’appui de sa flotte, le jeune roi néglige l’avis de ses conseillers qui recommandent de continuer ainsi jusqu’au grand port de Larache et de prendre la ville pour y constituer une base logistique : il décide de progresser dans l’intérieur pour marcher droit à l’ennemi, localisé vers Ksar el-Kébir, en suivant les rivières encore en eau, dont le fleuve Loukos. Les deux armées se rencontrent au confluent du Loukos et de l’oued Makhazin, dans un site aujourd’hui noyé sous un grand lac de retenue.
D’un presque succès au « malheur exemplaire »
L’armée portugaise s’appuie sur des formations compactes d’infanterie associant piquiers et arquebusiers, à l’image des tercios espagnols, placées au centre du dispositif, derrière la quarantaine de canons alignés en une seule grande batterie. En arrière et sur les flancs sont disposées les charrettes des bagages et des suiveurs, autant pour gêner les assaillants que pour bloquer un éventuel mouvement de panique des premières lignes. La cavalerie – environ 2 000 nobles portugais et 600 cavaliers marocains – est répartie aux deux ailes à parts sensiblement égales, le roi lui-même commandant l’aile gauche avec ceux qu’il appelle ses « chevaliers » – signe supplémentaire de sa nostalgie d’un Moyen Âge fantasmé. Disposant d’une nette supériorité numérique, le sultan dispose ses troupes en croissant pour envelopper le dispositif portugais, mais ne peut sans doute le déborder du fait de la présence des cours d’eau aux deux ailes. Ses troupes sont massivement constituées de cavaliers, de qualité inégale toutefois, mais le centre s’appuie sur un noyau de 15 000 solides fantassins, équipés de façon moderne, et renforcés d’une trentaine de canons.
Ce sont les musulmans qui lancent la première attaque, repoussée par les Portugais. Sébastien déclenche alors une contre-attaque avec ses chevaliers, en recommandant apparemment au reste de l’armée de conserver ses positions. La nouvelle de la mort d’Abd-al Malik, terrassé par sa maladie, ébranle alors l’armée marocaine, et les Portugais commencent à crier victoire. Mais le contingent royal s’est isolé dans les lignes ennemies, et un ordre de retraite circule, au moment où les musulmans contre-attaquent. Les Portugais perdent pied, et les Marocains qui les poursuivent emportent dans la foulée l’artillerie et les unités du centre. C’est au cours de cette mêlée furieuse que le roi Sébastien est tué, dans des circonstances impossibles à préciser. Al-Muttawakil, lui, se noie dans l’oued al-Makhazin en essayant de fuir – retrouvé, son corps sera écorché et empaillé pour être exposé dans plusieurs villes marocaines.
À lire aussi : Discours du Trône 2025 : Le roi du Maroc tend la main à l’Algérie
La défaite fut une véritable catastrophe pour le Portugal. Le pays perd sur les rives du Loukos la fine fleur de sa noblesse et l’essentiel de son armée – à peine une centaine de Portugais regagnent Lisbonne. Célibataire, Sébastien laisse le trône à son grand-oncle, le cardinal Henri, que le pape ne relève pas de ses vœux et qui décède à son tour sans enfant dès 1580. Philippe II d’Espagne, petit-fils de Manuel Ier par sa mère Isabelle, s’impose comme nouveau roi manu militari, réalisant pour soixante ans l’Union ibérique des deux couronnes de la péninsule (1580-1640), et des deux plus vastes empires coloniaux de l’époque. Ce traumatisme national et les circonstances confuses de la mort et des funérailles de Sébastien, dont le corps n’est rapatrié qu’après 1580, furent à l’origine d’une floraison de « faux Sébastien » jusqu’à la fin du xvie siècle et d’un messianisme socio-politique, le « sébastianisme », qui s’étendit jusqu’au Brésil.
En Afrique, l’échec de la « dernière croisade de la Méditerranée », comme l’appelait Fernand Braudel, consacrait la position singulière du Maroc, désormais aux mains d’Ahmad al-Mansour, le général victorieux de la « bataille des trois rois », qui a écarté ses deux neveux pour succéder à son frère. Indépendant des puissances ibériques, il peut aussi se préserver d’une suzeraineté ottomane, tout en remerciant la Porte pour l’aide qu’elle lui a apportée. L’influence européenne au Maghreb se limiterait désormais aux quelques présides restants : Tanger, Mazagan (que le Portugal conserve jusqu’en 1769), ou encore Ceuta et Melilla, qui sont aujourd’hui encore espagnoles, ainsi que trois presqu’îles ou archipels le long des côtes marocaines. En 2002, l’îlot Persil (ou Leïla) fut au centre d’une crise diplomatico-militaire entre les deux pays – et ce n’était pas pour vérifier s’il s’agissait bien de l’île d’Ogygie, le repaire des amours de Calypso et d’Ulysse.
[1] L’expression « échec et mat », qu’utilise le joueur qui gagne une partie d’échecs, vient probablement d’une phrase arabe signifiant « le roi est mort ».
[2] Déformation phonétique de « baba Oruç » ou père Oruç, selon son nom turc qui se prononce Oroutch.
[3] Voir Conflits n° 31 (janv-fév. 2021), p. 38-40.
[4] Victorieux à Gembloux le 31 janvier, don Juan subit une défaite à Rijmenam trois jours avant la bataille des trois rois. Il se replie à Namur, où il meurt du typhus, le 1er octobre, à 31 ans.