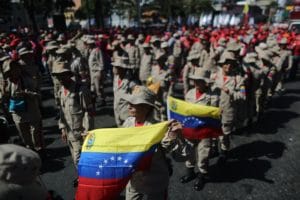La France dispose de nombreux laboratoires et entreprises pharmaceutiques, grâce à une histoire ancienne dans ce secteur. Contribuant au développement de leurs régions, elles sont pleinement intégrées à la mondialisation.
L’épidémie du Covid-19 a mis en lumière le secteur pharmaceutique français, qui est l’une des industries de pointe de l’économie française. Alliant chimie et médecine, l’industrie pharmaceutique se décline dans des activités d’une grande diversité : médicaments, nutriments, hygiène, produits vétérinaires pour les animaux domestiques et d’élevage. En 2018, la France comptait 240 usines pharmaceutiques, réparties sur l’ensemble du territoire. Si trois régions se distinguent – Lyon et la vallée du Rhône, la Normandie et le Val de Loire-, la caractéristique de l’activité pharmaceutique est d’avoir des unités de production sur l’ensemble du territoire et dans des petites villes de province. Les 60 plus grosses usines sont ainsi réparties dans 36 départements, avec en tête le Rhône (7 usines) puis l’Oise, le Calvados, l’Allier et l’Indre-et-Loire (3 usines chacun). Ces usines échappent à la concentration urbaine et préfectorale ; beaucoup se trouvent dans des villes petites ou moyennes, ce qui donne une répartition particulière à cette industrie, qui concentre des hauts talents et des métiers pointus et spécifiques. De nombreuses villes de moins de 10 000 habitants sont le siège d’usines importantes, comme Saint-Victor (laboratoire Bouchara, Allier), Notre-Dame de Bondeville (Aspen, Seine-Maritime) ou Gidy (Servier, Loiret). C’est l’ensemble du territoire national qui est ainsi maillé par des usines pharmaceutiques, surtout quand on y ajoute les secteurs de l’hygiène et des soins corporels. Quand il recouvre les domaines de la parfumerie et des cosmétiques, ce secteur intègre les activités du luxe et du tourisme, comme peuvent le faire des entreprises comme Caudalie, Nuxe ou Roger & Gallet.
Au total, la France compte 8 600 entreprises pharmaceutiques, réalisant un chiffre d’affaires de 95,7 milliards d’euros et employant 161 000 emplois directs. Plus de 60 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’exportation, ce qui en fait une industrie originale : très implantée localement, développant des produits liés à un terroir précis, mais complètement ouvert sur le monde et la mondialisation. Hormis Sanofi, émanation d’Elf Aquitaine en 1973 et aujourd’hui troisième mondial dans le secteur de la santé, cette industrie est composée, pour une grande partie, par des groupes fondés par des pharmaciens dont beaucoup sont encore dirigés par leurs descendants. Yves Rocher, Jacques Servier, Louis Aguettant, Eugène Fournier (Urgo), Pierre Fabre, Eugène Poulenc (Rhône-Poulenc puis Rhodia), Marcel Guerbet, Christian Boiron, etc., autant de noms d’hommes de science et d’entrepreneuriat qui ont développé des produits innovants favorisant la santé et l’amélioration des conditions de vie. À la santé humaine s’adjoint la santé animale, essentielle pour le maintien d’une agriculture de qualité. L’élevage d’animaux de bouche et d’animaux de sport (équitation) est redevable de la médecine vétérinaire.
A lire aussi: Coronavirus : la sécurité alimentaire, la prochaine bataille de l’Asie dans un monde post-Covid
Si les chiffres d’affaires réalisés sont importants, les capitaux nécessaires à la recherche et au développement de nouvelles molécules le sont tout autant. Il ne peut y avoir de secteur pharmaceutique puissant sans des centres de recherche innovants et performants. L’économie de la connaissance et de la recherche est là aussi un domaine majeur. Si les grands groupes disposent de leurs propres laboratoires de recherche, la connexion est réelle avec les centres universitaires. La France attire également les investissements des entreprises étrangères, qu’elles soient américaines ou européennes. Mylan, Bayer, AstraZeneca, Glaxo, etc., trouvent dans la France non seulement un marché pour leurs produits, mais aussi un territoire de savoir-faire et d’excellence pour leurs recherches et leurs développements. La santé, qu’elle soit humaine ou animale, est un enjeu essentiel de souveraineté. Permettre le développement de ces entreprises et ne pas entraver leur essor et leur innovation est donc primordial pour un pays qui aspire compter sur la scène mondiale.