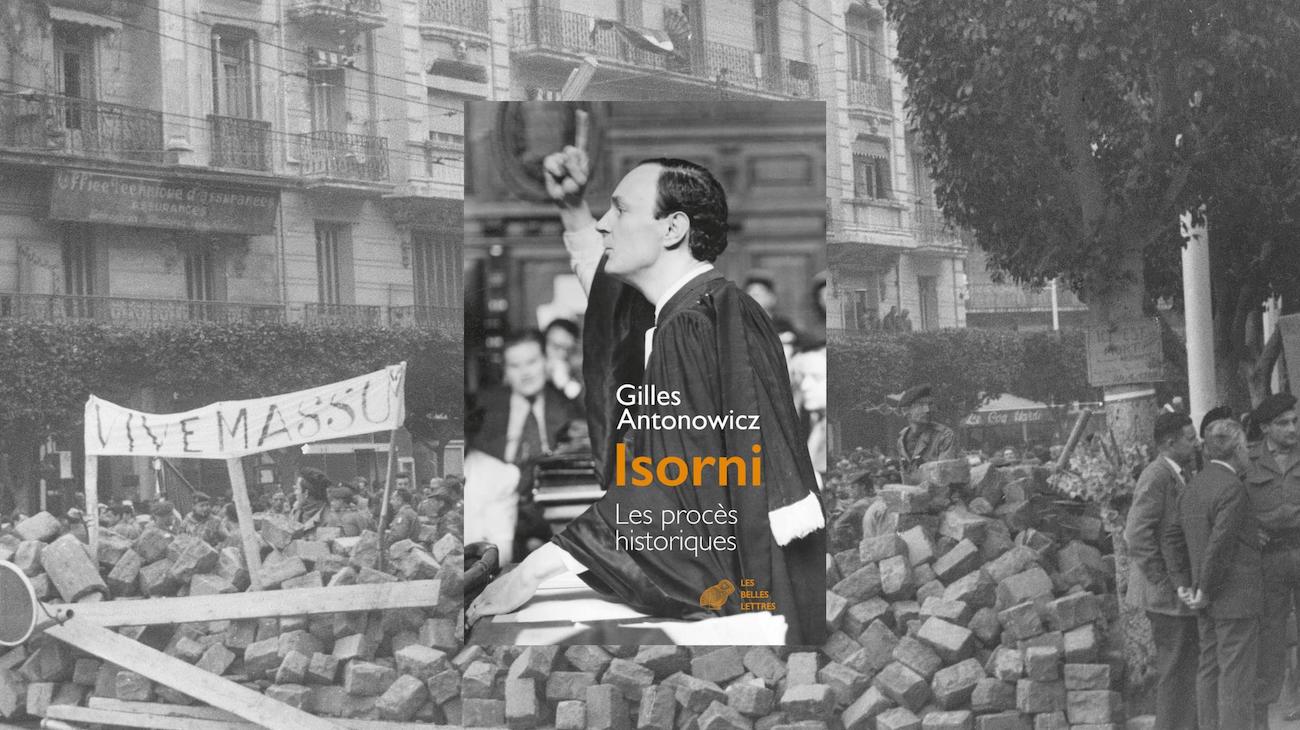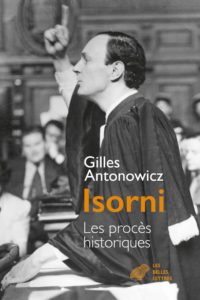Depuis qu’il a quitté le prétoire, l’avocat Gilles Antonowicz écrit. Quelle aubaine pour les historiens de la vie politique que ce truchement dans l’univers de combat théâtralisé qu’est un tribunal…
Gilles Antonowicz, Isorni. Les procès historiques, Paris, Les Belles lettres, 2021, 308 p.
Après avoir consacré des études à des affaires contemporaines (comme celle d’Outreau), maître Antonowicz est devenu, ouvrage après ouvrage, historien des grandes causes judiciaires et politiques des années 1940 à 1960. L’étude qu’il a consacrée à Pierre Pucheu aurait mérité plus d’attention que ne lui ont accordée les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale[1]. Il a persévéré et poursuivi l’analyse de procès qui ont révélé de grands avocats pendant cette période, Maurice Garçon[2] et Jacques Isorni, ce dernier défenseur des causes perdues.
Dans un pays si prompt à se cliver, la façon dont se bat un avocat au cours d’un procès politique est fascinante. On demande à des jurés de se prononcer au nom du peuple français, mais, le temps d’une guerre, l’opinion de ce peuple est soumise à de rudes pressions. Les jurés seront d’abord choisis parmi les fervents du Maréchal. Trois ans plus tard, ils seront sélectionnés pour leur proximité du Général et de la Résistance. Et quelle est la nature de la cour, quels rapports entretient-elle avec les dirigeants successifs ? La lecture des travaux de Gilles Antonowicz dresse un catalogue des irrégularités et des aveuglements qui affectent une démocratie quand elle exploite la justice à son gré.
À lire également
Nouveau Numéro : Nucléaire l’atome, futur des armées et de l’énergie ?
Quelle que soit la cause, des communistes à Pétain
Après de premiers attentats contre les troupes d’occupation, à l’été 1941, les autorités allemandes ont exigé des condamnations exemplaires et, cédant au chantage, l’État français a créé une juridiction d’exception pour réprimer le « terrorisme communiste ». Jacques Isorni accepte de défendre communistes et résistants devant les sections spéciales. Défense bénévole ; rares étaient les avocats commis d’office qui ne se dérobaient pas. À ce devoir, rien d’autre à gagner que des ennuis.
La guerre finie, après un chassé-croisé de prisonniers, il défend une nouvelle espèce d’inculpés. « Tout ce qui a été hostile au communisme est déclaré bon à pendre », écrit Maurice Garçon dans son Journal, quand le bâtonnier Charpentier compte « cent vingt-six mille personnes emprisonnées, la plupart l’étant sans mandat judiciaire, à l’initiative de comités constitués par on ne sait qui, submergés sous un flot de dénonciations[3] ». De nouvelles juridictions d’exception apparaissent dont « les jurés [résistants et déportés] sont en définitive choisis pour des raisons qui, en temps normal, les auraient fait récuser. Comment demander à des victimes d’être des juges[4] ? »
Dans ce contexte scabreux, Jacques Isorni gagne la célébrité en devenant successivement « le défenseur d’André Chénier et celui de Louis XVI ». Brasillach sera le poète et Pétain le monarque.
En janvier 1945, en défense de Brasillach, il rappelle au ministère public qu’il a aussi « été pendant quatre ans le parquet de la collaboration[5] », et qu’un verdict juste doit chercher à réconcilier la France. Peine perdue, Brasillach sera fusillé. Mais Jacques Isorni a mis en place les arguments qui structureront ses plaidoiries suivantes : le bon droit est fluctuant quand il s’agit de politique et le devoir de la justice serait de ne pas aggraver les fractures de la nation.
Quatre mois plus tard, il devient l’assistant de l’avocat principal de Pétain, le bâtonnier Fernand Payen, qui a choisi de fonder sa stratégie sur l’irresponsabilité de son client. Voilà qui ne fait pas l’affaire d’Isorni qui souhaite un procès historique ; ce sont la défaite, les années d’occupation, la collaboration et la résistance qui doivent servir de contexte aux débats, et non pas le gâtisme d’un très vieux soldat. Au service de ce plan, il agitera, lui aussi, des figures tutélaires. À Jeanne d’Arc, la résistante, il associera Geneviève qui négociait avec les Huns pour protéger Paris.
C’est à l’occasion de tels procès que le profane découvre qu’une salle d’audience est un champ clos où des hommes livrent bataille. Isorni doit d’abord parer les coups qui pourraient venir de son propre camp. Neutraliser l’avocat principal, qui s’oppose à son système de défense, contrôler l’accusé qui pourrait l’embarrasser. Le maréchal va sur ses 90 ans. L’allure est encore bonne, mais la mémoire ne suit plus, l’esprit n’est plus très vif. Isorni décide qu’il se taira après avoir lu une déclaration, ne reprenant la parole que pour une courte intervention finale, les deux textes rédigés par l’avocat. La défense pourra dès lors se concentrer sur ses adversaires en s’appuyant sur la thèse du double jeu, ce qu’on a aussi appelé le bouclier (la France libre représentant l’épée).
Le procès sera l’occasion de morceaux de bravoure pour les journalistes les plus connus, pour les journaux les plus vendus[6]. France-Soir titre « Le procès d’une trahison », et ce n’est pas le plus féroce. Maître Isorni parvient à revenir à la question : quelle est la légitimité des accusateurs et, Léon Blum excepté, il met dans l’embarras tous les témoins de l’accusation — un ancien président de la République, cinq anciens présidents du Conseil, des ministres, de hauts fonctionnaires, des élus, des officiers généraux et des amiraux, des ambassadeurs… Sont-ils donc irréprochables, n’ont-ils jamais été ‘maréchalistes’ ? L’avocat mène sa guerre et chaque journée est une phase de sa campagne qui s’achève sur une plaidoirie d’anthologie. « « Depuis quand notre peuple a-t-il opposé Geneviève, protectrice de la ville, à Jeanne qui libéra le sol ? Depuis quand, dans notre mémoire, s’entr’égorgent-elles, à jamais irréconciliables ? »
Le procès des barricades
Quinze ans plus tard, la guerre d’Algérie réactive les divisions de la France. Si la fin de la guerre d’Indochine avait confronté une partie des combattants aux camps du Vietminh, qui méritent une place dans la galerie des désastres de guerre, la guerre d’Algérie s’achève pour certains au tribunal, en prison et pour quatre d’entre eux, devant un peloton. À nouveau, l’avocat défend les vaincus.
Il intervient d’abord au procès dit « des barricades », qui présente devant leurs juges les responsables, principalement civils, de l’émeute qui s’est produite à Alger durant la dernière semaine de janvier 1960. À cette occasion, pas de drame au tribunal en dépit des morts du 24 janvier, mais beaucoup d’indulgence de la part des juges : les inculpés bénéficient du souvenir proche d’une autre émeute, celle du 13 mai 1958, qui a permis le retour de De Gaulle au pouvoir. Le régime des prisonniers a profité de cet embarras avant même les premières audiences.
« Le quartier politique de la Santé devient vite le dernier lieu à la mode. Les détenus y disposent d’un régime de faveur, sont autorisés à consommer de la bière, peuvent prendre leur déjeuner en commun le dimanche. Lagaillarde obtient même l’autorisation d’avoir un chat… Tout cela, reconnaît Isorni, tenait ‘autant du collège et de la caserne que de la maison d’arrêt[7]’. »
Que répondre à l’accusé Pierre Lagaillarde, lui aussi avocat, quand il rappelle qu’avant les barricades, il a comploté et même pris d’assaut le gouvernement général d’Algérie, le 13 mai, sans avoir jamais été inquiété ? La rébellion suivante ne pourra user de cet argument.
Les tribunaux d’exception
Entre le 22 et le 25 avril 1961, la révolte dont le général Challe a pris la tête se prononce et s’effondre. Le 27, le général de Gaule crée un Haut Tribunal militaire dont il désigne les membres, et « le 3 mai est créé dans les mêmes conditions un Tribunal militaire spécial […] chargé de juger les officiers subalternes. Les accusés sont renvoyés devant ces juridictions d’exception par décret gouvernemental et non par une décision judiciaire, chose que l’on n’avait plus vue depuis la création par Vichy du Tribunal d’État en 1941[8]… »
Cette fois, maître Isorni n’a plus seulement pour adversaires des juges dont il connaît les façons d’agir, qui appartiennent au même espace juridique que lui, mais le chef de l’État lui-même, qui crée les juridictions d’exception et les dissout, fait valider rétroactivement une ordonnance déclarée nulle par le Conseil d’État, entreprend de réformer celui-ci quand il se montre indépendant.
Lors du procès de l’attentat du Petit-Clamart, maître Isorni sera vaincu. « Le dossier est très particulier dans la mesure où de Gaulle se trouve être tout à la fois accusateur – via ses procureurs militaires –, juge – il a lui-même désigné ceux qui assumeront cette fonction –, plaignant – c’est lui la victime – et titulaire du droit de grâce… » Une dernière audace de l’avocat durant l’audience du 6 février 1963 lui vaut une suspension de trois ans, immédiate et sans appel. On gardera de cette carrière, pas encore achevée et néanmoins brisée, l’image de Jacques Isorni quittant à pas lents le prétoire entre une haie d’honneur improvisée tandis que les accusés et la défense entonnent le Chant des adieux[9].
À lire également
[1] L’énigme Pierre Pucheu, Paris, Nouveau Monde éditions, 2019, 428 p.
[2] Maurice Garçon. Procès historiques: L’affaire Grynszpan (1938). Les piqueuses d’Orsay (1942). L’exécution du docteur Guérin (1943). René Hardy (1947 et 1950), Paris, Les Belles lettres, 2019, 208 p.
[3] Isorni. Les procès historiques, p. 44.
[4] Ibid., p. 47.
[5] Ibid., p. 66.
[6] L’Humanité tire alors à 456 000 exemplaires.
[7] Isorni. Les procès historiques, p. 165.
[8] Ibid., p. 174.
[9] Pour une critique faite par un juriste de travaux historiques récents concernant l’attentat du Petit-Clamart, on consultera avec profit la recension d’Éric Gojosso, « Un attentat. Petit-Clamart, 22 août 1962, par Jean-Noël Jeanneney », Revue historique de droit français et étranger, janvier-mars 2018, vol 96, pp. 170-187.