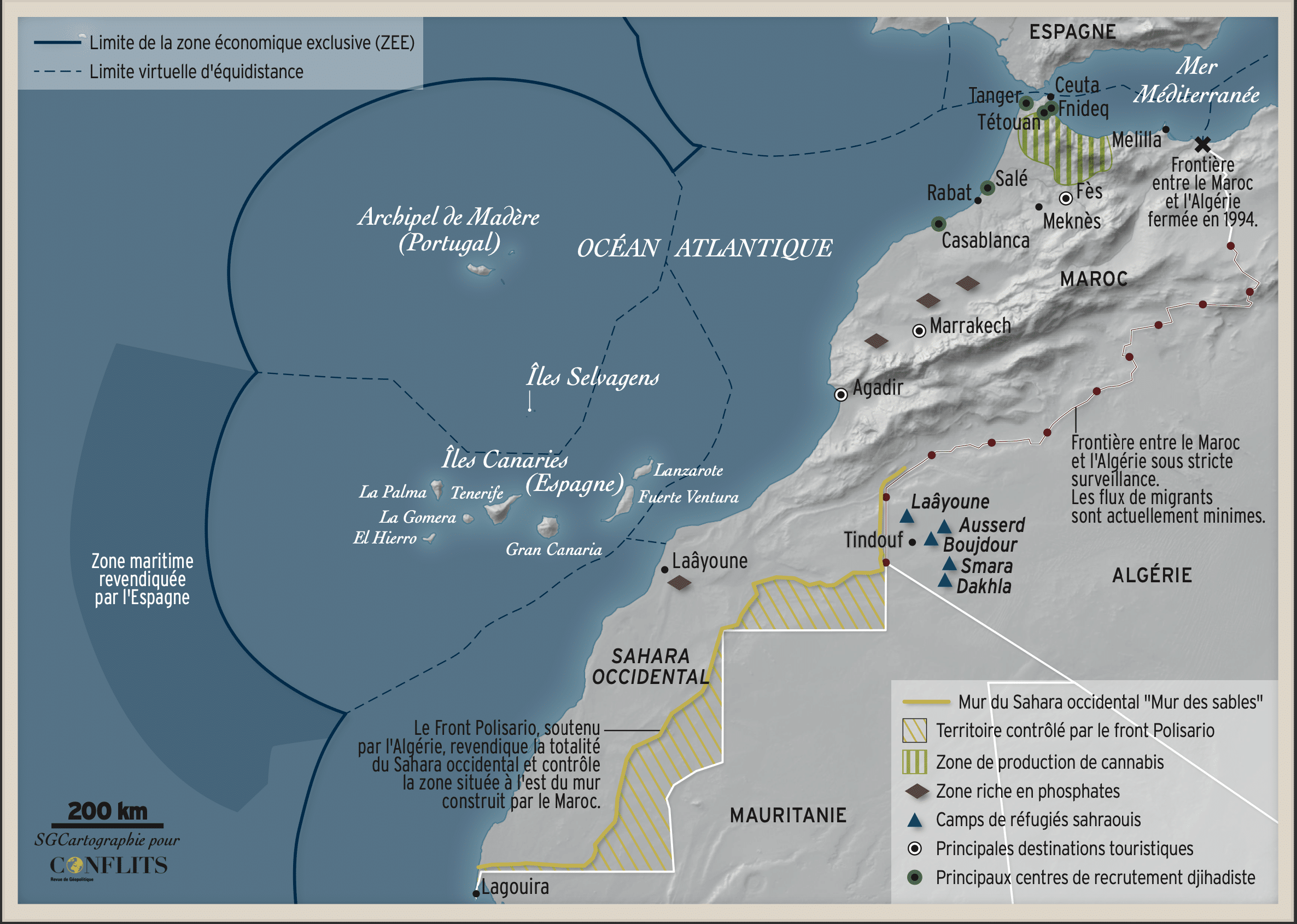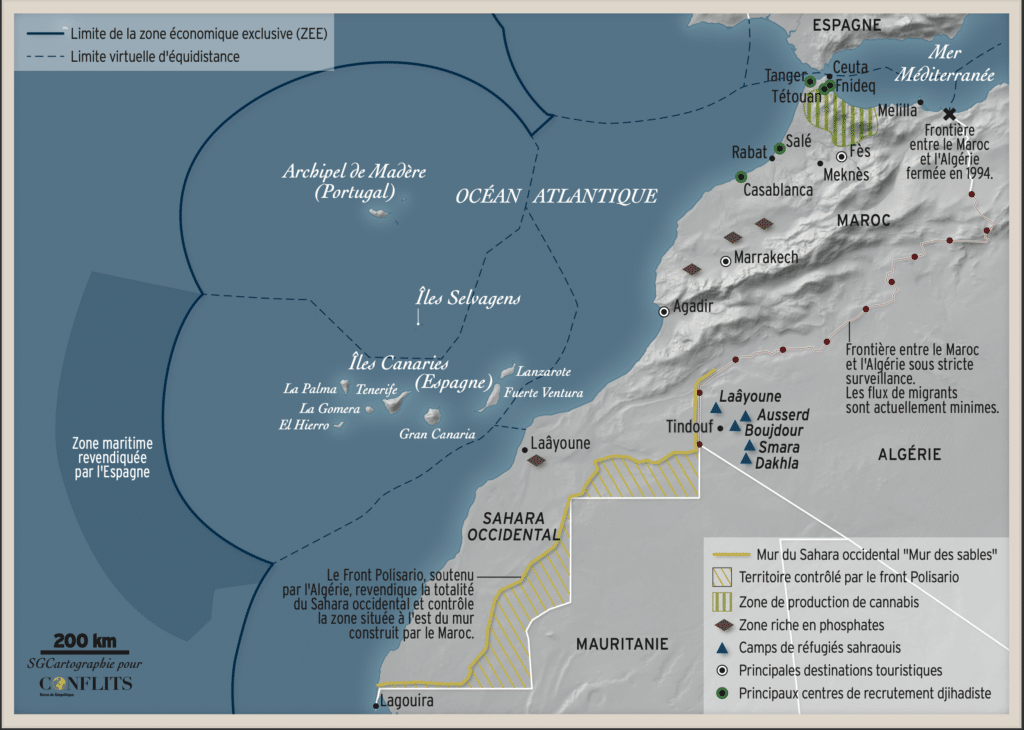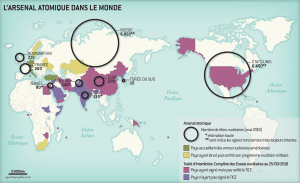Au Maroc comme en Algérie, la montagne est le lieu des irrédentismes et du refuge des identités. Le pouvoir central a toujours cherché à la contrôler, non sans mal.
La montagne marocaine a toujours abrité des populations refusant toute soumission aux différents pouvoirs centraux établis dans le plat pays.
Les sultans les plus énergiques se sont épuisés à lutter contre cette force centrifuge, produit essentiel de la montagne. Au Maroc, on distinguait traditionnellement un bled maghzen (bled pays, territoire), et un bled siba. Le premier signifiait l’espace dominé par le maghzen, appareil d’État qui dénomme à la fois l’endroit où l’on entrepose le produit de l’impôt (d’où vient le mot magasin), et surtout le groupe de tribus qui lève cet impôt, en contrôlant, sur un territoire plus ou moins vaste, les tribus assujetties. Le second désignait l’aire de dissidence ou les clans. Les montagnards sont assez forts pour refuser le paiement de l’impôt au maghzen, surtout lorsque celui-ci est en voie de décadence. Comme l’a expliqué l’historien maghrébin du xive siècle, Ibn Khaldoun, les tribus royales comme les dynasties se succèdent, chacune d’elles perdant au fil du temps son homogénéité du fait des dissensions internes où l’opposition entre bled maghzen et bled siba prend toute sa place. Il en résulte le déclin de l’asabiya, force de cohésion par rapport aux tribus rivales. Pour durer, l’appareil d’État tribal, fondé sur l’égalité et la solidarité, doit se conforter par des alliances avec le plus grand nombre de tribus, dont les montagnardes, ou en s’appuyant sur une cause religieuse et la confrérie qui la propage.
Diversité de la montagne
Ces considérations ne doivent cependant pas impliquer l’idée d’une population montagnarde isolée, ne participant en aucune façon à la vie dynamique des plaines alentour, ni celle d’une population fixée sur ses rochers. Car du fait de la faiblesse de ses ressources, elle doit déverser sur la plaine sa surcharge d’hommes. En édifiant Marrakech, devenue leur capitale au xie siècle, les Almoravides cherchaient à être près de cette montagne pour mieux la contrôler. Les montagnards ne pouvaient plus étendre leurs activités au-delà de leurs refuges escarpés. Aussi, les Imsmûden de la montagne, forts par leur nombre et leurs atouts stratégiques, étaient disposés à soutenir tout opposant leur promettant la fin de cette situation. En effet, c’est dans leurs massifs que le mouvement almohade naquit. La chute de la dynastie almoravide et l’avènement de celle des Almohades mirent fin à ce blocus longuement supporté par les montagnards. Il en sera de même pendant toute l’époque mérinide : les gouverneurs de Marrakech à cette époque étaient presque tous issus des importantes familles de la montagne. Nous constatons qu’entre la volonté pressante des pouvoirs politiques successifs de soumettre les hautes vallées et les habitants de la montagne, il y eut toujours incompatibilité et divergence. L’engagement des communautés de l’Atlas de Marrakech dans une aventure politique d’envergure, comme celle des Almohades, leur avait coûté très cher. Ils ont réussi certes à liquider le régime almoravide, mais au prix de grands sacrifices. Beaucoup d’entre eux furent obligés de quitter leurs montagnes pour s’installer ou mourir ailleurs. Les Almoravides semblent être, à l’époque musulmane, les premiers à ceinturer la montagne d’une impressionnante série de forteresses sur les contreforts même de l’adrar Dern. Tous les efforts des premiers Almohades étaient concentrés sur ces forteresses qui furent, semble-t-il, détruites avant la prise de la capitale des Almoravides en 1147. Si les Almohades, issus de la montagne de Dern, n’avaient pas besoin de tels ouvrages militaires qui étaient d’ailleurs tombés en désuétude durant leur règne, leur souvenir vivace se perpétuait chez les pouvoirs postérieurs : l’idée de réduire les populations de la montagne par blocus. Les Mérinides ont réussi, certes, à contenir partiellement le problème des Masmuda de l’Atlas de Marrakech en déplaçant d’abord leur capitale à Fès et en associant à leur pouvoir les Intan (Hentata), prestigieux héritiers des Almohades. Cependant, ils étaient, eux aussi, obligés de construire en 1353 la forteresse d’al-Qihra pour soumettre les Isksawan (Seksawa).
Nécessité de tenir la montagne
La rapidité avec laquelle Moulay Rachid a détruit le pouvoir politique des Dila et de Tazerwalt ne s’explique pas uniquement par sa simple supériorité militaire. En effet, si Moulay Ismaïl a réussi au prix de grands efforts à contenir la poussée des puissantes confédérations sanhajiennes du Haut Atlas oriental et du Moyen Atlas, on a des raisons de croire que cela ne s’est pas réalisé uniquement grâce à la puissance de l’armée makhzénienne et aux forteresses de surveillance militaire dispersées au pied de la montagne. L’absence totale d’un projet politique susceptible d’unifier les communautés de la montagne autour d’un idéal commun a condamné leurs mouvements à n’être qu’une série de conflits entre les différents groupes ou entre ceux-ci et le pouvoir central. Moulay Ismaïl a tout fait pour empêcher tout rassemblement susceptible de nourrir des ambitions politiques chez les montagnards.
Néanmoins, la question de la montagne reste l’un des problèmes majeurs du maghzen marocain depuis la seconde moitié du xviie siècle. Il se pose d’une façon dangereuse du côté du Moyen Atlas et du Haut Atlas oriental. Et c’est vraisemblablement pour cette raison que la ville de Meknès devient la capitale de Moulay Ismaïl.
Le maintien de ce système dynastique traditionnel fondé sur les rapports entre organisations tribales ne s’explique pas seulement par le fait que le Maroc est le seul pays arabe qui n’ait pas été dominé par l’Empire ottoman. C’est que différemment de l’Algérie, où lors de la terrible guerre coloniale de 1830 à 1890 les tribus furent systématiquement brisées par l’armée coloniale de façon à supprimer la dissidence, au Maroc, la colonisation renforça les structures politiques traditionnelles. Les troupes françaises, appuyées par des contingents marocains, « pacifièrent » les tribus, au premier chef montagnardes, afin d’étendre l’emprise du maghzen sur l’ensemble du protectorat.
Dans l’histoire de l’Algérie coloniale et de la guerre d’indépendance, les Kabyles ont eu une place à part. Aujourd’hui la Kabylie est la seule région d’Algérie où l’on parle encore le berbère. Les Aurès l’ont progressivement abandonné – même si l’on assiste à un grand réveil de la berbérité. La configuration géographique de la région, montagneuse et littorale, située à une centaine de kilomètres d’Alger, à forte densité de population, est très dure à pénétrer. Cette enclave a toujours résisté aux pouvoirs centraux, et elle n’a été réduite par la France qu’en 1871. Les colonisateurs ne s’intéressaient d’ailleurs guère à cette région, loin de disposer des ressources des plaines de la Mitidja ou du Constantinois, greniers à blé de l’Algérie. Alors les grandes familles kabyles réclamaient l’égalité politique : les Algériens devaient être des citoyens à part entière. Mais dans les années 1930 émergea un nationalisme de rupture au sein duquel les Kabyles jouèrent un rôle décisif. Ce nationalisme est né chez les immigrés algériens en France dont 80 % sont originaires de Kabylie, victime de la dépossession foncière. En situation migratoire, ces hommes s’affranchissent du poids des traditions et se radicalisent. Amar Imache et Radjeff Belkacem, nés en 1895 et en 1909, seront les principaux lieutenants de Messali Hadj. Le grand leader de l’indépendance algérienne (qui n’est pas kabyle) fonda à Paris l’Étoile nord-africaine (ENA). Mais dès 1936, Amar Imache s’opposa à lui sur la conception de la nation algérienne future et la place de la langue berbère. Messali pourfendait toute revendication séparatiste, identitaire. Imache fut écarté du parti. Ce débat se retrouva dans les organisations messalistes : le Parti du peuple algérien (PPA) en 1937 et le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MLTD) après la Seconde Guerre mondiale, en 1946.
Les colons français s’étaient installés sur les terres de la Kabylie à la fin du xixe siècle. Ce furent les racines de l’insurrection de la wilaya III, nom de la Kabylie durant la guerre d’Algérie. Abri montagneux aux pentes abruptes, la Kabylie abrita de nombreux maquisards. Quatre grandes figures s’imposent dans le panthéon du nationalisme algérien et kabyle. Abane Ramdane, né en 1920 dans un douar situé près de Fort-National, devient le principal initiateur et théoricien du premier congrès du FLN, tenu dans la vallée de la Soummam, en Kabylie, le 20 août 1956. Ce congrès, qui donna au FLN une définition programmatique rigoureuse, déclencha une crise. Abane Ramdane, qui préconisait la primauté des hommes politiques sur les militaires, sera assassiné en 1957 au Maroc. Amirouche, né en 1926 dans une petite localité du Djurdjura, redoutable chef de guerre, organisa les maquis de la wilaya III et sera abattu par les troupes françaises en 1959. Krim Belkacem, né en 1922, près de Draa el-Mizan, devenu le Premier ministre des forces armées puis ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958, fut le principal négociateur algérien des accords d’Évian de mars 1962. Il sera assassiné, certainement sur ordre de l’État algérien, en 1970, en Allemagne. Or les 5 à 6 millions de Kabyles avaient pris le parti des nationalistes. Durant le raidissement patriotique, il y a eu des purges, des règlements sanglants. Face à ces outrances, une partie de la population demanda protection à l’armée française. La Kabylie a ainsi fourni une partie des harkis, ces Algériens supplétifs qui combattaient dans des unités spéciales de l’armée française.
L’Algérie après l’indépendance
En 1962, à l’indépendance, l’histoire bégaya à nouveau. Les débats sur la nation algérienne ressurgissent. Dès 1963, la Kabylie se souleva. Hocine Aït Ahmed, l’un des principaux opposants à la politique d’Ahmed ben Bella, créa le 29 septembre 1963 le Front des forces socialistes (FFS). À la suite de la guerre des sables entre l’Algérie et le Maroc en octobre, les troupes de l’ANP (l’Armée nationale populaire) ouvrirent le feu sur des soldats de la 7e région en Kabylie, soupçonnés de dissidence. Hocine Aït Ahmed et ses partisans prirent le maquis. Cette résistance contre un pouvoir jugé autoritaire fut le premier acte de guerre civile dans l’Algérie indépendante. Arrêté puis condamné à mort, Hocine Aït Ahmed s’évada de sa prison en 1966 et s’exila. Il meurt en Europe en 2015. La Kabylie entrera à nouveau en dissidence contre le pouvoir central, en avril 1980. À la suite de l’interdiction d’une conférence de l’écrivain Mouloud Mammeri, de violentes émeutes secouent la région pendant des semaines. Une nouvelle génération entre en scène, qui revendique l’enseignement de la culture berbère, ignorée par le pouvoir lancé dans une politique d’arabisation. Le « printemps berbère » sera le premier signal, brutal, de la remise en cause de la culture du parti unique, le FLN, qui s’effondrera dans les révoltes d’octobre 1988. En 2001, à la suite du meurtre d’un jeune dans un commissariat, la Kabylie connaîtra un nouveau mouvement d’ampleur, sévèrement réprimé.
Aujourd’hui, des courants apparaissent, brandissant le drapeau berbère, se proclamant avant tout kabyles et non simplement algériens. Cette montée d’un sentiment de berbérité politique entraîne une solidarité berbère dans toute l’Afrique du Nord. Cela illustre le rapport compliqué que la Kabylie n’a cessé d’entretenir avec l’histoire algérienne. Bien que les Kabyles soient suspectés d’affaiblir la cohésion nationale en revendiquant des droits singuliers, la bataille qu’ils livrent pour la pluralité annonce toujours des moments décisifs de passage à la démocratie.
À lire aussi :