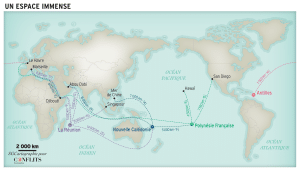Le texte négocié par Manuel Valls prévoit un droit à l’autodétermination. Un concept dangereux qui met en danger l’unité nationale et l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Retrouvez toutes les chroniques calédoniennes d’Eric Descheemaeker
Les mots les plus inquiétants du document d’orientation publié par le gouvernement il y a quelques semaines ne sont pas « le lien avec la France », la « loi fondamentale » ou même la « compétence de la compétence » qu’aurait la Nouvelle-Calédonie après l’accord que M. Valls et ses amis cherchent à imposer, suggérant une Calédonie érigée en État propre et extérieur à la France. Ce sont ceux-ci : « Le droit à l’autodétermination est bien reconnu par chacun comme inaliénable, conformément aux termes du droit constitutionnel et du droit international (…) sur le fondement de la Charte des Nations Unies ». On ne peut qu’espérer que la langue, ou en l’occurrence la main, du rédacteur ait fourché, car ce qu’il fait dire ici aux représentants des différentes délégations est factuellement faux et, surtout, a des conséquences potentiellement mortelles pour la Nouvelle-Calédonie française (et donc la Nouvelle-Calédonie, tout court). Expliquons, aussi simplement que possible, car la chose est d’une importance considérable.
Que veut dire « droit à l’autodétermination » ?
« Droit à l’autodétermination », en soi, ne veut pas dire grand-chose : c’est un label, certes évocateur, qui peut vouloir dire à peu près tout ce qu’on voudrait lui faire dire. Le document joue là-dessus puisqu’il ne définit jamais le terme, mais le sens qu’il lui donne implicitement est clair : c’est celui qu’aurait la Nouvelle-Calédonie (ou plus exactement les Néocalédoniens, sans doute au sens des « citoyens » de l’accord de Nouméa, donc une partie seulement des habitants) de recommencer le processus référendaire dont nous venons à peine de sortir. C’est-à-dire de pouvoir demander – exiger – une nouvelle consultation sur l’indépendance (un « référendum d’autodétermination ») et, en cas de oui dans les urnes, de devenir indépendants. C’est le sens qui sous-tend les différentes hypothèses du document pour son éventuel « exercice ».
À lire aussi : Nouvelle-Calédonie : Réflexions sur un accord à venir (ou pas)
Mais il n’y a pas de droit, ni de la Nouvelle-Calédonie ni d’aucune collectivité française, à faire ainsi sécession unilatéralement de la République. Comme il n’a pas de base juridique, le document fait ce que font tous les étudiants un peu perdus : il mélange tout, en espérant que plusieurs mauvais arguments en feront un qui donnera l’impression d’être suffisamment bon.
Il fait d’une part référence au droit international. La première chose à dire est que les normes auxquelles il se réfère n’ont pas d’application directe en droit français : ce sont des accords qui lient les États entre eux (et qu’ils violent d’ailleurs tous en permanence), mais qui ne donnent aucun droit dont les individus ou les groupes pourraient se prévaloir devant les tribunaux français. Par ailleurs, ce droit international ne reconnaît de toute manière aucune prérogative qu’aurait la Nouvelle-Calédonie de faire sécession d’avec la France quand bon lui semble
La Charte des Nations Unies parle bien dans son art. 1 du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Mais on voit mal comment on pourrait reconnaître la qualité de « peuple », en ce sens, à l’ensemble des habitants permanents de l’archipel calédonien, et encore moins à la partie d’entre eux qui répondent aux critères – parfaitement arbitraires – de l’art. 188 de la loi organique de 1999 leur permettant d’être inscrits sur une liste électorale spéciale[1]. Il existe un peuple français du fait de l’histoire, mais on ne peut pas plus décréter l’existence d’un « peuple calédonien » que d’un peuple « de Lifou » ou « de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ». D’ailleurs, le document du gouvernement nous dit qu’il convient de « progresser dans la constitution du peuple calédonien », ce qui implique logiquement qu’il n’existe pas aujourd’hui (même la très décolonialiste Assemblée générale des Nations Unies parle le plus souvent des « habitants de Nouvelle-Calédonie »).
Peuple autochtone ?
Plus récemment, le droit international s’est beaucoup intéressé aux peuples dits « autochtones », à qui il a également reconnu un « droit à l’autodétermination » dans une déclaration de 2007. Mais ce droit – là encore sans force normative – ne concernerait que les seuls Kanaks, ce que personne n’a l’air de soutenir dans les présentes discussions. Notons au passage que le droit international, jamais avare de contradictions, reconnaît donc un même droit, sur une même terre, à deux groupes différents.
Le document fait référence d’autre part à la Constitution, c’est-à-dire au droit interne français. C’est celui-là seul qui a une valeur contraignante dans ce débat.
Pourtant, la Constitution française ne reconnaît, elle non plus, aucun droit unilatéral à la sécession de qui que ce soit. Ce qu’elle dit, ou ce qu’on lui a fait dire, a beaucoup évolué au fil du temps, mais n’a jamais pris le sens que voudrait lui donner M. Valls, qui connaît tellement bien ladite Constitution qu’il s’est cru autorisé à dire que « peuple premier c’est dans la Constitution »[2]. Il faudra qu’il nous montre où !
À lire aussi : Nouvelle Calédonie : L’outre-mer déchiré. Éric Descheemaeker
À l’origine il y a son préambule, qui dit qu’« en vertu (…) de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Cet alinéa fait référence au référendum d’approbation de la Constitution qui eut lieu en septembre 1958. Dans tous les territoires d’outre-mer, il était entendu que, si la population votait non, le territoire deviendrait immédiatement indépendant, lui permettant ainsi d’exercer sa « libre détermination » à rester français. La Nouvelle-Calédonie, dans un scrutin auquel tous les Kanaks purent participer, vota oui à 98,12%.
Dans une interprétation audacieuse, le Conseil constitutionnel est ensuite venu à considérer que ce principe de libre détermination des « peuples des territoires d’outre-mer », comme la Constitution disait alors, avait continué après 1958. Il lui a trouvé une base nouvelle dans l’art. 53 al. 3, dont tout le monde reconnaît qu’il a été instrumentalisé à cet effet. Le Conseil, enhardi, est même allé jusqu’à parler dans une décision de 1991 relative à la Corse du « droit à la libre détermination » des « peuples d’outre-mer ».
N’est-ce pas ce dont parle le document d’orientation ?
Peuples d’outre-mer ?
Pas du tout. D’une part, cette jurisprudence est caduque depuis que le parlement français, précisément pour mieux inscrire l’outre-mer dans la République, a décidé de supprimer la mention des peuples d’outre-mer. Depuis la grande révision de 2003, il ne reconnaît plus qu’un seul peuple français avec, en son sein, des « populations d’outre-mer ». Quel que soit le contenu de ce « droit à la libre détermination », ses titulaires ont donc disparu !
Par ailleurs, ce droit n’avait jamais voulu dire ce qu’on veut aujourd’hui lui faire dire. Ce que le Conseil constitutionnel avait reconnu, c’est deux choses : d’abord, qu’on peut consulter un territoire d’outre-mer sur son évolution statutaire, y compris – cela, personne n’en a jamais douté – jusqu’à lui poser la question de l’indépendance. D’autre part, qu’on ne peut pas forcer un territoire d’outre-mer à devenir indépendant : c’est ainsi que Mayotte a pu rester française, puisqu’elle n’a pas souhaité suivre le chemin des Comores.
À aucun moment le Conseil ne nous a dit que ces territoires, ou ces peuples, ou ces populations, pouvaient décider par eux-mêmes de devenir indépendants. Non seulement il ne l’a jamais dit, mais il ne pouvait pas le dire, parce que s’ils pouvaient décider à n’importe quel moment, unilatéralement, de devenir indépendants, alors ils seraient en fait déjà « pleinement souverains ». Ils seraient dans la position d’un État associé (par sa libre volonté et pour le temps qu’il lui plaira) à la France, ce que précisément ni la Nouvelle-Calédonie ni aucun autre territoire ne sont.
Bien sûr le pouvoir constituant peut leur demander s’ils souhaiteraient être indépendants : le constituant peut tout (ou presque). Mais c’est un privilège qui leur est accordé, pour des raisons politiques ; ce n’est pas un droit. Ce privilège, il avait été donné à une partie de la population de Nouvelle-Calédonie par l’accord de Nouméa, afin de crever un abcès. Il s’est exercé en 2018, 2020 et 2021 et n’est pas reconductible. Juridiquement, il n’y aucune obligation à redemander son avis à quelque corps électoral que ce soit, ni dans 10 ans, ni dans 40 ans, ni jamais. Politiquement, on le pourrait bien sûr – mais ce serait désastreux.
Pourquoi ce point est le plus fondamental
Pourquoi cela importe-t-il autant que ce supposé « droit » ne se retrouve dans aucun accord final, qui serait ensuite transcrit dans la Constitution ? Eh bien précisément parce qu’alors ce non-droit – ce privilège – deviendrait un droit ! Il le deviendrait, mais uniquement parce qu’on l’y aurait mis, de nouveau, comme après l’accord de Nouméa. Le tour de passe-passe devrait désormais être clair même pour le lecteur non-juriste : en faisant croire aux différentes parties qu’il existerait un « droit inaliénable » à recommencer l’opération, M. Valls et ses amis veulent le leur faire signer dans un accord. Mais alors, ce pur privilège à être consulté deviendrait, de fait, un droit.
Et alors, ce serait la fin.
À lire aussi : Médicaments : favoriser l’indépendance des entreprises françaises
Pourquoi ? Parce que les indépendantistes nous ont déjà montré comment ils espèrent gagner le prochain référendum : par la politique de la terre brûlée. Entre les exactions qu’ils ont menées et pourraient remmener à tout moment, et la désespérance des populations non-indépendantistes se demandant à quoi bon rester puisque leur seul horizon est de se battre, de dix en dix ans, pour leur droit à rester français, tous ceux qui le peuvent feraient leurs valises. Et à ce moment-là les séparatistes, devenus majoritaires faute de combattants, pourront « exercer » leur « droit à l’autodétermination », et il en sera fini de la Nouvelle-Calédonie française. C’est écrit d’avance, et les garde-fous procéduraux que certains loyalistes voudraient inscrire, comme une majorité qualifiée au Congrès (sans doute 6/10èmes, donc 33 voix au lieu de 28…[3]), résisteront autant que la neige au soleil. Ce supposé « droit à l’autodétermination » est donc bien l’enjeu sans doute le plus crucial de ces négociations : il ne faut en aucun cas permettre qu’on puisse recommencer ce que nous venons de vivre[4].
[1] Ce sont les « citoyens » néo-calédoniens, qui seuls peuvent voter aux élections provinciales. C’est le fameux « dégel » de cette liste, permettant d’inscrire les Français établis depuis plus de 10 ans, ou nés sur l’île, qui a déclenché les violentes émeutes de 2024.
[2] Lors d’un déplacement au Mont-Dore le 22 février 2025 (commune qui a été la principale victime des émeutes de l’an passé car la route qui la relie au chef-lieu Nouméa a été coupée pendant de nombreux mois, l’isolant ainsi du reste de l’île), M. Valls avait répondu au député Nicolas Metzdorf, l’accusant de hiérarchiser les populations en parlant des Kanaks comme du « peuple premier », « « peuple premier », c’est dans la Constitution ».
[3] Le Congrès est l’assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie. Il compte 54 conseillers, élus en principe pour cinq ans (à la proportionnelle).
[4] Références pour ceux qui veulent aller plus loin : Félicien Lemaire, La République française et le droit d’autodétermination, thèse Bordeaux, 1994, et « La libre détermination des peuples, la vision du constitutionnaliste », Civitas Europa 2014/1, no 32, p. 113 ; Eric Descheemaeker, « La Nouvelle-Calédonie a-t-elle un « droit à l’autodétermination » ? », RJPENC no 45 (pp.169).