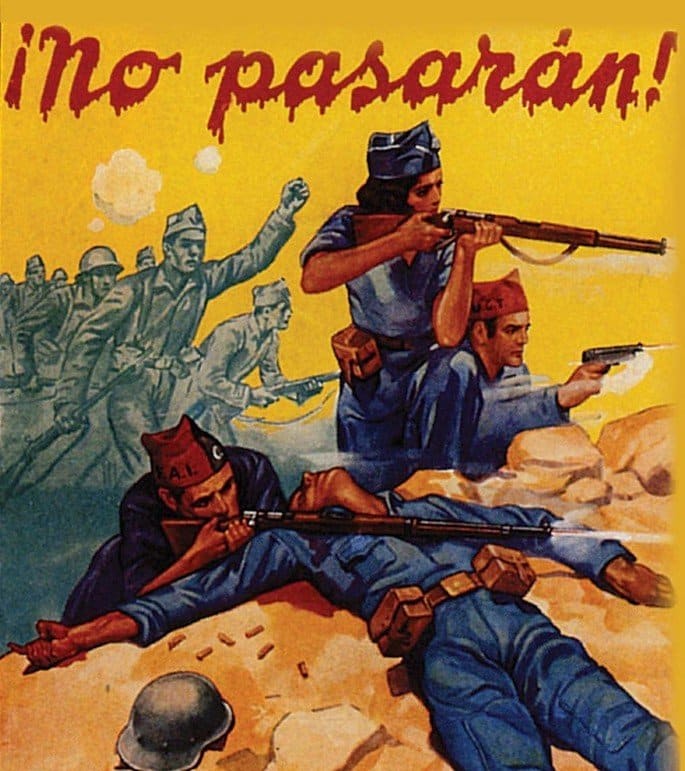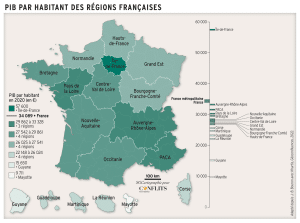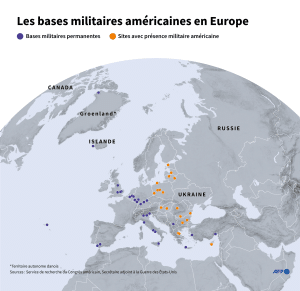Une guerre civile ne se limite jamais au seul pays concerné. Pour des questions idéologiques ou sécuritaires, des pays étrangers y interviennent également, que ce soient les voisins ou des pays plus lointains. La guerre civile espagnole (1936-1939) n’a pas échappé à la règle.
Article paru dans le N57 : Ukraine Le monde d’après
Par Pierre Castel
Manuel Azaña, président de la République espagnole de 1936 à 1939, écrit depuis son exil en France Causes de la guerre d’Espagne. Il définit cette guerre civile comme une « maladie chronique du corps national espagnol [qui] ne connaît pas de frontières ». Il analyse les causes à l’échelle nationale, mais aussi internationale puisque, selon lui, « les puissances totalitaires ont fait du conflit espagnol un problème international ». La guerre civile espagnole est un cas particulier de l’histoire contemporaine européenne, car l’ingérence étrangère, ainsi que les dimensions idéologiques et géopolitiques sont au cœur des enjeux.
Un acte de la « guerre civile européenne » (E. Nolte) se joue en Espagne
Partout en Europe, l’équilibre a été déstabilisé par la Première Guerre mondiale et la prise du pouvoir des bolchéviques en Russie. Le délitement de l’Europe conservatrice au profit de la pensée des Lumières, l’apparition de la révolution industrielle et les mutations sociales qui en découlent ont politisé en profondeur toutes les couches sociales, créant la politique de masse. Avant l’époque contemporaine, les guerres civiles européennes étaient majoritairement du fait de la verticalité du pouvoir. Les révolutions et la politisation des masses l’ont pensé à partir de l’horizontalité, véritable terreau pour la guerre civile totale.
Dans les années 1930, cette division politico-sociale déchire l’Espagne. Fait rare, ce sont les vaincus qui ont écrit l’histoire, puisque l’intelligentsia de gauche s’est massivement engagée dès le premier coup de feu. Si certains intellectuels ont mené une « guerre civile par procuration » (P.-F. Charpentier), nous retrouvons pour autant des deux côtés un engouement international marqué par les enjeux géopolitiques de l’entre-deux-guerres : « L’Espagne allait devenir la caisse de résonance politique de l’Europe et du monde. » (S. Roussillon)
À lire aussi : Espagne : Le funeste regain de la guerre des mémoires
Les nationalistes ont surtout pu compter sur l’aide militaire de l’axe Rome-Berlin. A contrario, les républicains ont su utiliser le réseau de la IIIe Internationale (Komintern). Cette dernière, fondée en 1919 par Lénine, a transformé les partis communistes nationaux en hérauts du bolchévisme. Les 17 et 18 juillet 1936, l’échec partiel du putsch met le feu aux poudres en opposant les Espagnols en fonction de leur couleur politique. L’Espagne devient un enjeu international : la toile de fond de la « guerre civile européenne » motivée par des questions idéologiques. Ce conflit a donc été décuplé par les interventions étrangères, créant une « guerre civile internationale » (A. Beevor).
Affiche du peintre Ramón Puyol Román, avec le slogan No pasarán.
1917-1936 : une « Espagne invertébrée » (J. Ortega y Gasset)
Si l’Espagne n’a pas échappé au ressac des révolutions qui ont transformé l’Europe au xixe siècle, elle a su rester en retrait des guerres européennes – notamment celle de 1914. En effet, l’Espagne n’a pas les capacités ni les intérêts d’intervenir et les intellectuels de la Generación del 98 considèrent l’Espagne en pleine décadence.
Les dissensions politiques ne cessent de se creuser au cours des années 1920. Face à cet imbroglio, des élections municipales ont lieu le 12 avril 1931 et voient les monarchistes arriver en tête dans les circonscriptions rurales. Le lendemain, de grandes manifestations ébranlent le pays. Le roi s’exile et adresse un manifeste où il précise qu’il « entend s’éloigner plutôt que de prendre le risque de lancer ses compatriotes les uns contre les autres dans une guerre civile fratricide ». La IIe République est alors proclamée.
Cette dernière se polarise progressivement. Le gouvernement est divisé entre les socialistes modérés et une extrême gauche révolutionnaire de plus en plus virulente. En novembre 1933, malgré une victoire de la droite aux élections, le président Zamora refuse de lui ouvrir les portes du gouvernement. La droite se radicalise. En réaction, en octobre 1934, marxistes et anarchistes déclenchent une grève générale grandement financée par Moscou. Elle devient une révolution particulièrement violente tant dans son exécution que dans sa répression, notamment dans les Asturies.
À lire aussi : Entretien avec Miguel Platón, auteur de « La répression de l’après-guerre » en Espagne
L’ébullition politique se transforme en une guerre de clan. Un point de non-retour est atteint le 13 juillet 1936 quand les milices communistes assassinent Calvo Sotelo, chef de file des monarchistes. Ils sont aidés par la Garde d’assaut, la police du gouvernement du Front populaire. Apprenant cela, le député socialiste Zugazagoitia s’écria : « Cet attentat, mais c’est la guerre civile ! »
En effet, cet événement jette dans une conspiration contre l’État une junte militaire le 17 juillet 1936, menée par les généraux Sanjurjo et Mola. Partant des garnisons au Maroc et de la Légion du général Franco, la République ne parvient pas à endiguer pleinement le soulèvement : au bout de deux jours, la guerre qui couve éclate. En réalité, ce conflit n’oppose pas les fascistes contre les démocrates comme la mémoire collective l’imagine, mais cette guerre est une révolution face à une contre-révolution.
Les interventions de l’axe Rome-Berlin
Dès le début du conflit, l’Espagne est coupée en deux, idéologiquement et géographiquement. L’armée est divisée : l’Ejército est partagée entre les insurgés et la République, l’aviation et la marine sont loyales au gouvernement. Numériquement, les deux camps sont plutôt équilibrés. Le manque de matériels et de munitions fragilise les insurgés autant que les loyalistes. Les interventions étrangères dans la guerre civile espagnole s’effectuent alors de trois manières : logistiquement, militairement et intellectuellement. Les deux camps sont armés et modernisés par les deux puissances rivales : l’URSS et l’axe Rome-Berlin qui est né pendant ce conflit. La guerre n’est plus nationale, mais idéologique et géopolitique.
L’Italie fasciste est la première à intervenir. Dès le 19 juillet 1936, des négociations entre Mussolini et des officiers insurgés cherchent à établir un soutien au putsch. Or, l’Italie n’a pas les capacités pour intervenir militairement, car elle est fragilisée économiquement et diplomatiquement depuis l’affaire éthiopienne. Pour autant, le Duce assure un soutien matériel d’envergure, obsédé par le prestige national et la volonté de renouer avec l’héritage impérial. Tout au long du conflit, l’Italie livre au bando nacional un arsenal composé de quelques navires, d’avions, de chars et de canons.
En décembre 1936, Mussolini envoie un corps expéditionnaire en Espagne après l’échec de Mola devant Madrid. Malgré les difficultés financières, il souhaite se couvrir de gloire et tirer profit d’une potentielle victoire de Franco. Avec ce dernier, il signe un accord le 28 novembre où, en échange d’un contingent de Chemises noires, le Caudillo soutiendrait son homologue dans sa politique d’expansion méditerranéenne. Adossé à l’armée nationaliste, ils sont environ 75 000 Italiens à combattre en Espagne au sein du Corpo Truppe Volontarie, sur terre et dans les airs.
L’Allemagne nazie a mis plus de temps à apporter son soutien aux insurgés. Il faut attendre le 27 juillet pour que Hitler donne son accord pour une timide opération de soutien logistique en envoyant dix Junker 52 au Maroc espagnol, afin de participer au déplacement des troupes stationnées vers la péninsule. Grâce à des sociétés écrans, le régime allemand parvient à faire transiter vers l’Espagne un matériel conséquent pour mener une guerre moderne, ainsi que des techniciens et des observateurs.
À lire aussi : Pío Moa et les mythes de la Guerre d’Espagne. Entretien avec Arnaud Imatz
À compter de l’automne 1936, l’intervention devient directe, car, en réaction à l’intensification de l’aide soviétique pour les républicains, le commandement allemand crée la légion Condor le 6 novembre. Composée de 3 800 à 6 500 hommes tout au long du conflit, elle est composée d’une arme aérienne et d’une brigade blindée. Ce n’est pas véritablement par idéologie qu’elle intervient en Espagne, puisque l’état-major allemand utilise le conflit espagnol comme un terrain d’aguerrissement pour ses soldats et son matériel. Cela explique également pourquoi la légion Condor n’a pas été élaborée par Franco – généralissime du camp national depuis le 21 septembre 1936 – et qu’elle jouit d’une certaine autonomie dans ses actions. Ainsi, l’aide militaire allemande n’a pas été décisive pour la victoire du camp national, même si la qualité des pilotes a aidé à tenir une partie du ciel.
Le Komintern au secours de la République espagnole
Au début du conflit, les soutiens étrangers aux républicains émanent d’engagement individuel puisqu’à l’été 1936 une cohorte de marxistes se trouve à Barcelone pour participer aux Olympiades populaires (en opposition aux Jeux olympiques de Berlin). Ils forment le bataillon Thälmann, la première résistance étrangère composée d’Allemands. Si au début, il n’y a pas véritablement de structure, dès le mois de septembre, l’URSS et le Komintern prennent les rênes de cet engouement socialiste international pour la défense de la République. Le NKVD crée les Brigades internationales (BI). Le 18 septembre, Staline légifère en ce sens en promulguant la résolution no 7 précisant les modalités d’interventions. Afin de ne pas afficher la capacité opérationnelle limitée de l’URSS, il décide de ne pas engager officiellement l’Armée rouge – qui vient d’être épurée de ses cadres – mais plutôt de s’appuyer sur les masses ouvrières et antifascistes d’Europe (tout en envoyant quelques centaines d’officiers pour l’encadrement).
L’historien A. Beevor rapporte « qu’au cours de la guerre civile, entre 32 000 et 35 000 hommes de 53 pays différents servirent dans les rangs des Brigades internationales ». Les brigadistes sont constitués par nationalité en bataillon. Nous retrouvons une proportion importante de juifs qui ont fui les régimes autoritaires. Entre 3 000 et 7 000 tout au long du conflit, ils constituent le tiers du contingent américain et la majorité des troupes d’Europe centrale et des Balkans.
Si la presse occidentale s’efforce de représenter les intellectuels et la classe moyenne au sein des BI, la réalité montre qu’elles sont surtout formées de classes populaires. Issues des classes laborieuses, elles ne collent pas au portrait romantique de l’intellectuel combattant aux côtés de l’ouvrier pour le grand soir qu’exalte l’intelligentsia. Ainsi, dès 1938, les flux de combattants s’amenuisent, d’autant plus que la victoire de Franco à la bataille de Teruel retentit comme le glas pour les républicains. De plus, la tentative d’ingérence totale des Soviétiques devient le talon d’Achille de la République espagnole.
En effet, les BI deviennent un laboratoire politico-militaire pour les Soviétiques qui perfectionnent les techniques d’encadrement et de répression au sein des troupes, avec l’utilisation des commissaires politiques et la planification stratégique depuis les bureaux moscovites. Militairement, les BI sont fragilisées par un état-major qui dirige depuis Moscou et par les oppositions au sein du camp républicain, exacerbées par la tentative de contrôle total par les Soviétiques. À ce titre, nous remarquons au chapitre IX d’Hommage à la Catalogne (1938) que l’intellectuel anglais George Orwell est frappé dans ses idéaux par ces manières. Venu à Barcelone pour écrire une série d’articles, il s’engage finalement dans les milices. Trotskiste, il rejoint le POUM plutôt que les BI. Blessé au combat sur le front catalan, son moral demeure. Pour autant, il déchante et retourne en Angleterre lorsque le Parti communiste espagnol (PCE) et le PSOE font la guerre au POUM et aux anarchistes lors des sanglantes journées de mai 1937 : « Une guerre civile dans la guerre civile. » (Beevor)
À lire aussi : L’Espagne face à son histoire
L’URSS, au même titre que l’axe Rome-Berlin, a également joué un rôle d’importance en envoyant une grande quantité d’armes : 680 avions, 410 chars, 652 000 mitrailleuses et 1 500 canons. Les premiers navires accostent le 4 octobre 1936. Si l’Allemagne utilise l’Espagne comme un laboratoire d’expérimentation et que l’Italie intervient par idéologie, l’URSS intervient en tant que « mère patrie du prolétariat » et à des fins économiques. En effet, contrairement à l’axe Rome-Berlin qui vend son matériel à crédit (l’Espagne termine les remboursements dans les années 1960), l’URSS vend coûtant et récupère une partie du stock d’or de la Banco de España (alors 4e réserve mondiale).
De plus, les Soviets refusent d’envoyer leur meilleur arsenal aux régiments républicains dont les officiers ne sont pas encartés au PCE. Afin de rester discret dans le cadre du Pacte de non-intervention signé par les pays européens, ils font transiter par l’Eurobank de Paris 174 tonnes d’or (27,4 % des réserves) pour les convertir en devises. Au total, l’URSS récupéra plus de 500 tonnes de métal précieux au cours du conflit pour assurer « l’aide militaire fraternelle ».
S’engager par la plume : verba volant, scripta manent
D’un point de vue militaire, à en croire la propagande pendant et après la guerre, les BI ont joué un rôle remarquable. Pour autant, les études historiques ont démontré que leur utilisation n’a pas été déterminante, au même titre que l’intervention des CTV italiens et de la légion Condor. Or, la postérité retient les interventions étrangères dans la guerre civile espagnole, car de très nombreux intellectuels les ont exaltés. Tantôt par romantisme, tantôt par idéologie, ils sont nombreux à prendre parti pour l’un des deux camps dès juillet 1936. Certains ont même concilié la plume et l’épée afin d’allier principe et action. C’est le cas, pour ne citer que les plus connus, d’André Malraux, George Orwell, Simone Weil ou Carlo Rosselli.
La guerre d’Espagne a été le terreau d’innovations littéraires et politiques. Elle est couverte en continu par des journalistes de tout horizon qui permettent d’informer chaque jour de son évolution. Des reportages cinématographiques sont également projetés. Ce processus favorise l’émergence d’une opinion publique exacerbée par les divisions politiques. Une fantastique coquille de Mercure de France de décembre 1937 résume ceci : « La bataille fait rage dans tous les lecteurs. »
Politiquement, cette guerre a forgé une dialectique d’opposition entre la droite et la gauche que nous retrouvons jusqu’à la guerre froide. À partir de 1937, la droite conservatrice soutient l’idée que les interventions sont motivées par une croisade contre le bolchévisme et la défense de l’Occident. À ce titre, l’intelligentsia de droite s’unit dans un « Manifeste aux intellectuels espagnols » publié dans Occident en décembre 1937 où elle souhaite le triomphe « de la civilisation contre la barbarie ». L’idée de Reconquista réapparaît également chez les intellectuels comme chez les politiques. À gauche, l’antifascisme et la défense du prolétariat résonnent dans de nombreuses monographies. Les auteurs utilisent différents supports – même le cinéma avec A. Malraux – pour faire connaître, réagir et adhérer à la cause républicaine. Il existe également un courant refusant ces dialectiques radicales, comme F. Mauriac et A. Gide.
À lire aussi : Livre ; La guerre de Succession d’Espagne
Certains, enfin, en profitent aussi pour alerter du danger allemand pour l’Europe à l’heure des accords de Munich de 1938. Lorsque la guerre civile s’achève en avril 1939, l’Espagne est un tableau avant-gardiste de l’Europe des années qui suivent : radicalité, misère, destruction et crimes contre des civils. La victoire de Franco pousse de nombreux républicains à l’exil. Certains vont combattre aux côtés d’anciens volontaires étrangers pour un pays qui n’est pas le leur, à l’instar de la Nueve qui entre libérer Paris le 24 août 1944 où attend le colonel Rol-Tanguy, ancien brigadiste en Espagne.