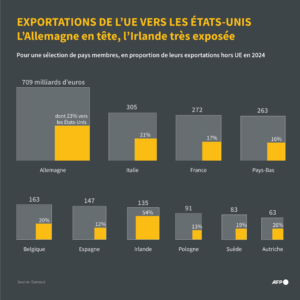État-tampon aux frontières contestées, la situation du Népal est un cas d’école géopolitique. Placé au sommet d’une chaîne où la plaque tectonique indienne vient s’encastrer dans la Chine, le Népal est victime de nombreux séismes, tant politiques que stratégiques. Le retour d’exil de l’ancien roi Gyanendra Shah, en mars 2025, est le dernier en date.
Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée
Le 2 décembre 2024, le Premier ministre népalais Sharma Oli, chef du Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) prenait l’avion pour Pékin et entamait sa première visite à l’étranger depuis son retour à la tête du gouvernement. Cette priorité donnée à la Chine plutôt qu’à son partenaire traditionnel, l’Inde, a fait l’effet d’un retournement d’allégeance. Certains y ont vu une marque d’intérêt de la Chine pour les ressources hydrauliques du Népal, d’autres se sont inquiétés de cette nouvelle avancée de Xi Jinping dans l’arrière-cour de Narendra Modi.
Comme le Liechtenstein ou Andorre, le Népal est une sorte de niche géopolitique, mais une niche aux dimensions asiatiques (147 181 km² et plus de 30 millions d’habitants, soit près de 210 habitants par km² en 2022). Ce refuge montagneux, encore jeune et pauvre, est coincé entre les deux mastodontes chinois et indiens, ses deux principaux partenaires économiques. La moyenne d’âge des Népalais est de 23 ans et beaucoup d’étudiants se retrouvent à l’étroit dans Katmandou. Malgré un taux de croissance annuelle de son PIB d’environ 5 %, le Népal bénéficie chaque année de plus de 600 millions d’euros d’aide au développement, dont la moitié provient de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement. Le « toit du monde », connu des nombreux touristes qui soutiennent l’économie du pays, bénéficie d’une image trompeuse, véhiculée par Tintin au Tibet. Le sas de décompression de la rivalité indo-chinoise n’est plus le jardin paisible dessiné par Hergé. Dans les années 1970 et 1980, il attirait les jeunes Occidentaux en quête de spiritualité ou de sensations fortes, mais le pays s’est urbanisé et densifié. Depuis une grosse trentaine d’années, sa vie politique s’est dégradée et a subi les contrecoups des ingérences voisines.
Une population jeune et divisée
Ce territoire à flanc de montagne s’ouvre naturellement vers les grandes vallées de l’Inde et a longtemps été à l’abri des pressions de Pékin. Les marches de l’Himalaya n’étaient reliées au désert tibétain que par des cols escarpés et les opposants au régime chinois pouvaient s’y retrouver. L’hindouisme (80 % de la population) y est resté largement majoritaire, loin devant le bouddhisme (8 %) et l’islam (5 %). L’Inde et le Népal sont toujours liés par un traité de paix et d’amitié signé en 1950, au lendemain de l’indépendance indienne. Selon Michelle Kergoat, auteure d’une Histoire politique du Népal, aux origines de l’insurrection maoïste (Khartala, 2008), la vieille monarchie népalaise constituait depuis le xviiie siècle le ferment de cette nation divisée en une soixantaine d’ethnies et castes différentes, morcelée par de nombreuses vallées encaissées. Le royaume du Népal avait même maintenu son indépendance pendant la période de domination anglaise, puis avait échappé à la guerre civile entre le Pakistan et l’Inde.
À lire aussi : Indopacifique : un arc de crises stratégique
Une république encore balbutiante
Mais en 2008, une longue guérilla d’inspiration maoïste (17 000 morts entre 1996 et 2006) se termine par l’exil du roi et laisse péniblement place en 2015 à un régime fédéral, monocaméral et proportionnel. Ce système démocratique, aux combinaisons variées et changeantes, fait les délices des partis politiques et le cauchemar de la population. Les nombreuses étiquettes marxistes-léninistes ou maoïstes qui colorent son assemblée ont peu à voir avec le communisme ou le socialisme, mais révèlent davantage une résurgence baroque du panthéon hindou. « Les principes, les politiques et les programmes n’ont absolument plus rien à voir avec les alliances politiques, seul importe désormais le pouvoir et la fonction, et peu importe avec qui vous vous alliez pour y parvenir » constatait en 2022 l’ancien député Pari Thapa dans le Nepali Times. Ce désordre institutionnel semble néanmoins profiter à la Chine de son omnipotent président, Xi Jinping. Dès 2009, un nouveau traité d’amitié est signé par les deux pays.
Pékin profite des différends indo-népalais
Ce rapprochement avec la Chine s’est trouvé accentué par l’arrivée au pouvoir en 2014 du BJP, le parti nationaliste hindou du Premier ministre indien Narendra Modi, dont la dernière visite à Katmandou remonte au 16 mai 2022. Selon Emmanuel Véron, géographe de l’Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est (IFRAE), « l’Inde a toujours estimé que le Népal était dans son orbite stratégique dans cette partie de l’Asie du Sud. Néanmoins, en 2019, le gouvernement de Narendra Modi a tracé une nouvelle carte, qui amputait une partie du territoire népalais, notamment dans la partie du Kailash, montagne sacrée dans la pointe de jonction avec la région autonome du Tibet. » Cette partie orientale de l’Inde n’est accessible que par un étroit corridor d’une trentaine de kilomètres entre le Népal, le Bhoutan et le Bangladesh. Les régions indiennes du Sikkim et de l’Arunachal Pradesh en dépendent d’autant plus que leurs frontières avec la Chine sont disputées.
À lire aussi : L’Inde : A la poursuite de la Chine ?
Les tentatives indo-népalaises d’accords frontaliers
Le 3 juin 2023, le Katmandu Post rendait compte des derniers échanges diplomatiques entre l’Inde et le Népal. En contrepartie de la reconnaissance de la souveraineté indienne sur les territoires népalais occupés de Kalapani, Lipulekh et Limpiyadhura, le Népal obtiendrait des territoires situés dans le corridor de Siliguri. Ce corridor appelé par les Britanniques the chicken neck, c’est-à-dire le cou de poulet, exclut le Népal d’un accès à la frontière du Bangladesh, pays qui représente une alternative commerciale pour accéder à l’océan Indien.
New Delhi, étant parvenue à traiter avec le Bangladesh dans une situation comparable, ne désespère pas de régler la querelle de ses frontières avec le Népal. En 2024, l’instabilité politique à Katmandou est venue contrarier les plans de Narendra Modi. « New Delhi va regretter Pushpa Kama Dahal – surnommé “le féroce” quand il était chef de la guérilla » observait Bruno Philip, spécialiste du Népal pour Le Monde. « En dépit de son penchant à l’origine plus pro-chinoise, puisqu’il se réclamait du maoïsme, il se révéla avoir l’échine plus souple que son successeur, ce qui faisait l’affaire des Indiens. »
Pour les souverainistes et monarchistes népalais, la période de la guerre froide apparaît désormais comme un âge d’or. Le roi bénéficiait alors d’une autorité de droit divin et le pays semblait vivre en dehors des conflits du monde. En plein essor, le nationalisme népalais s’appuie sur ce sentiment de décadence et de faiblesse face aux grands voisins chinois et indiens. Mais la récente tournée du roi déchu Gyanendra, 77 ans, n’a pas suffi à rehausser sa réputation. La nation népalaise, encore sous le choc du massacre de la famille royale par l’héritier du trône en 2001, avait peu goûté aux tentatives de restauration autocratique de Gyanendra, après la mort de son frère aîné et de son neveu. Le retour de la famille royale, acclamée par ses partisans le 9 mars dernier, s’est conclu par des émeutes avec la police et la mort de deux manifestants vingt jours plus tard. Une contre-manifestation menée par des républicains maoïstes se tenait à l’autre bout de la ville. Ce parfum de guerre civile a réveillé de douloureux souvenirs. Le retour de la dynastie Shah à Katmandou, qui dispose de soutiens au Bhoutan et en Inde, apparaît rétrospectivement comme un symptôme de la rivalité sino-indienne au Népal plutôt qu’une issue politique.