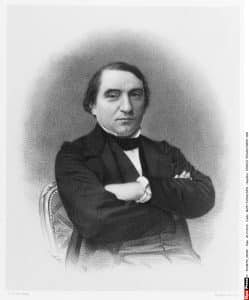Musique des quartiers noirs, le rap s’est lié aux trafics de drogue, par esthétisme musical et par nécessité de recyclage de l’argent sale. Si drogues et violences sont si présentes dans les clips, c’est autant pour attirer la nouvelle génération que pour refléter le quotidien réel ou fantasmé des acteurs de la musique.
Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée
Le monde du spectacle, et spécialement l’industrie musicale, a toujours été lié à la criminalité qui y trouvait – entre autres – un excellent moyen de blanchir l’argent sale. C’est notamment vrai aux États-Unis, où la pègre italienne tenait des clubs de jazz, des night-clubs et signait des contrats avec des artistes pour s’occuper de leur carrière. Une réalité illustrée dans la scène mythique du Parrain où l’on voit Vito Corleone assurer la réussite de Johnny Fontane. Même si le grand Frank Sinatra n’a jamais été inculpé, des proches de la pègre associés à Sam Giancana et Lucky Luciano assuraient au moins sa protection. Luciano étant tout de même considéré comme l’un des pères du crime organisé américain.
Blanchir l’argent par la musique suit un parcours relativement clair : il faut investir sur un artiste et doper sa cote grâce à son influence et des transactions informelles ; cet artiste génère de l’argent par les spectacles, les ventes de disques, les partenariats, et rembourse ensuite son investisseur via des factures diverses (sécurité, construction de villas, etc.).
Spotify, Deezer, Qobuz : le streaming pour blanchir ?
Depuis les années 2000, la digitalisation de la musique a ouvert de nouvelles perspectives. Ce sont les plateformes de streaming, principalement Spotify, Deezer, Qobuz, qui assurent sinon les principaux revenus des artistes, en tout cas les plus réguliers. Un million d’écoutes rapportant environ 2 000 euros aux ayants droit, les mécanismes les plus créatifs se mettent aussitôt en mouvement. Surtout si l’on veut recycler d’encombrantes liquidités.
Le Centre national de la musique (CNM) a publié une enquête en 2021 qui a eu l’effet d’une petite bombe. Pour les 10 000 premiers titres les plus écoutés sur chaque plateforme en France, 1 % des écoutes sur Spotify, 1,6 % sur Qobuz et 2,6 % sur Deezer ont été détectées comme frauduleuses. Ce ne sont que des estimations basses. Le CNM insiste sur les difficultés de recueillir les informations auprès des plateformes et table en réalité sur un pourcentage plus élevé, voire beaucoup plus important. Sur Spotify et Deezer, c’est surtout dans la longue traîne des titres en dessous des 10 000 les plus écoutés que se trouvent 80 % des écoutes frauduleuses ; sur Qobuz, c’est plutôt l’inverse. Pour les trois plateformes confondues, le CNM estime que 1 à 3 milliards d’écoutes sont frauduleuses, représentant 2 à 6 millions d’euros. Celles qui sont détectées ne sont pas rémunérées, mais elles révèlent un océan de fausses écoutes potentielles. Les plateformes comptent une écoute dès qu’un morceau est joué au minimum pendant trente secondes consécutives. Elles considèrent ainsi qu’il y a une volonté humaine. Comme chaque écoute génère de l’argent et oriente le système de recommandations, il faut en gonfler artificiellement le nombre. Pour cela, les gestionnaires passent par des « fermes à stream ». Des robots ou des personnes physiques jouent en boucle le morceau, parfois via des playlists qui regroupent les titres de plusieurs clients. Les services d’achats de streams passent par des offres référencées sur les moteurs de recherche, mais aussi par le bouche-à-oreille. Sites de référencement, places de marchés, agences de promotion, échanges de vues, les offres sont nombreuses pour booster un artiste. Le tout payé en liquide ou en bitcoin, la cryptomonnaie permettant aussi une métamorphose de l’argent sale.
À lire aussi : Podcast ; Une histoire politique de la musique
L’enquête du CNM révèle que 85 % des streams frauduleux détectées concernent des morceaux de hip-hop/rap sur Spotify et près de 60 % sur Deezer. Proportionnellement au nombre de lectures dans cette catégorie, les détections frauduleuses représentent moins de 1 % des écoutes dans cette catégorie, au top 10 000. Mais après le seuil des 10 000, mystère… Le CNM alerte clairement de ce qui peut se cacher derrière ces fausses écoutes : il est probable qu’une partie de ces faux streams « s’inscrivent dans une stratégie de blanchiment de revenus issus d’activités illégales, voire criminelles ».
L’exemple des gangs de Suède
Que de l’argent sale soit blanchi via les plateformes de streaming ne tient ni du fantasme ni du probable. C’est très concret. En septembre 2023, le journal suédois Svenska Dagbladet a expliqué comment des gangs en Suède utilisaient Spotify pour blanchir les gains de la drogue, des vols, des assassinats, et autres activités. Ces révélations intéressent d’autant plus le pays que la plateforme de streaming est née à Stockholm en 2006.
En enquêtant sur cette pratique, le journal a reçu les confidences de quatre membres de gangs différents, tous actifs à Stockholm. L’un d’eux, resté anonyme, n’a laissé planer aucun doute : « Je peux vous le dire sans hésiter, c’est bien réel. J’y ai participé moi-même », a-t-il affirmé. Un policier, lui aussi sous couvert d’anonymat, est venu confirmer ces témoignages. D’après ce même membre de gang, tout aurait commencé en 2019, à une époque où le rap gangster suédois connaissait une forte montée en puissance, raflant même quelques prix. C’est à ce moment-là que son groupe a vu dans Spotify l’opportunité de blanchir de l’argent. « On a payé des gens pour s’en occuper de façon régulière », a-t-il confié.
Le schéma était bien huilé : l’argent issu d’activités criminelles était d’abord transformé en bitcoins, avant d’être utilisé pour acheter de faux streams auprès de fournisseurs spécialisés. Grâce à ces écoutes fictives, les morceaux grimpaient en flèche dans les classements, ce qui boostait aussi les vraies écoutes. « Ils ont fait en sorte que nous terminions en tête des classements », a-t-il expliqué. Simple.
Et avec les streams, viennent les gains : en Suède, un million d’écoutes peut rapporter entre 40 000 et 60 000 couronnes suédoises, soit environ 3 000 à 4 000 euros, d’après les chiffres cités par Svenska Dagbladet.
Hip-hop/rap et trafic de drogue, un lien historique
Hip-hop/rap et drogue ont toujours entretenu une relation plus ou moins ambiguë. Le hip-hop est une musique urbaine née à la fin des années 1960 à New York dans le South Bronx, où l’on trouve les ghettos noirs et latinos. Ce genre musical a été créé par la rue, en pleine poussée de revendications sociales, mais aussi au moment où la drogue devient une rente exceptionnelle pour les gangs. Dans les années 1970, les annonces faites par les disc-jockeys ou annonçant les DJ évoluent en des recherches plus complexes sur le texte et la rythmique, ce qui a donné le rap.
Ce nouveau genre devient rapidement prisé dans les quartiers populaires et, dix ans plus tard, le groupe Niggaz Wit Attitudes crée le gangsta rap. Leurs membres viennent de quartiers pauvres où il est quasiment impossible d’échapper à l’emprise d’un gang et de ses activités. C’est le cas de Ice Cube, de son vrai nom O’ Shea Jackson, qui a grandi à South Central, quartier du sud-ouest de Los Angeles, et surtout de Eazy-E, né Eric Lynn Wright à Campton, en banlieue de LA. Ce dernier avait commencé à baigner dans les activités illégales dès l’âge de 13 ans en vendant de la marijuana pour devenir membre des Kelly Park Compton Crips, un gang lié à la puissante alliance criminelle des Crips. À 22 ans, après l’assassinat de son cousin, il a finalement décidé de se consacrer au hip-hop.
À lire aussi : Un Triptyque stupéfiant à l’Opéra Bastille
Le gangsta rap de la West Coast entre en concurrence avec le rap de l’East Coast new-yorkais dans les années 1990, entraînant une spirale de violence pour de multiples raisons : guerre entre maisons de production, course à la crédibilité, guerre des gangs, trafic de drogue, etc. Tout est motif pour invoquer la violence. C’est ainsi que meurt celui qui deviendra l’une des plus grandes figures du rap new-yorkais : Christopher George Latore Wallace, alias The Notorious B.I.G. Pour faire la promotion de son deuxième album, il se rend en terre hostile, c’est-à-dire à Los Angeles. La soirée du 8 mars se passe mal, il est hué par la salle. Le 9 mars, peu après minuit, il sort d’une soirée organisée par le magazine Vibe au Petersen Automotive Museum. B.I.G. s’assied sur le siège passager avant d’un gros SUV noir, un Chevrolet Suburban, qui doit l’emmener à l’hôtel. À 0 h 45, la voiture s’arrête à un feu rouge après avoir roulé cinquante mètres. Une Chevrolet Impala vient s’arrêter à la droite de la GMC Suburban. Son conducteur baisse la vitre et tire cinq coups de feu, dont quatre touchent le rappeur à la poitrine. Il est déclaré mort à 1 h 15, à 24 ans. Ce drame, qui heurta profondément l’Amérique, a surtout révélé toute la violence du milieu du rap et ses liens obscurs avec les gangs.
Le rap et l’esthétique du crime
Pour beaucoup, le rap serait l’expression de la souffrance liée à la violence de la rue, à l’emprise de la criminalité sur les vies de quartier. Une idée reçue qui est bien souvent fausse. Même si de nombreux textes expriment cette souffrance, il y a toujours un jeu ambigu avec la violence ou la criminalité perçues par le public et par l’artiste comme un indicateur de crédibilité. La plupart des rappeurs contemporains revendiquent la liaison, par esthétisme ou lien réel.
L’un des rappeurs les plus révélateurs de ce lien ambigu est sans doute l’Américain Drakeo the Ruler, originaire de South Central, lui aussi. Il est connu pour ses paroles sombres qui décrivent mélancoliquement des scènes de rue et de violence. En prison pour des chefs d’accusation dont il sera acquitté, il enregistre l’album Thank You For Using GTL depuis le téléphone de l’établissement, ce qui donne un timbre grésillant et très poignant à sa voix. Il est poignardé à mort en décembre 2021 dans les coulisses d’un festival à Los Angeles, assassinat dont les circonstances restent floues.
En France, le rap sous emprise de la drogue
Le rap français n’a pas tout à fait le même parcours que le rap US. Car les cités marseillaises, parisiennes ou lyonnaises des années 1990 n’ont jamais été les ghettos afro de Los Angeles, bien que la drogue et le crime eussent toujours été une réalité dans les blocs de banlieue. Les principaux groupes et artistes (Fonky Family, Akhenaton, La Rumeur, Ministère A.M.E.R., etc.) n’ont pas eu de démêlés avec la justice pour trafic de stupéfiants ou liens avec le crime organisé même s’ils ont pu y être confrontés.
À mesure que le trafic a gagné l’Hexagone et que les bandes ont commencé d’enregistrer des gains considérables, le rap a de plus en plus exprimé le trafic de drogue et la violence. Le tournant se produit dans les années 2010. Les réseaux de drogue deviennent structurants et naturellement, comme la plupart des jeunes de quartier, beaucoup de rappeurs y sont liés d’une manière ou d’une autre.
Les affaires judiciaires sur fond de drogue impliquant des rappeurs se multiplient, avec de vastes répercussions médiatiques.
Le cas le plus concret est sans doute celui de Koba LaD, de son vrai nom Marcel Junior Loutarila, récemment impliqué dans l’affaire d’évasion de Mohamed Amra, ennemi numéro 1 en France. Pour assurer sa protection, il avait choisi des personnes liées à la Black Manjak Family, gang guinéen d’Évreux, impliqué dans le trafic de stupéfiants à grande échelle. Les gains et l’influence de la BMF ont explosé simultanément au partenariat avec Koba.
L’évolution du rap français accompagne tant l’emprise du trafic de drogue en France que la musique devient parfois un outil promotionnel. Par exemple, une enquête de police sur la Ghost Team a révélé que ce groupe criminel de Roubaix s’est servi du rap comme outil de marketing pour son réseau de vente de cocaïne.
À lire aussi : Le marché de la cocaïne devant celui du cannabis : comment la drogue est acheminée en France
Si de nombreux rappeurs n’ont pas grandi en cité et ont échappé au trafic dans leur prime jeunesse, la plupart de ceux qui percent sont rattrapés par les gangs qui gravitent autour du milieu. SCH, de son vrai nom Julien Schwarzer, a toujours taillé son image sur la mafia, par esthétisme. Il a été obligé de quitter Marseille sous la pression de la DZ Mafia qui voulait lui extorquer 300 000 euros. Dans cette affaire, l’un des proches du rappeur a été tué au cours d’une fusillade.
L’évolution du rap français est donc révélatrice de l’emprise continue de la drogue sur le territoire. Mais il est multiforme et certains sous-genres se sont éloignés des thématiques liées à la drogue, le sexe et la violence. L’énorme succès de JuL (Julien Mari), qui parle parfois de consommation de drogue, mais sans jamais jouer sur une ambiguïté criminelle, est là pour le confirmer. Une réussite inspirante pour de nombreux rappeurs de la « Next Gen », qui choisissent de ne pas travailler sur ces sujets.