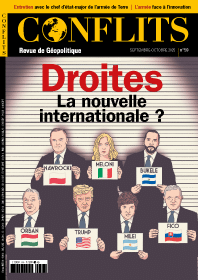L’opéra en Allemagne a joué un rôle essentiel dans la construction du nationalisme et du nouvel Empire. Des mélanges entre l’art et la politique qui ont contribué à enrôler la musique et l’opéra
Du XVIIIe au XIXe siècle, le nationalisme allemand évolue et se transforme, profondément marqué au travers de changements politiques, culturels, philosophiques et sociaux. L’idée d’une identité nationale allemande se crée avec une volonté d’unification et une valorisation de ce qu’on appelle la germanité. L’influence du romantisme et la redécouverte de la culture germanique vont amplifier ce nationalisme avec la réhabilitation des mythes et légendes, avec les contes populaires qu’on va retrouver chez Carl Maria von Weber et Richard Wagner, entre autres, ainsi que le folklore et l’emploi de la langue allemande.
Le contexte historique et culturel allemand au XIXe siècle
Après les guerres napoléoniennes (1803–1815), le nationalisme allemand naît principalement comme un mouvement culturel et intellectuel, en réaction à l’occupation française et au morcellement de l’espace germanique (plus de 300 États avant 1806). Après la Confédération germanique, l’Empire allemand naît en 1871.
À lire aussi : L’Allemagne divisée
Plusieurs philosophes et penseurs vont être les hérauts de l’unité allemande qui ne va pas reposer seulement sur des frontières politiques, mais sur une langue (qu’on retrouvera dans le singspiel), une culture et une histoire communes. Les principaux protagonistes sont Johann Gottfried Herder (1744-1803), pour qui la nation est une communauté culturelle et linguistique organique, enracinée dans le peuple (Volk*), son histoire, sa langue et ses traditions, en particulier la culture populaire avec sa poésie, ses chants, ses contes qui sont, selon Herder, les expressions pures de l’âme nationale. Puis Johann Gottlieb Fichte (1762-1803) pour qui la nation allemande doit s’unir spirituellement contre la domination étrangère, notamment face à l’occupation napoléonienne, pensées qu’il exprimera dans son œuvre clé : Discours à la nation allemande (1808). Enfin, les frères Jacob et Wilhelm Grimm (1785–1863, 1786–1859), partisans d’un nationalisme philologique et folklorique, qui recueillent les Märchen (contes) comme patrimoine immatériel national et dont le travail participe à l’élévation de la culture populaire au rang de fondement national (Volkstum). On retrouvera un conte collecté par les frères Grimm dans l’opéra Hänsel und Gretel (1868) du compositeur Engelbert Humperdinck (1854-1921).
L’opéra comme outil d’expression du nationalisme allemand
L’opéra est un vecteur d’identité culturelle, comme on le voit principalement en Italie (Verdi), en Russie (Moussorgski, Borodine). Cela va être également le cas en Allemagne, au XIXe siècle. À cette époque, l’opéra allemand doit faire face à l’hégémonie des opéras italien et français dans toute l’Europe. Il va donc y avoir une vraie volonté de créer un opéra spécifiquement allemand qui va agir comme miroir de l’âme allemande empreinte de romantisme, de mythes, de légendes et de fantastique, avec la langue allemande comme instrument d’affirmation identitaire. L’opéra devient alors un outil de construction nationale, au même titre que la littérature et l’histoire.
Nous prendrons comme exemples deux compositeurs emblématiques de cette identité allemande : Carl Maria von Weber et Richard Wagner.
Carl Maria von Weber et la naissance de l’opéra romantique allemand
Carl Maria Ernst von Weber est un compositeur allemand né le 18 novembre 1786 à Eutin, près de Lübeck, et mort le 5 juin 1926 à Londres. Il est surtout connu pour ses deux concertos pour clarinette, et ses opéras Euryanthe (1823), Oberon (1826), mais surtout pour un
des opéras les plus célèbres du répertoire : Der Freischütz (1821).
Le livret de l’opéra, écrit par Johann Friedrich Kind (1768-1843), s’inspire directement d’une légende populaire allemande largement connue au XIXe siècle, celle du « chasseur au tir magique » (Freischütz).
La légende raconte qu’un chasseur conclut un pacte avec le diable pour obtenir des balles magiques qui ne ratent jamais leur cible et qui vont lui permettre de remporter un concours. Cette légende avait été recueillie dans les recueils de contes populaires (notamment ceux des frères Grimm) et faisait partie du patrimoine oral allemand. Cette œuvre s’inscrit au cœur du mouvement romantique allemand, qui valorise les traditions populaires, les légendes et les mythes nationaux.
À lire aussi : L’Allemagne est-elle réunifiée ?
Dans l’univers de Der Freischütz, toutes les composantes de la culture populaire sont là : la Forêt profonde (Wolfschlucht – la Gorge aux loups), lieu mystérieux, surnaturel, terrifiant et sacré, et les croyances populaires avec les pactes diaboliques, les esprits de la forêt, la magie noire et les balles ensorcelées. Le surnaturel se mêle au quotidien paysan. Weber, comme beaucoup de romantiques, croit à l’importance de retrouver une identité nationale à travers la culture populaire, c’est-à-dire la culture du peuple, du Volk, mot difficilement traduisible en français tant il est profondément enraciné dans l’histoire culturelle, politique et philosophique de l’Allemagne.
Der Freischütz a été perçu comme le premier opéra romantique véritablement « allemand », parce qu’il mettait en scène une légende nationale dans une langue vernaculaire, avec des références culturelles germaniques.
Richard Wagner : apogée du nationalisme lyrique
Richard Wilhelm Wagner est né à Leipzig le 2 mai 1813 et mort à Venise le 13 février 1883. Il va jouer un rôle politique important à deux périodes de sa vie : pendant sa jeunesse « révolutionnaire », jusqu’en 1849, où sa participation au mouvement anarchiste et sa présence sur les barricades de Dresde l’obligent à fuir la Saxe ; ensuite, à partir de 1862, et surtout dans les années 1864-65, où il joue les conseillers politiques auprès de Louis II de Bavière (1845-1886). On voit bien ce rôle dans le film de Luchino Visconti Ludwig, le Crépuscule des Dieux (1970). C’est Louis II qui financera en grande partie la construction du Bayreuther Festspielehaus où se tient le Festival de Bayreuth uniquement consacré aux œuvres de Wagner. Ce festival a été inauguré en 1776 avec une représentation du Ring et est devenu le sanctuaire de la musique wagnerienne. Richard Wagner a composé 14 opéras. Parmi ces opéras, sa trilogie, plus précisément, sa tétralogie intitulée « L’Anneau du Niebelung » (Der Ring des Nibelungen), est une œuvre monumentale dans laquelle vont se croiser 3 dimensions : nationalisme, patriotisme et romantisme qui sont intimement liées à la pensée de Wagner et à son époque, le XIXe siècle, marquée par les révolutions, la naissance et la montée du sentiment national allemand et l’influence du romantisme. Il va collaborer avec l’un des frères Grimm, le linguiste Jacob Grimm (1785-1863), auteur d’une Histoire de la langue allemande et de Mythologie allemande et s’inspire des vieux contes germaniques et des histoires des Minnesänger pour rédiger le livret de son opéra « Les Maîtres chanteurs de Nuremberg ». Cet opéra, conçu comme une œuvre légère, est créé le 21 juin 1868, et fait l’éloge de l’art et du génie allemand et incarne un idéal d’humanisme et de patriotisme au travers du personnage de Hans Sachs, inspiré d’un personnage réel : Hans Sachs (1494–1576), poète et maître chanteur de la Renaissance allemande. Wagner se fait l’apôtre de « l’art total » (Gesamtkunstwerk).
On l’oublie trop souvent, mais Wagner est un écrivain très prolifique. Il a écrit des centaines de livres, poèmes et articles, en plus de sa volumineuse correspondance. Ses écrits couvrent un éventail de sujets, comme la politique, la philosophie, ou encore l’analyse de ses propres opéras. Parmi les essais les plus significatifs, on peut citer « L’œuvre d’art de l’avenir » ( Das Kunstwerk der Zukunft) (1849), « Opéra et Drame » (Oper und Drama) (1851) et « Le Judaïsme dans la musique »(Das Judenthum in der Musik) publié en 1850 et réédité en 1869. Ce pamphlet antisémite attaque violemment la présence des Juifs dans la musique allemande, en particulier deux compositeurs juifs célèbres à l’époque : Felix Mendelssohn (1809-1847) et Giacomo Meyerbeer (1791-1864). Les opéras de Wagner seront ensuite récupérés par le régime nazi à des fins de propagande et de mise en avant des mythes germaniques, d’héroïsme, de pureté raciale ainsi qu’une certaine vision d’un monde romantique. Comme dans tout opéra à portée nationale, il faut noter l’importance des chœurs dans l’opéra allemand et, en particulier chez Weber et Wagner, avec leur dimension musicale, bien sûr, mais aussi dramatique et populaire ainsi que la démonstration de l’identité nationale dans l’unité du peuple. On peut citer le « Le Chœur des chasseurs » ( Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen) dans der Freischutz et le « Chœur des pèlerins » (« Chor der Pilger ») de l’opéra Tannhäuser de Richard Wagner.
Le nationalisme musical est-il par nature idéologique ?
On a vu que l’opéra, loin d’être un simple divertissement, a joué un rôle central dans l’émergence d’une conscience nationale allemande.
Mais, peut-on parler d’un lien entre le nationalisme exprimé d’une manière musicale et l’expression d’une idéologie ? Lorsque le compositeur tchèque Bedrych Smetana (1821-1884), dans son opéra « La Fiancée vendue » (Prodaná nevěsta), ou le russe Modeste Moussorgski (1839-1881), avec Boris Godounov, cherchent à mettre en musique « l’âme » d’un peuple, ils construisent et expriment une image idéalisée de la nation. C’est ce que font Weber et Wagner avec des fondamentaux solides : identité nationale, langue allemande, mythes et légendes, références culturelles, folklore, exaltation de l’exception allemande, etc. Il est néanmoins difficile de parler d’idéologie au sens strict du terme, sauf peut-être chez Wagner, chez qui l’opéra agit comme un vecteur d’idées entre identité culturelle nationale et création d’une société nouvelle par l’art total. À partir du Romantisme allemand, Weber et Wagner ont contribué à la construction de l’identité et de « l’âme» allemande, ce que Herder définit comme le Volksgeist, c’est-à-dire une force unique à chaque nation.
Volk
Le mot « Volk« ne signifie pas simplement « peuple » au sens démographique. En allemand, il véhicule des dimensions :
culturelles (le peuple, porteur d’une culture authentique et organique) puis ethniques et nationales (parfois teintées d’un sentiment d’unité raciale ou historique), enfin spirituelles : dans le romantisme allemand, le « Volk » devient une âme collective.
À lire aussi : Allemagne : Olaf Scholz face à l’endettement
Ces dimensions vont participer à la construction d’une culture musicale allemande propre, que nous retrouvons chez Wagner, en particulier des héros « purs » incarnant l’âme du peuple.
À noter : le terme völkisch, dérivé de Volk, qui désigne un courant idéologique allemand né au XIXe siècle, fondé sur une exaltation de l’identité ethnique allemande, de ses racines rurales, de sa langue, de sa mythologie germanique, et souvent associée à des idées antisémites et xénophobes.
Le romantisme allemand
Ce mouvement commence dans les États allemands en 1770 et dure jusqu’au milieu des années 1850. Le romantisme fait partie intégrante de l’âme allemande. Cette expression de l’art est centrée sur la Sehnsucht, mot difficilement traduisible en français qui regroupe une sorte de « vague à l’âme », d’«ardeur» mêlée de « langueur ». Les lieux où cette Sehnsucht apparaît sont les vallées embrumées, les forêts sombres, les ruines d’abbayes ou de châteaux médiévaux, la nature, avec les légendes, les mystères, les mythes anciens, etc. Une sorte de « merveilleux national ». Le mouvement est directement lié à la tradition populaire. On va trouver cette Sehnsucht chez des poètes comme Joseph von Eichendirff (1788-1857), Clemens Brentano (1778-1842), Friedrich Hölderlin (1770-1843), Heinrich Heine( 1770-1843), etc. On retrouve ces thèmes cités plus haut non seulement chez Weber et chez Wagner, mais aussi des compositeurs comme Robert Schumann (1810-1856), Johannes Brahms (1833-1897), Franz Schubert (1797-1828), bien que celui-ci soit autrichien, et des peintres comme Caspar David Friedrich (1774-1840) avec, par exemple, son tableau Le Voyageur contemplant une mer de nuages.
Principaux opéras de Richard Wagner
« Le Vaisseau fantôme » (Der fliegende holländer) 1840-1841.
« Tannhäuser » 1861.
« Lohengrin » 1845-1848.
« Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg » (Die meistersinger von Nuremberg) 1845-1867.
« L’anneau des Niebelungen » (Der Ring des Niebelungen) 1845-1867.
« Tristan et Isolde » 1857-1859.
« Parsifal » 1865-1872.
Pour aller plus loin.
Caron J.L Denizeau G. “Carl Maria von Weber” Ed.Bleu Nuit 2019.
Looten C. “Dans la tête de Richard Wagner » : archéologie d’un génie » Ed.Fayard 2011.
Yoshida, H. (2005). Sur l’idée de la germanité en musique aux XVIIIe et XIXe siècles. Horizons philosophiques, 16(1), 125–135.
https://doi.org/10.7202/801310ar
DE Decker J. « Wagner » Ed.Folio 2010.
À écouter.
Il y a de nombreuses versions des opéras de Weber et, surtout, de Wagner. Le choix ci-dessous est forcément restreint et subjectif !!
Carl Maria von Weber.
Der Freischutz
Janowitz/Schreier/Weidl/Mathis/Adam Carlos Kleiber Staatskapelle Dresden, Rundfunkchor Leipzig.
Richard Wagner.
« L’anneau de Niebelungen » (Der ring des Niebelungen) (Intégrale).
Das Rheingold – Die Götterdämerung – Die Walkyre– Siegfried.
14 CD !! nombreux artistes. Christian Thielemann Orchestre et chœur du Festival de Bayreuth.
« Les Maîtres Chanteurs de Nurnberg » » (Die Meistersinger von Nurnberg)
Edelman/Kopf/Schwarzkopf/Kunz Herbert von Karajan Orchester et chœur du Festival de Bayreuth.
« Le Vaisseau fantôme » (Der fliegende holländer) Stewart/Jones/Ridderbusch Kark Böhm Orechestre et chœur du Festival de Bayreuth.