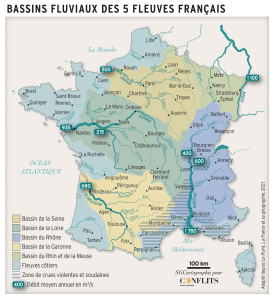L’influence chinoise dans les territoires ultramarins français est un phénomène perceptible sur lequel nous manquons néanmoins de recul. Son caractère multicouche donne à penser à une stratégie globale méticuleusement pensée.
La diaspora, élément autonome sous supervision du PCC
L’influence de la Chine dans les DROM-COM s’exprime d’abord par l’activisme de sa diaspora, présente dans chaque territoire à hauteur de 3 à 5 % de la population. En Guyane, cette minorité contribue à 25 % des recettes fiscales de la Collectivité territoriale (CTG) grâce à son dynamisme commercial. Dans la majorité des outremers, la gastronomie sino-créole, les fêtes du Nouvel An chinois et autres manifestations témoignent d’une imprégnation culturelle. À la Réunion, comme en Polynésie française sont érigés des temples chinois. Cette diaspora chinoise a su également s’ancrer politiquement au travers de tissus associatifs actifs. Des associations comme l’Amitié sino-calédonienne, l’association d’amitié Pacifique-Chine (Polynésie française) ou la Fédération des associations chinoises de la Réunion entretiennent des liens avec les réseaux du Front uni du Parti communiste chinois (PCC). À Papeete comme à Saint-Denis, les consulats chinois et les Instituts Confucius servent de relais d’influence (jumelage de villes, tourisme, culture).
En Guyane, c’est l’association Fa Kiao Kon So, servant d’interlocuteur pour les autorités guyanaises et les autorités chinoises,[1] qui est la plus emblématique. Elle défend les intérêts de la communauté chinoise, facilite l’installation de migrants chinois, pèse dans les décisions municipales, sollicite des financements de la part du PCC, etc.[2] Elle entretient des liens avec l’association surinamaise Kong Ngie Tong Sang dont des membres sont impliqués dans le trafic d’or impactant la Guyane, en lien avec le parti surinamais NDP et le PCC.
Tous ces éléments s’inscrivent dans une volonté du PCC de mobiliser la diaspora chinoise dans le monde afin de promouvoir ses objectifs nationaux (réunification de Taïwan) et internationaux (première puissance mondiale).[3]
Des relais politiques locaux effectifs, mais des liens économiques faibles
Ces réseaux chinois locaux ainsi que ceux du PCC s’activent auprès des élites politiques locales. En Polynésie française, tous les présidents récents ont effectué des visites politiques en Chine, tandis qu’Oscar Temaru et Gaston Flosse avaient soutenu le projet aquacole controversé de l’atoll de Hao, finalement avorté face aux craintes environnementales et économiques. Le Chinois Hiria Ottino a conseillé durant vingt ans les politiciens polynésiens tout en étant président de l’association d’amitié Pacifique-Chine liée au PCC. En Nouvelle-Calédonie, Pékin tente de nouer des liens avec les indépendantistes kanaks, tandis qu’à la Réunion, la famille Vergès a historiquement travaillé à un rapprochement entre le parti communiste réunionnais et le PCC.
L’implication économique chinoise dans les DROM-COM demeure globalement dérisoire avec quelques projets d’envergure avortés en Polynésie française, ainsi que quelques échanges touristiques avec la Réunion limités par la taille du marché et freinés par les législations françaises. Si la Chine absorbe 90% des exportations de nickel de Nouvelle-Calédonie et représente 40% de ses exportations totales, elle est largement devancée par la Métropole dans les échanges.
En Guyane, ce sont les réseaux mafieux chinois implantés au Suriname et ayant des relais sur le territoire guyanais (associations, commerces, etc.) qui permettent l’extraction illégale de 7 à 10 tonnes d’or annuellement. Jouissant de la complicité des autorités surinamaises et chinoises, ces réseaux vendent du matériel d’extraction aurifère, font des crédits, rachètent l’or extrait, le blanchissent et le mettent sur le marché international.
Entre pensée stratégique globale et opportunisme local : les raisons de l’intérêt chinois
Quoique multiforme et innovante, l’influence chinoise dans les DROM-COM ne relève pas d’un plan ciblant spécifiquement ces territoires, mais d’une stratégie globale de projection d’influence dans le monde. Ces territoires français rentrent dans une logique géographique de quête de points d’appui servant la RPC en plusieurs points : étendre ses routes maritimes, accéder aux ressources naturelles et casser l’isolement géopolitique imposé par les alliances américano-asiatiques dans le Pacifique.[4]
Comme aux îles Salomon, au Tonga et au Vanuatu, la RPC tente de s’impliquer en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans une stratégie de « counter-containment ». L’idée est de contourner la double ceinture formée par les bases militaires étasuniennes situées au Japon, aux Philippines, à Guam, etc. Quant à la Réunion, celle-ci est située au croisement des routes maritimes entre l’océan Indien, l’Afrique et l’Antarctique. La Réunion est aussi le centre de commandement des FAZSOI veillant à la souveraineté de territoires français convoités pour leur position et leurs ressources (Mayotte, îles Éparses, TAFF). En Guyane, les intérêts économiques de la Chine, de ses diasporas et des réseaux criminels chinois se rencontrent comme il est fréquent en Amérique latine et ailleurs dans le monde.
L’influence de la Chine ou le catalyseur des faiblesses étatiques françaises en Outre-mer
Catalyseur des tensions locales, la tentative d’influence chinoise a le mérite de révéler les faiblesses de la puissance publique française dans ces territoires éloignés. Les DROM-COM souffrent de déficits structurels eu égard aux standards de la Métropole avec un chômage plus élevé (jusqu’à 30%), une pauvreté décuplée (77 % à Mayotte, 53% en Guyane, etc.), une mortalité infantile plus haute, un PIB par habitant moindre et des écarts de prix à la consommation parfois indécents (55% en Polynésie, 44% en Nouvelle-Calédonie).
Les DROM-COM souffrent également d’une dépendance économique vis-à-vis de la Métropole ; sorte d’héritage du modèle colonial de l’exclusivité. Par exemple, en 2022, 78,5% des produits alimentaires en étaient importés en moyenne,[5] tandis que 1/4 des emplois en Guyane étaient publics et les dépenses publiques contribuaient autant au PIB réunionnais que la dépense des ménages.
Enfin, historiquement, « les politiques nationales ne prennent pas […] en compte la dimension ultramarine »[6] de la France, conséquence d’une ignorance de la part des élites métropolitaines quant à la réalité des Outremers. C’est là en partie le résultat de la suppression de l’École nationale de la France d’outre-mer, de la diversification des statuts constitutionnels et de l’universalisme républicain en général.
Ces frustrations génèrent des crises sociales et politiques récurrentes virant parfois aux revendications autonomistes, voire indépendantistes, sur lesquels le discours chinois peut capitaliser. Face aux insuffisances économiques, la RPC a tout l’air d’un partenaire alternatif idéal. Cela dit, il faut relativiser l’emprise chinoise : en Nouvelle-Calédonie, les projets politiques de Pékin n’ont pas abouti. En Polynésie, les grands projets économiques chinois sont au point mort. La lourdeur administrative française, véritable frein à toute initiative économique locale, agit ici paradoxalement comme une protection face aux ingérences extérieures.
Repenser la stratégie française en Outre-mer : de la réaction à l’action
L’activisme chinois met en lumière la nécessité pour la France de refonder sa relation avec ses DROM-COM. Face aux difficultés économiques des DROM-COM intrinsèques à leur éloignement, à leur isolement régional et à leurs coûts de production élevés, l’État français se complaît dans un interventionnisme non productif (aides sociales, régulations normatives, plans d’urgence, dette, etc.) accroissant davantage leur dépendance à la Métropole. Au lieu d’agir comme un pompier pyromane, l’État devrait investir dans les secteurs productifs en s’érigeant comme un entrepreneur public, sur le modèle des fonds souverains norvégien et marocain.
En dépit des changements de gouvernements, il faut conserver pour les DROM-COM un ministère de plein exercice et y attacher des collaborateurs locaux. La France doit également occuper les champs médiatique et académique (centres de réflexion basés dans les Drom-Com).
Les DROM-COM souffrent d’un manque d’intégration régional. Tranchant avec l’État centralisé, il faut mieux répartir les compétences entre l’État et ces collectivités territoriales éloignées définies par le Code général des collectivités territoriales (intégration régionale, commerce et accords régionaux, etc.). Il faut également revoir les règles européennes en octroyant le régime de région ultrapériphérique (RUP) à tous les DROM-COM en le faisant évoluer, sinon en sortant tout simplement ces territoires de l’UE.
Enfin, il faut intégrer les DROM-COM à la pensée stratégique globale de la France dans le monde. En mettant à profit le positionnement de chaque DROM-COM dans les différentes parties du globe, ils serviront de relais géographiques aux stratégies régionales de la France. Par exemple, le concept nébuleux et vaste d’Indopacifique doit être décliné localement, au travers des DROM-COM.
[1] MENET Simon, BONDAZ Antoine, “Comptoirs et réseaux transnationaux chinois, moteurs de l’orpaillage illégal en Guyane française”, Recherches et Documents, Fondation pour la recherche stratégique (FRS), septembre 2023, page 18
[2] Dubost Isabelle, « L’association chinoise Fa Kia Kon So de Guyane: enjeux de pouvoir, frontières ethniques et travail communautaire », (dir.) Gérard Collomb et Serge Mam Lam Fouck. Mobilités, ethnicités, diversité culturelle: la Guyane entre Surinam et Brésil. Eléments de compréhension de la situation guyanaise, Ibis Rouge Editions, pp.233-255, 2016
[3] YUE Gu, “Xi Jinping a donné des instructions importantes sur les affaires chinoises d’outre-mer, Li Keqiang a donné des instructions”, Agence de presse Xinhua, (习近平对侨务工作作出重要指示 李克强作出批示 ; 新华社 ; 谷玥),
[4] Yu Chang Sen, The Pacific islands in Chinese geo-strategic thinking, National center of Oceania Studies, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China, 23rd February 2015
[5] Outre-mer : une forte dépendance aux importations alimentaires, Site gouvernemental officiel Vie publique, 24 juillet 2023
[6] M. Philippe FOLLIOT, Mmes Annick PETRUS et Marie-Laure PHINERA-HORTH, Rapport d’information sénatorial au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer, Les outre-mer au cœur de la stratégie maritime nationale, 24 février 2022, page 25