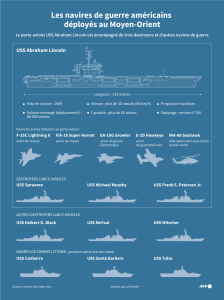La politique étrangère du président Erdoğan ne peut pas s’expliquer uniquement par son instinct stratégique. Une cause essentielle se trouve dans la faiblesse de l’opposition en Turquie, dont le poids historique et l’incapacité à bâtir des alliances donnent à Erdoğan la marge de manœuvre dont il a besoin sur la scène internationale.
Un texte de Diyako Baroz. Chroniqueur social norvégo-kurde. Parution originale : Geopolitika.
La division politique interne de la Turquie n’est pas seulement une affaire nationale ; elle façonne le rôle du pays comme un acteur imprévisible et décisif sur la scène mondiale. Alors que les yeux du monde sont souvent tournés vers les manœuvres de politique étrangère du président Recep Tayyip Erdoğan, une part essentielle de l’explication de sa liberté d’action réside dans la faiblesse de l’opposition nationale. Une analyse des échecs stratégiques du principal parti d’opposition, le CHP (Parti républicain du peuple), révèle comment cela a permis à Erdoğan de poursuivre une politique étrangère toujours plus assurée et transactionnelle.
Une opposition affaiblie
Le CHP est le dépositaire de l’héritage kémaliste, une idéologie forgée durant la première phase de la République comme parti unique. Cet héritage est profondément ambivalent : d’un côté, il a impulsé une modernisation impressionnante, une sécularisation et l’introduction de principes juridiques occidentaux. De l’autre, il s’est construit sur un nationalisme autoritaire et intransigeant. L’objectif était de créer une nation turque homogène. Cela impliquait une politique active d’oppression des identités minoritaires, dont la kurde était la plus marquante. Par des déplacements forcés, l’interdiction de la langue et une répression brutale des révoltes, comme à Dersim en 1937-38, la diversité culturelle de l’Anatolie était perçue comme une menace pour le nouvel État unifié.
Bien que le CHP ait tenté de se réformer et de séduire un électorat plus urbain et libéral, les réflexes nationalistes demeurent profondément ancrés. Cela explique pourquoi le parti a été si ambivalent et paralysé face à « la question kurde ». Chaque fois qu’un processus de paix a été lancé, le CHP est resté en retrait, pris entre le désir de paraître démocratique et la crainte d’aliéner son noyau électoral nationaliste traditionnel.
Un exemple clé est la façon dont le parti a géré le soutien du parti pro-kurde DEM. Lorsque le DEM a apporté son soutien décisif et informel aux candidats du CHP lors d’élections locales importantes, c’était une invitation historique à bâtir une large alliance démocratique. Mais le CHP n’a jamais saisi cette main tendue avec le respect et le sérieux qu’elle méritait. Il voulait les voix, mais évitait l’alliance politique. Le résultat fut l’effritement de la confiance fragile.
Les répercussions géopolitiques
Cette absence d’une opposition unie et fonctionnelle a des conséquences géopolitiques directes.
Un pouvoir présidentiel renforcé. Sans véritable pression intérieure, Erdoğan a pu consolider son pouvoir et diriger la politique étrangère avec un minimum de contrôle et d’opposition. Cela rend possibles des changements rapides et tactiques d’alliances, comme on l’a vu dans les relations avec la Russie, l’OTAN et les acteurs du Moyen-Orient. La politique turque devient plus dépendante de la personne et moins ancrée institutionnellement.
Le nationalisme comme outil de politique étrangère. La question kurde non résolue est utilisée activement comme un instrument de politique extérieure. Les opérations militaires en Syrie et en Irak contre les groupes kurdes servent également à mobiliser la base nationaliste à l’intérieur du pays et à diviser davantage l’opposition. Le CHP se retrouve paralysé, craignant d’apparaître « anti-patriotique ».
Un allié imprévisible. Pour les partenaires occidentaux, notamment au sein de l’OTAN, l’absence d’une opposition forte et unie signifie qu’il existe peu d’alternatives à la ligne d’Erdoğan. Une politique intérieure plus démocratique et pluraliste, qu’une alliance fonctionnelle CHP-DEM aurait pu incarner, aurait probablement conduit à une politique étrangère plus prévisible et institutionnalisée.
Manœuvre stratégique
L’approche d’Erdoğan vis-à-vis du parti DEM illustre clairement sa manœuvre stratégique. Doté d’un sens politique aiguisé, il exploite la division dont il a conscience, non pas pour résoudre la question kurde, mais pour s’assurer un soutien aux amendements constitutionnels qui pourraient consolider son pouvoir. On voit encore une fois comment les manœuvres de politique intérieure sont indissociables de ses objectifs stratégiques à long terme.
Une opposition turque faible et divisée n’est pas seulement un obstacle au développement démocratique du pays. Elle est une condition essentielle de la liberté d’action d’Erdoğan en politique étrangère et de l’émergence de la Turquie comme puissance indépendante mais instable. Tant que le CHP ne rompt pas définitivement avec son propre fardeau historique, il continuera de marquer des buts contre son camp, avec des conséquences qui dépassent largement les frontières de la Turquie.