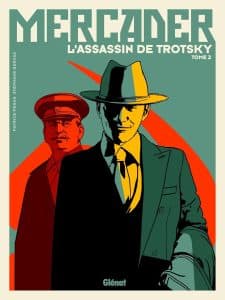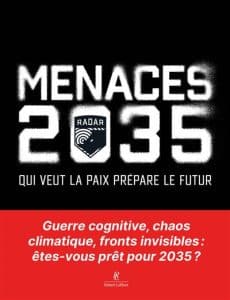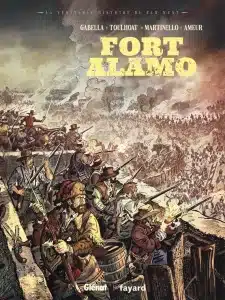Empire mongol, empire russe et Hanna Arendt. Aperçu des livres de la semaine.
Jean-Paul Roux, Histoire de l’empire mongol, Tallandier (coll. « Texto »), 2025, 14,90 euros
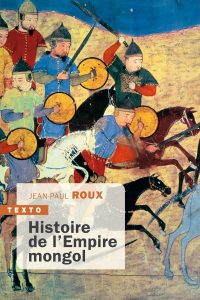
La première partie est consacrée à Temüjin/Gengis Khan : son ascension dans le contexte de la steppe mongole divisée, sa capacité à briser les solidarités claniques pour leur substituer une loyauté personnelle et un système de promotions fondé sur le mérite. Roux insiste sur ce point : la grande innovation politique de Gengis Khan est moins technique que sociale – il fait passer une société de la parenté à une société de l’obéissance.
Viennent ensuite les grandes campagnes : contre les Xia occidentaux et les Jin en Chine du Nord, contre le Khwarezm de Muhammad Shah, puis les raids jusqu’en Russie méridionale. L’auteur met bien en valeur la combinaison typiquement mongole de violences extrêmes (massacres, terreur psychologique) et de sens pratique (protection des artisans, intégration des ingénieurs chinois et persans, souci de la circulation commerciale). Les chapitres sur les successeurs – Ögödei, puis la phase des grands khanats – montrent comment, après la mort de Gengis, l’empire se fragmente en quatre grands ensembles (Yuan en Chine, Ilkhanides en Iran, Horde d’Or, Djaghataï), chacun adapté à son environnement, mais relié par un même héritage politique.
Signe fort, loin d’être archaïque, le nomadisme mongol est présenté comme une organisation hautement efficace pour la guerre longue distance : cavalerie légère, logistique souple, capacité à opérer dans le froid comme dans les steppes sèches. C’est parce qu’ils n’étaient pas « sous-développés », mais adaptés à leur milieu que les Mongols ont vaincu. L’empire mongol a tenu tant que la lignée de Gengis imposait son autorité et que le butin demeurait abondant. À mesure que les conquêtes se ralentissent et que les élites se sédentarisent, les tensions dynastiques et régionales l’emportaient.
Un apport précieux du livre est de rappeler que la domination mongole n’a pas été seulement destructrice : elle a aussi permis une pax mongolica qui a sécurisé les routes eurasiatiques, favorisé la transmission des techniques, des hommes et des idées, et donné leur plein effet aux réseaux marchands (surtout iraniens et ouïghours). Roux, qui connaît bien le monde turco-iranien, montre combien l’empire mongol fut en réalité un empire composite, où les élites mongoles dirigeaient, mais où l’administration, la fiscalité, l’art et l’urbanité étaient souvent le fait de peuples soumis. Si l’empire unifié a disparu, les cadres politiques, militaires et fiscaux qu’il a imposés en Chine, en Iran ou en Russie marquent durablement ces régions (sinisation sous les Yuan, émergence timouride à partir d’un fonds mongol, affirmation des princes russes à l’ombre de la Horde).
Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, Gallimard, coll. « Folio essais », 2025, 15,50 €
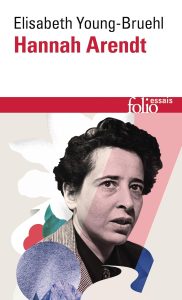
L’intérêt majeur du livre est de lier de façon continue vie privée, réseaux d’amitié et production théorique. Le rapport trouble à Heidegger, l’attachement fidèle à Jaspers, le mariage avec Heinrich Blücher, l’engagement dans les milieux d’exilés, tout cela n’est pas raconté pour satisfaire une curiosité biographique, mais pour éclairer la genèse de notions comme la pluralité, la natalité ou le jugement. Young-Bruehl montre par exemple combien l’expérience de l’apatridie et de la perte de droits a préparé Les Origines du totalitarisme et la réflexion sur la déchéance de la citoyenneté.
L’ouvrage revient aussi avec précision sur les controverses, en particulier l’affaire Eichmann. Arendt y est restituée non comme une provocatrice froide, mais comme une penseuse soucieuse de sauver la possibilité même de juger après Auschwitz. Young-Bruehl replace la formule « banalité du mal » dans l’ensemble de son œuvre et démonte les lectures hâtives qui en ont fait un mot d’ordre. Elle insiste de même sur un point trop souvent oublié : Arendt n’est pas une théoricienne de l’identité juive, mais une penseuse politique qui part du fait juif pour interroger le monde moderne.
La force de ce livre tient enfin à son ton : ni hagiographique ni à charge. Parce qu’elle a connu Arendt, Young-Bruehl sait donner chair à une personnalité parfois perçue comme austère : son humour, son goût des salons new-yorkais, son exigence amicale, son refus de devenir « philosophe académique ». On referme cette biographie en comprenant mieux ce que signifiait pour Arendt « aimer le monde » : non pas l’approuver, mais le juger pour pouvoir y prendre part. C’est ce mouvement que ce volume restitue avec une remarquable clarté.
Arendt part d’un fait très géopolitique : l’effondrement des empires européens et l’apparition de masses d’apatrides après 1918. Dans Les Origines du totalitarisme, qu’explique très bien Young-Bruehl, la question n’est pas seulement morale, c’est une question d’architecture internationale : que devient un individu quand l’État qui lui garantissait des droits disparaît ? Par ailleurs, Arendt reste l’une des meilleures analystes de la façon dont un pouvoir moderne cherche à totaliser l’espace humain. Pour qui réfléchit à la Russie soviétique, à la Chine maoïste, aux expériences révolutionnaires ou aux appareils sécuritaires d’aujourd’hui, la biographie rappelle comment Arendt distingue la terreur (instrument) et le totalitarisme (projet d’ingénierie sociale). Young-Bruehl replace cela dans la trajectoire d’Arendt et donne des clés de lecture pour éviter les analogies paresseuses. Enfin, Arendt est une intellectuelle juive qui critique Israël, une Européenne exilée qui critique l’Europe coloniale, une antinazie qui critique certains usages du procès Eichmann : autrement dit, elle refuse la logique des camps. Pour un lecteur de géopolitique, c’est précieux : cela rappelle qu’on peut analyser les puissances, les blocs, les guerres de mémoires sans épouser le récit des acteurs. Young-Bruehl montre très bien ce style de pensée, qui est exactement ce qu’on attend d’une revue de géopolitique réaliste comme Conflits.
Lukas Aubin, Géopolitique de la Russie, La Découverte, coll. « Grands Repères », éd. mise à jour 2025, 18 €
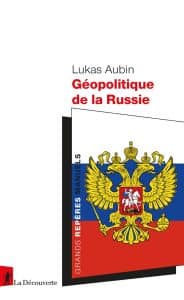
Le point de départ est géographique : un État trop vaste, peu densément peuplé, à la recherche de « profondeurs stratégiques », obsédé par la sécurisation de ses marges – Baltique, mer Noire, Caucase, Arctique. De là découle l’idée que la Russie ne peut être en sûreté qu’en contrôlant son voisinage, ce que Moscou continue d’appeler son « étranger proche ». Aubin montre bien comment cette donnée ancienne a été réactivée par Vladimir Poutine pour justifier l’interventionnisme russe, d’abord en Géorgie, puis en Ukraine, puis en Syrie, avec l’ambition de se réimposer comme puissance d’ordre dans l’espace post-soviétique.
La deuxième clé est le récit. L’auteur revient sur la recomposition du roman impérial russe – mélange de tsarisme, de mémoire de la Grande Guerre patriotique et d’orthodoxie politique – qui autorise le Kremlin à parler au nom d’une « civilisation » russe distincte de l’Occident libéral. Ce passage est utile parce qu’il explique pourquoi la guerre ne se joue pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans l’histoire, les symboles et la langue.
Troisième bloc : les outils. Aubin passe en revue l’arsenal classique (armée modernisée, dissuasion nucléaire), mais aussi les vecteurs de puissance de substitution : énergie, information, influence en Afrique, diplomatie du sport – un sujet sur lequel il est l’un des meilleurs spécialistes. Il insiste sur la capacité russe à faire beaucoup avec peu, en profitant des failles occidentales et de la multipolarisation accélérée depuis 2022. La mise à jour 2025 intègre l’élargissement des BRICS et le rapprochement tactique avec l’Iran, qui offrent à Moscou des relais pour contourner les sanctions et continuer la guerre « au long cours ». (C’est l’un des chapitres les plus actuels du volume.)
On peut formuler deux réserves, mineures. D’abord, la focale reste très centrée sur l’État et le sommet du pouvoir : la société russe, ses fractures, ses exils, ses économies parallèles sont moins présentes. Ensuite, l’auteur va vite sur les limites structurelles de la Russie (démographie, dépendance technologique, coût de la guerre) qui pèsent pourtant sur la viabilité du projet poutinien. La force du livre est de montrer que Moscou n’est pas un acteur irrationnel : elle suit une logique historique, géographique et politico-identitaire cohérente – mais une logique coûteuse, qui la met durablement en collision avec l’Europe.
François Cusset, French Theory, Foucault, Derrida, Deleuze, &Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, La Découverte, 2025, 14 euros.
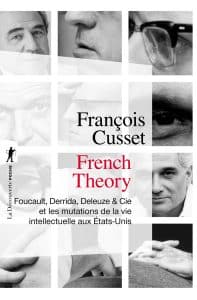
La thèse centrale est double. Il y a d’abord la circulation transatlantique qui a produit une French Theory spécifiquement américaine, distincte de ses matrices européennes. Ensuite, cette migration intellectuelle a eu des effets concrets sur les pratiques universitaires, les controverses publiques et certaines mobilisations sociales.
De ce va-et-vient retour vers l’Europe, mais aussi l’Amérique latine, on pourrait s’interroger sur ce que deviennent en France les lectures américanisées.
Signalons également la parution chez le même éditeur d’une BD éponyme (French Theory. Itinéraires d’une pensée rebelle) coédité par la Découverte et Delcourt avec le scénario de François Cusset et le dessin de Thomas Daquin. Dans cet album aux allures de roman graphique, les auteurs offrent une porte d’entrée, narrative et visuelle, tout en couleur, de cette aventure de la pensée. Là aussi les notions clés comme celles de déconstruction, biopolitique, simulacres, désirs… y apparaissent avec en toile de fond les scènes de campus et les débats enfiévrés. Une belle introduction à un sujet qui plus que jamais prête le flanc à la polémique.