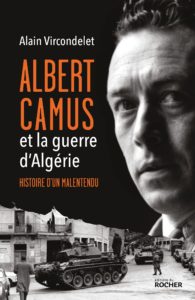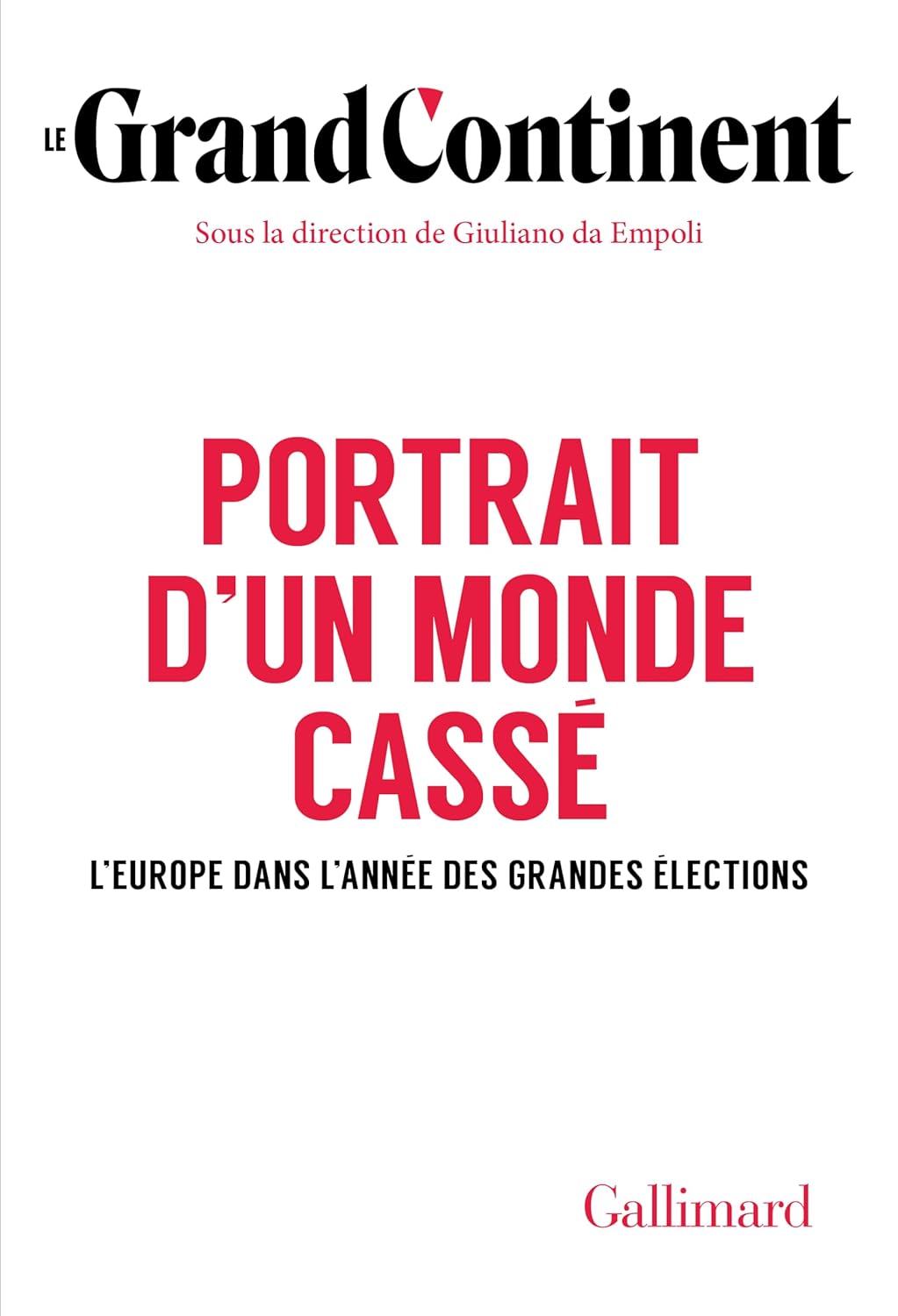Vingt jours avant l’émeute d’Alger qui ouvre la « semaine des barricades », Albert Camus est mort dans le choc d’une Facel-Vega contre un platane. C’était le 4 janvier 1960. Depuis, lequel de ses lecteurs ne s’est posé la question : s’il était resté vivant, la fin sanglante de la guerre d’Algérie l’aurait-elle tiré du silence ?
Alain Vircondelet, Albert Camus et la guerre d’Algérie. Histoire d’un malentendu, Monaco, éditions du Rocher, 2022, 304 p.
Alain Vircondelet n’a pas perdu son temps à résoudre l’énigme et il ne s’est pas risqué à faire parler un mort. Pour éclairer les convictions de Camus, comprendre la position inconfortable dans laquelle il s’est trouvé, il a repris les grandes lignes de sa biographie. Et il l’a fait comme s’il était son porte-parole ; le parti-pris rend son récit plus attachant, il lui vaut aussi quelques faiblesses[1].
Quels éléments ont façonné la perception que Camus pouvait avoir de la guerre ? Ses origines pauvres, son empathie pour la misère, l’enquête qu’il a menée en Kabylie en 1939, ses convictions de gauche, son travail à L’Express ? Peut-être aussi des problèmes familiaux, des maîtresses exigeantes, la maladie mal domptée, le marigot littéraire, les pressions incessantes, le temps qui file ?
Et qu’a donc fait Camus en relation avec l’Algérie, depuis novembre 1954 jusqu’à la fin de l’année 1959 ? Chaque année, il est venu à Alger retrouver sa mère et son frère pour de courtes périodes. Vivant à Paris, il est resté en contact avec ses amis qui l’informent de la marche de la guerre. En janvier 1956, il a lancé un appel à la Trêve civile, trêve du sang. Puis, rejeté dans les ténèbres extérieures par les intellectuels autant que par les « ultras », il a affiché son silence en continuant, sans en faire état, à demander grâce au président de la République pour des condamnés à mort.
Solitude et prix Nobel
Au long de cet ouvrage, la solitude de Camus ne cesse de grandir. Il a pourtant rempli beaucoup des engagements requis pour rester membre des cercles progressistes. Avant-guerre, il a adhéré — peu de temps — au parti communiste algérien, puis il a résisté, par ses articles dans la presse ; la Libération l’a enthousiasmé en dépit des six mois d’anarchie qui ont suivi et il a gardé l’espoir d’une rénovation profonde du pays. Il a signé la plupart des pétitions anticolonialistes et n’a pas ménagé sa plume pour adresser lettres et tribunes au Monde. Mais il a demandé un bénéfice d’inventaire pour l’héritage communiste. Pourquoi les procès iniques, pourquoi le goulag, pourquoi l’enlèvement de 15 000 enfants par les communistes grecs[2], pourquoi la Pologne, pourquoi Budapest ?
À lire également
Entre histoire et mémoire (4) : lectures sur la Guerre d’Algérie – Ferhat Mehenni
Quand il a fait connaître ces réserves, le milieu auquel il appartenait, celui des hommes de lettres portés par les croyances de l’après-guerre, l’a mis au ban. Et les attaques se sont accrues au rythme de ses succès. À l’automne 1957, son prix Nobel est un comble. Jalousie d’abord, indignation tout de suite après : Camus a reconnu qu’il préférait sa mère à la justice !
De quoi la mère pourrait être justiciable ? Camus ne parle pas d’une abstraction (la mère patrie…) mais de celle qui l’a mis au monde, Catherine Sintès, sourde et illettrée, parlant à peine. Cette phrase qui oppose, quelle qu’en soit la version (il en existe plusieurs), la mort d’une innocente à la justice, cette phrase est simplement idiote. La justice et le bon sens commandent de défendre la mère et de condamner les assassins. Emporté par l’émotion, entraîné par les mots, Camus a dit n’importe quoi. Il va connaître le malheur des modérés ; en concédant à l’adversaire que le terrorisme pouvait être l’expression de la justice, il a tendu le bâton pour se faire battre.
« Naïfs boy-scouts d’une cause perdue[3] »
Son appel à la trêve civile lancé depuis Alger, le 22 janvier 1956, est maintenant bien connu. Charles Poncet, l’un de ses amis les plus proches, s’en est fait l’interprète ; d’autres témoins ont aussi livré leurs souvenirs[4]. « Pour [Camus], l’Algérie, en 1956, n’est pas une nation, mais une terre habitée par deux peuples, nés sur cette même terre, et qui forment à eux deux une véritable patrie. Il est donc impossible d’en chasser l’un[5]. » Les deux communautés doivent se rejoindre et maintenir une vie commune, quel que soit l’avenir. À la fin de l’année 1955, ses amis libéraux ont persuadé Camus de former un parti de la Trêve qui rassemblerait musulmans et pieds-noirs de bonne volonté afin d’empêcher « les noces sanglantes du terrorisme et de la répression[6]. » C’est bien vu, mieux que les condamnations du « terrorisme aveugle » qui vont suivre.
L’objectif du cercle était, comme l’écrit Poncet, de « débourrer les crânes pieds-noirs pour arriver à une meilleure compréhension des communautés[7] ». Mais le parti des libéraux est-il mieux dégrossi ? Quelques jours avant l’appel qu’il va lancer, Camus assiste, incognito, à l’une de leurs réunions : « Les intervenants se classaient en trois types : le musulman amer qui vient affirmer sa sympathie militante pour la rébellion, le pénitent européen qui se lève pour appuyer les dithyrambes du premier et l’Européen encore lucide qui veut parler raison et qu’on fait taire. » Camus s’en va avant la fin. « Qu’est-ce qu’ils veulent ? Qu’on tombe le pantalon ? » C’est dit avec l’accent[8].
À lire également
Entre histoire et mémoire : lectures sur la guerre d’Algérie (2)
En dépit de sa célébrité — Camus a été reçu par le gouverneur, par le maire d’Alger et par l’archevêque —, une seule salle a accepté d’accueillir sa réunion publique, le Cercle du Progrès, tenu pour un haut lieu de l’islamisme, en bordure de la casbah. Le service d’ordre est assuré par des étudiants et des scouts musulmans, commandés par un beau-frère de Yacef Saâdi. Poncet découvrira, vingt ans plus tard, que trois des quatre des musulmans fondateurs du parti de la Trêve appartenaient au « brain-trust national de la Révolution algérienne[9] ». Dépendant de leurs amis musulmans, l’écrivain et son cercle s’aliénaient la masse des Pieds-noirs sans pour autant infléchir les objectifs du FLN. L’appel de Camus s’est achevé par un appel à pouvoir « vivre en hommes libres, c’est-à-dire comme des hommes qui refusent à la fois d’exercer et de subir la terreur. »
Camus reprend l’avion pour Paris le 25 janvier. Un mois plus tard, des hommes du commando d’Ali Khodja assassinent neuf voyageurs sur la route de Sakamody ; et le 18 mai, les mêmes tendent l’embuscade de Palestro. Outre la mort, les victimes ont subi le viol ou la mutilation. Camus est accablé ; le parti de la Trêve est devenu celui de l’impuissance[10]. « L’auteur se retirait silencieusement et laissait à la réalité le soin de baisser le rideau[11]».
La somme des malentendus
Deux ans plus tard, Il publie les Chroniques algériennes[12], qui défendent « le seul avenir acceptable : celui où la France, appuyée inconditionnellement sur ses libertés, saura rendre justice, sans discrimination, ni dans un sens ni dans l’autre, à toutes les communautés de l’Algérie. » La proposition est sans le moindre effet.
Le 5 mars 1958, alors que la marche au pouvoir a commencé pour lui, de Gaulle rencontre Camus venu tâter le terrain. « Entretien avec de Gaulle. Comme je parle des risques de troubles si l’Algérie est perdue et en Algérie même de la fureur des Français d’Algérie : « La fureur française ? J’ai 67 ans et je n’ai jamais vu un Français tuer d’autres Français. Sauf moi[13]. »
Il n’y aura pas d’autres rencontres entre les deux hommes dont l’échange ne laissait entrevoir de solution au problème algérien. Le retour au pouvoir du Général est cependant alors perçu comme une promesse d’Algérie française, tant par les Algérois acteurs du pronunciamiento du 13 mai, que par les intellectuels parisiens partisans de l’indépendance de l’Algérie. L’ouvrage d’Alain Vircondelet donne ainsi quelques aperçus étonnants de la violence de l’anti-gaullisme de ces derniers qui s’exprime dans la revue 14 Juillet. C’est un aspect bien oublié de cette période.
Muré dans le silence, Camus voyage en Grèce, en Italie, aux sources de la lumière méditerranéenne. Il renouvelle ses conquêtes féminines. Quand son destin s’achève, il laisse un manuscrit inachevé, Le Dernier homme, une autobiographie qui l’enracine à Mondovi[14].
À lire également
Entre histoire et mémoire : lectures de la guerre d’Algérie (3). Les épurations dans l’armée
[1] Des lapsus (Roland Dorgelès pour Emmanuel Roblès, p. 118), La Question au lieu du Témoin, p. 166), des confusions (Michel Debré n’était pas député-maire d’Amboise en 1958) et, ce qui est plus gênant, une méconnaissance de l’armée dont le personnage central aurait été le général (en réalité colonel) Bigeard, dont les ambitions sont pourtant mal appréciées : « Décimer des katibas entières de plus de cent hommes, tel est l’objectif de Bigeard » (p. 177).
[2] Sur ce sujet, la quête de Nicholas Gage, Eleni, Paris, Lafond, 1984.
[3] L’expression est de Charles Poncet, Camus et l’impossible trêve civile, Paris, Gallimard, 2015, p. 218.
[4] Parmi les sources figurent les carnets de Camus, la solide éditions du récit de Charles Poncet (Camus et l’impossible trêve civile, suivi d’une correspondance avec Amar Ouzegane, Paris, Gallimard, 2015, 330 p.), le récit d’André Rossfelder (Le Onzième commandement, Paris, Gallimard, 2000). Ont aussi été publié les récits de Mohamed Lebjaoui et d’Amar Ouzegane, ce dernier ayant fourni à Charles Poncet un long mémorandum présentant le point de vue du FLN (Camus et l’impossible trêve civile, pp. 178-200).
[5] Ibid., p. 114.
[6] Ibid., p. 116.
[7] Ibid., p. 175.
[8] André Rossfelder, Le Onzième commandement, p. 388.
[9] Camus et l’impossible trêve civile, p. 215.
[10] Le Onzième commandement, lettre de Camus du 27 février 1956, p. 403.
[11] Camus et l’impossible trêve civile, p. 118.
[12] Actuelles, tome 3. Chroniques algériennes (1939-1958), Paris, Gallimard, 1958, 216 p.
[13] Carnets (tome 3), mars 1951 – décembre 1959, Paris, Gallimard, 2013, p. 255.
[14] Publié en 1994 chez Laffont.