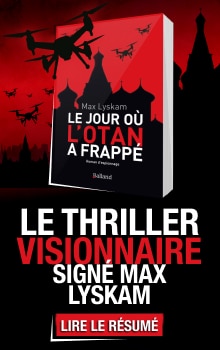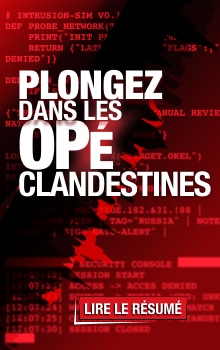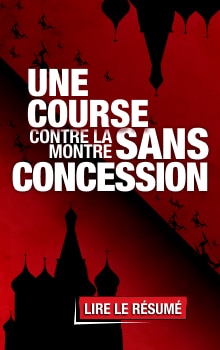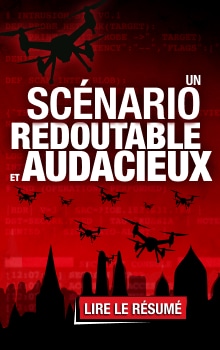Face à la longue détention de Boualem Sansal dans les geôles algériennes, la question de sa nationalité, c’est-à-dire du droit pour un pays à le considérer comme un ressortissant, interroge. Quand la France peut-elle se prévaloir de la nationalité française d’une personne auprès du gouvernement algérien ?
Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée
En réalité, depuis la colonisation de l’Algérie, la question de la nationalité demeure une question complexe. Ainsi, en juillet 1865, Napoléon III avait souhaité accorder la nationalité française à toutes les personnes vivant en Algérie, ce qui supposait notamment l’acceptation du Code civil français. Mais sous l’influence des imams, la très grande majorité des Algériens de confession musulmane ont refusé cette proposition, qui se concrétisa toutefois pour les Algériens de confession juive avec les décrets Crémieux de 1870.
Après différents textes, une loi du 7 mai 1946 décide que tout Algérien est de nationalité française, et par conséquent en possession d’une carte d’identité française et d’une carte électorale. En 1962, l’indépendance de l’Algérie ouvre une nouvelle page à la question de la nationalité. La France décide, par d’ordonnance du 21 juillet 1962, que si elles sont domiciliées en France, les personnes de statut musulman natives d’Algérie peuvent souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité́ française.
Par la suite, il faut bien constater la multiplication des doubles nationaux. De nombreuses personnes nées et vivant en France, et descendantes de cette immigration algérienne qui s’est fortement déployée dès les premières années de l’indépendance, se trouvent de nationalité française en vertu du droit français, qui combine des éléments de droit du sol (jus soli) avec le droit du sang (jus sanguinis). Quant à l’Algérie, elle applique l’allégeance perpétuelle musulmane, un intégral jus sanguinis qui veut que tout descendant d’un Algérien de sexe masculin peut obtenir un passeport algérien et ne peut renoncer à sa nationalité algérienne.
Puis, dans les années 1980, la France considéra qu’elle se devait de reconnaître l’existence des doubles nationaux franco-algériens. Selon des accords signés en octobre 1983, il est décidé que ces doubles nationaux peuvent choisir le pays dans lequel ils désirent effectuer le service militaire et cela les dispense du même service dans l’autre pays. La France veut ignorer la dimension politique et idéologique de la formation dispensée aux conscrits en Algérie. Cet accord ne va s’éteindre qu’en raison de la fin du service national en France.
À lire aussi : « France-Algérie, Le double aveuglement » de Xavier Driencourt
Depuis, la situation demeure ambivalente. La France reconnaît la double nationalité, mais l’Algérie exclut qu’une personne qu’elle considère de nationalité algérienne en mette en avant une autre. Cela a par exemple été mis en évidence lors de l’affaire Nahel, ce jeune de 17 ans né en France et mort en 2023. Or, le 29 juin 2023, le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué demandant à la France d’« assumer pleinement son devoir de protection » envers les Algériens de France. Or, la grande majorité de ces derniers ont en réalité la nationalité française et, en droit international, un binational ne doit être considéré comme uniquement le ressortissant de l’État où il réside.
Notons aussi que, si l’Algérie, comme la France, acceptait le droit de renoncer à sa nationalité, Sansal aurait pu devenir uniquement français. Dans ce cas, c’est un étranger qui aurait été mis en prison en Algérie. Les principes de droit de la nationalité des deux pays étant en grande partie opposés, des tensions sont inévitables. Cela est aussi périodiquement le cas pour les enfants emmenés en Algérie à la suite du divorce de parents dont l’un est algérien, l’autre français. L’affaire Sansal est évidemment une autre illustration de relations géopolitiques qui ne peuvent que rester tendues tant qu’un véritable traité de paix et d’amitié ne sera pas signé. Mais il faudrait pour cela un gouvernement algérien qui abandonne la rente mémorielle.