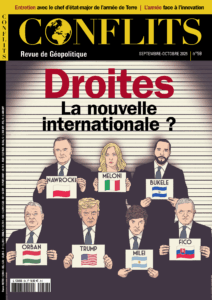Le Conseil constitutionnel vient de juger que l’exclusion du droit de vote des Français arrivés après 1998 aux élections pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie était valide au regard de la Constitution. Cette décision montre à quel point on s’est habitué à ce que la Nouvelle-Calédonie fasse exception au principe démocratique : aujourd’hui, personne ne se bat plus pour le suffrage universel, uniquement pour savoir si on exclura un peu plus ou un peu moins.
Le 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a rendu une décision attendue concernant une question prioritaire de constitutionalité relative à la définition du corps électoral admis, en Nouvelle-Calédonie, à participer aux élections provinciales (et par conséquent du Congrès, qui a pouvoir législatif). Les sages de la rue de Montpensier ont considéré que l’article 188 de la Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, qui limite ce corps – pour simplifier – aux personnes qui étaient déjà présentes sur l’archipel en 1998 (il y a 27 ans !), ainsi qu’à leurs descendants majeurs résidant toujours sur le territoire, était constitutionnel dans la mesure où c’est l’article 77 de la Constitution lui-même qui prévoit cette dérogation au principe, pourtant fondamental, d’universalité du suffrage.
Une décision prévisible
La décision n’aura étonné que les naïfs. Dans la mesure où il n’existe pas, du point de vue de l’ordre juridique interne français, de norme plus haute que la Constitution, et que c’est celle-ci qui définit qui a voix au chapitre, la réponse apportée était la plus évidente. Certes, il aurait été possible pour le Conseil de faire droit à des arguments plus complexes et novateurs sur le plan juridique. Par exemple, il aurait pu considérer que l’article 77, inséré dans un Titre de la Constitution intitulé « dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie », qui lui-même avait été introduit pour mettre en œuvre un accord de Nouméa (signé en 1998) ayant épuisé tous ses effets depuis la troisième victoire du non au référendum du 12 décembre 2021, l’article 77, donc, était devenu caduc et qu’on revenait par conséquent au droit commun, c’est-à-dire l’universalité du droit de vote.
Ou bien il aurait pu considérer qu’il existait une hiérarchie des normes interne à la Constitution, et qu’une disposition technique et dérogatoire au droit commun pouvait être invalidée au nom d’un principe constitutionnel général qui lui serait supérieur (comme l’égalité devant la loi), même si elle est contenue dans la Constitution. Mais cela aurait, de fait, constitué des innovations significatives en termes de théorie constitutionnelle. La réponse donnée – circulez, il n’y a rien à voir – était donc prévisible.
Beaucoup plus étonnant est le fait que le Conseil constitutionnel n’ait pas eu un mot pour noter, fût-ce en passant, le caractère absolument stupéfiant, au regard des principes premiers, du fait qu’en Nouvelle-Calédonie des citoyens français soient, par dizaines de milliers, exclus du vote dans leur propre pays : non pas, comme ce serait d’ordinaire le cas, par décision de justice motivée parce qu’ils ont commis un crime ou un délit, mais parce qu’ils ne sont pas considérés comme suffisamment « purs » au regard d’une législation discriminatoire votée dans le but d’acheter la paix civile auprès d’une communauté kanake largement ethno-suprémaciste.
Le problème de la décision du Conseil constitutionnel n’est pas tant, à nos yeux, qu’il ait considéré que le corps électoral restreint – « gelé » – qui prévaut en Nouvelle-Calédonie était légal ; c’est qu’il donne le sentiment de le trouver parfaitement normal, ne nécessitant pas même de justification autre que purement technique. Circulez, il n’y a rien à voir.
Où l’exception devient la règle…
C’est là qu’on mesure à quel point cette question (et, derrière elle, plus largement, celle du caractère exorbitant du droit commun de la Nouvelle-Calédonie) fait l’objet de ce qu’on appelle un effet de cliquet : autrement dit, le fait qu’une fois qu’on a fait des concessions aux principes, on ne peut plus revenir en arrière. Soit on fera de nouvelles concessions soit, au mieux, et sans doute avec la plus grande difficulté, on en restera au statu quo.
Retraçons la généalogie de ces cliquets successifs car ils sont extrêmement instructifs.
Tout commence avec les accords de Matignon-Oudinot en 1988 : pour tâcher de retrouver la paix civile après les « événements » de 1984-1988, on se mit d’accord sur une organisation politique permettant aux Kanaks de partager le pouvoir avec les Européens, et un plan de rattrapage socio-économique à leur profit. Au bout de 10 ans, en 1998, on voterait sur la question de l’indépendance. Qui ça, « on » ? – réponse : les personnes ayant passé ces dix ans sur l’île, à l’exclusion donc de ceux (typiquement des Européens venus de métropole) étant arrivés en cours de route.
On peut comprendre la logique : c’est à ceux qui étaient là quand on s’est donné 10 ans, en 1988, pour essayer de redresser la barre avant de poser la question fatale – la Nouvelle-Calédonie veut-elle ou non rester française ? – de répondre à la question posée. Les autres ne sont pas concernés.
Pourquoi pas. Mais la suite de l’histoire est connue. En 1998, pour ne pas compromettre le retour à la paix, on s’est mis d’accord pour décaler le référendum sur l’indépendance d’une génération et mettre en œuvre, à sa place, un plan de dévolution des pouvoirs sans précédent dans l’histoire constitutionnelle française. Ce sera l’accord de Nouméa. Qui pourrait voter une génération plus tard ? Eh bien, ceux qui auraient pu voter en 1998, c’est-à-dire ceux qui étaient déjà là… en 1988 (plus leurs enfants devenus majeurs et restés sur l’île, qui remplacent pour ainsi dire ceux qui seraient morts entre temps). Une concession fut généreusement accordée à ceux arrivés avant 1994 : 27 ans (!), donc, avant le troisième référendum.
Dans le même temps, le droit de vote aux élections provinciales et du Congrès de Nouvelle-Calédonie était restreint à ceux – les nouveaux « citoyens calédoniens » – qui pouvaient se prévaloir de dix ans de résidence sur l’archipel. De manière désormais structurelle, les Français arrivés d’ailleurs (généralement de métropole) devaient donc attendre dix ans avant de pouvoir voter à des élections les concernant au plus haut point. Quand on sait qu’il suffit généralement de cinq ans de résidence à un étranger pour pouvoir être naturalisé français, on mesure l’étendue de l’entorse au principe : il est plus difficile pour un Français originaire de Lyon de voter à Nouméa que pour un Algérien qui débarque en France. L’exception instaurée à Matignon en 1988 était devenue la règle nouvelle, qui n’avait plus de rapport perceptible avec sa raison d’être originelle.
… et où la règle devient permanente
Encore cette situation était-elle considérée comme « transitoire », jusqu’à la fin de la mise en œuvre de l’accord de Nouméa (dont tout le monde imaginait alors qu’il s’achèverait par l’indépendance, les citoyens calédoniens devenant les nationaux du nouvel État de « Kanaky-Nouvelle-Calédonie ») ; et tout le monde pouvait-il espérer, en s’armant de beaucoup de patience, accéder d’ici-là à la « citoyenneté » calédonienne et donc au droit de vote. Mais même cela a fini par disparaître : une limitation mène à une autre, puis encore une autre, etc. L’effet-cliquet.
En 2007, semble-t-il pour se venger du leader loyaliste Jacques Lafleur qui avait soutenu son rival Édouard Balladur à la présidentielle de 1995, Jacques Chirac fit voter une modification de la Constitution changeant le sens d’une référence, dans la loi organique, au « tableau annexe » des électeurs français non-citoyens calédoniens. En considérant, contre la lettre et l’esprit de l’accord de Nouméa, et contre toute logique, qu’il s’agissait à perpétuité du tableau de 1998, le constituant français gelait le corps électoral. Désormais, il n’était plus possible de rejoindre la communauté politique calédonienne du tout.
Et puis toute référence au caractère provisoire et exorbitant du droit commun de cette limitation de suffrage s’est évanouie. Quand il s’est agi, après l’achèvement du processus de Nouméa fin 2021, de rouvrir la question, plus personne ou presque n’a défendu ce qui était pourtant la position à la fois logique et seule conforme aux grands principes : l’état d’exception étant terminé, on en revient au droit commun, donc au suffrage universel. Le fait d’avoir soutenu cette position publiquement nous a valu d’être taxé d’extrémisme et de radicalité. Les élus loyalistes considérés comme les plus « radicaux », eux aussi, ont défendu une durée de résidence de trois ans. Trois ans est ensuite devenu sept, puis dix (les indépendantistes ayant intimé que rien de moins n’était concevable à leurs yeux : là encore, on s’est habitué à ce qu’ils coécrivent toute loi relative à la Nouvelle-Calédonie).
Mais même dix ans – c’est-à-dire le retour à l’accord de Nouméa qu’avait signé le FLNKS ! – était pour certains devenu inacceptable : on sait que c’est pour avoir essayé de faire passer cette minuscule avancée démocratique, qui était pourtant déjà, en elle-même, la ratification d’une exclusion, désormais permanente, des résidents pas assez « purs », que le gouvernement français a mis le feu à la Nouvelle-Calédonie. Prime aux casseurs : dans le projet d’accord de Bougival tel que paraphé le 12 juillet de cette année, le curseur avait été encore déplacé. Il s’agissait désormais de 15 ans, qui pourraient devenir 10 assortis d’une sorte de très humiliant test de citoyenneté-intégration à l’égard des métropolitains. Les leaders loyalistes ont crié victoire comme s’ils avaient obtenu une immense avancée démocratique en obtenant – en échange, excusez du peu, de la reconnaissance de la Nouvelle-Calédonie comme un « État » distinct de la République française – qu’une situation démocratiquement scandaleuse devienne… légèrement moins scandaleuse. C’est cela, l’effet-cliquet.
La victoire idéologique des indépendantistes
Qui, aujourd’hui, défend le principe démocratique en Nouvelle-Calédonie ? Chez les hommes politiques, tous les loyalistes prônent un corps glissant, c’est-à-dire une moins pire entorse à ce principe. Depuis mai 2024, il ne nous semble pas avoir entendu une seule position plus ambitieuse que dix ans glissants. Autrement dit, tout le monde ou presque, non seulement s’est habitué à l’anormal (pour ne pas dire l’inacceptable), mais n’y trouve même plus à redire. Le plus stupéfiant, sans doute, est que quand on vit sur l’archipel et qu’on perd un regard extérieur, critique, sur ces questions, on finit par ne même plus se rendre compte du problème : en ce sens, la victoire idéologique des indépendantistes est totale.