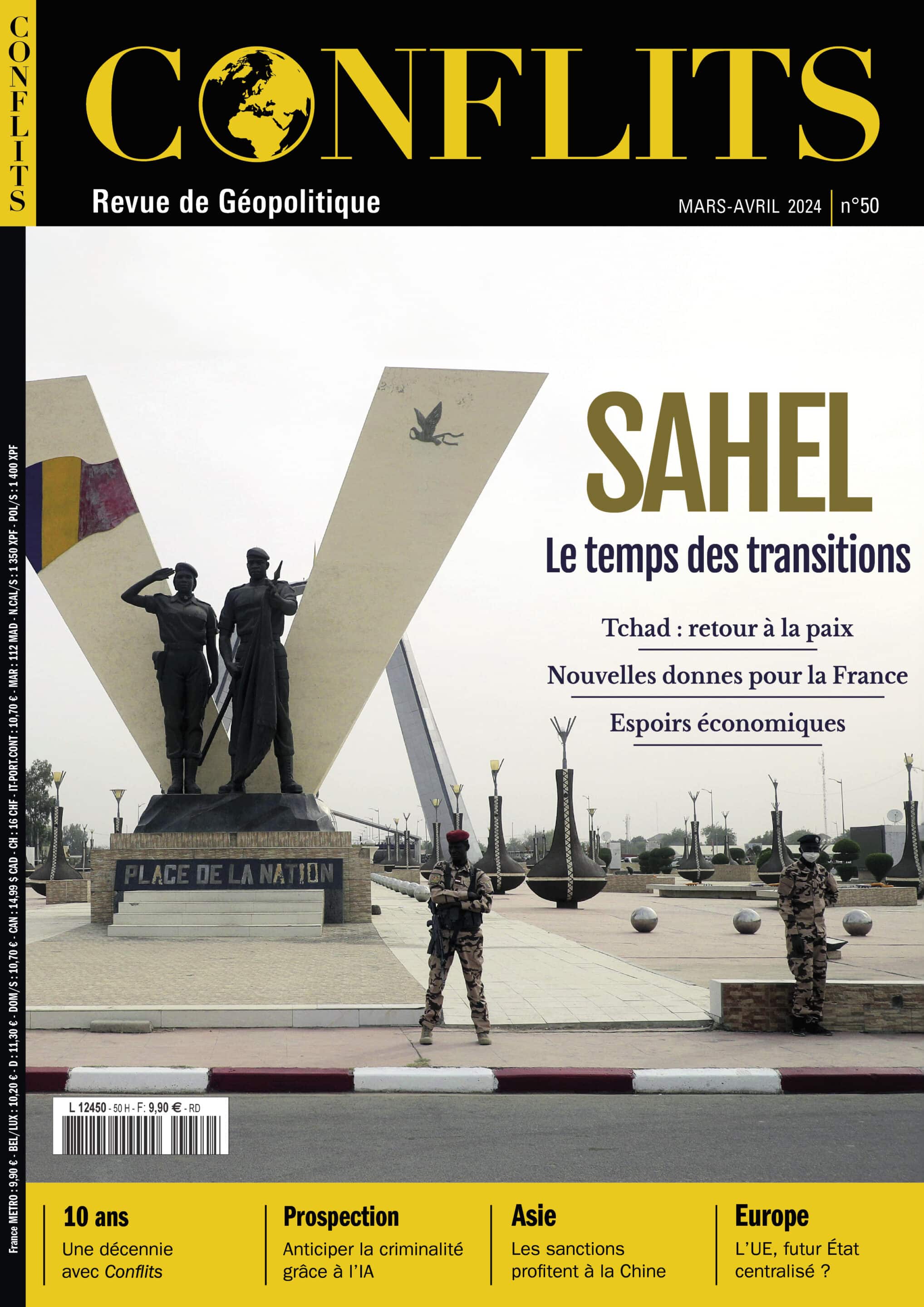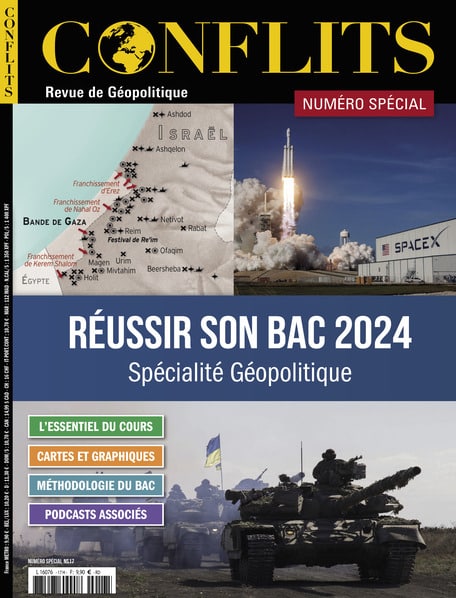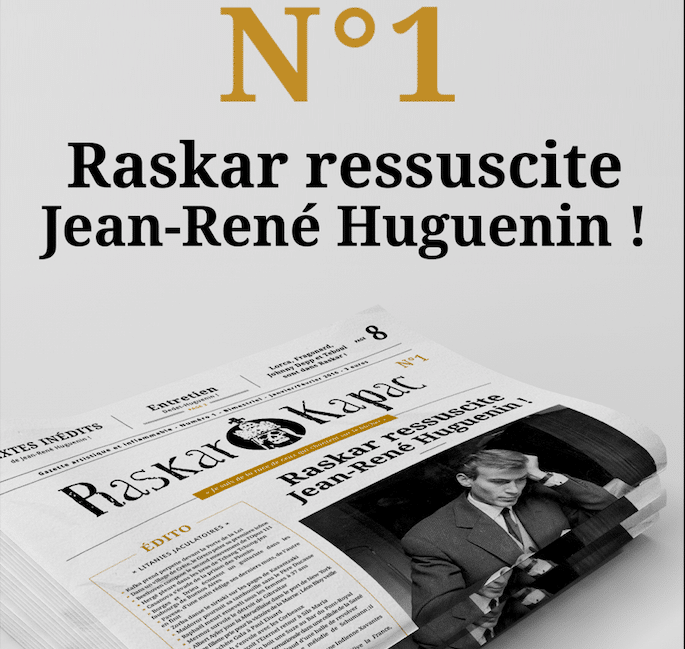Dans le monde, rien ne peut être fait, produit ou détruit sans énergie. On reconnaît là la définition désormais classique que donne Raymond Aron de la puissance, dans Paix et guerre entre les nations (Calmann-Lévy, Paris, 1962) : la « capacité de faire, de produire ou de détruire »… C’est ainsi que l’énergie est un déterminant essentiel de la géopolitique, étude des rivalités de puissances dans le monde.
On peut caractériser l’énergie comme une force qui permet de fournir un travail. L’étymologie grecque en témoigne, energeia signifiant « en action », « en mouvement » ou « au travail ». Le terme « énergie » dans son sens moderne a été introduit par le physicien anglais Thomas Young au xixe siècle, caractérisant « tout ce qui est du travail, provient du travail, produit du travail ». En effet, toute production représente un travail, donc une dépense d’énergie. Cette dépense d’énergie est allée croissant dans l’histoire de l’humanité : la hausse de la consommation d’énergie a accompagné les progrès humains, avec un saut quantitatif et qualitatif remarquable au moment de la Révolution industrielle à partir de la fin du xviiie siècle.
L’énergie, une force en action
Avant la Révolution industrielle, l’énergie est rare et d’utilisation limitée : il s’agit de l’énergie des hommes et des animaux, de la force de l’eau et du vent (utilisée dans les moulins), de l’énergie thermique à partir du bois de combustion (ou charbon de bois). Puis intervient la Révolution industrielle, à partir de la fin du xviiie et du début du xixe en Europe. Il s’agit avant tout d’une révolution énergétique : machine à vapeur fonctionnant au charbon (James Watt, 1759), production d’électricité (dynamo de Gramme, 1869), usage du pétrole dans les moteurs (invention du moteur à explosion par Daimler en 1885). Depuis les années 1960, la consommation d’énergie dans le monde a encore franchi un palier, elle a plus que triplé en un demi-siècle.
Certains s’interrogent aujourd’hui sur l’avènement d’une nouvelle révolution énergétique, mais il est remarquable qu’aucune nouvelle énergie ne se soit imposée jusqu’alors à la place du pétrole. En revanche, de nouveaux équilibres existent, justifiant l’idée d’une transition énergétique.
Des énergies plurielles
Il faut différencier sources et formes d’énergie en se gardant bien des confusions. La géographe Yvette Veyret écrit que « le concept d’énergie est inséparable de la loi qui lui est associée : la loi de conservation de l’énergie. Celle-ci ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée ou transférée ». Ainsi deux grandes catégories d’énergies existent, en fonction de leurs sources.
La première catégorie correspond aux énergies dites « de stock », issues de gisements de combustibles fossiles (dites « énergies fossiles »), charbon, gaz naturel, pétrole, mais également uranium. Elles ont dominé le xxe siècle et demeurent indispensables (voir première partie, « le siècle des hydrocarbures »).
La seconde, ce sont les énergies « de flux », dites renouvelables, générées par des processus naturels et donc inépuisables (vent, soleil, biomasse). Certaines sont dites « énergies vertes », car porteuses d’une empreinte écologique faible. 10 % du bilan énergétique mondial, mais avec une grosse part pour l’hydroélectricité, la moins « écologique » de toutes (voir deuxième partie sur la transition énergétique).
À lire aussi : Géopolitique de l’énergie
Pour être consommées, ces énergies subissent des transformations ou conversions, si bien qu’on distingue quatre stades selon l’état de la ressource :
1er stade, celui de l’énergie primaire qui correspond à l’énergie « telle que la nature nous la livre » (Bernadette Mérenne-Schoumaker), par exemple, l’énergie éolienne ;
2e stade, celui de l’énergie secondaire, celle qui a connu une première transformation ou « conversion » (essence issue du pétrole après raffinage, ou électricité). En revanche, hydroélectricité et électricité nucléaire sont considérées comme primaires. À ce stade donc, l’énergie se présente sous des aspects différents, avec des formes variées : énergie chimique, thermique, rayonnante, électrique, nucléaire, mécanique ;
3e stade, l’énergie finale, qui correspond à l’énergie livrée au consommateur via des circuits et réseaux de distribution ;
4e et dernier stade, l’énergie utile, qui résulte de la satisfaction d’un besoin énergétique, comme se chauffer ou se déplacer. On la différencie de la précédente, car il existe des pertes en réseaux. Ainsi, la consommation d’énergie finale représente en moyenne environ 70 % de la consommation d’énergie primaire et la consommation utile 40 % seulement de cette même consommation d’énergie primaire.
Transition énergétique et rapports de forces
Dans le Bilan énergétique mondial (BEM) actuel, les énergies de stock, non renouvelables, représentent encore plus de 85 % de la consommation mondiale. De quoi nuancer l’idée de transition écologique et énergétique. Malgré les efforts en termes d’efficacité énergétique et d’économies d’énergies, la consommation énergétique mondiale va continuer à fortement augmenter au cours du xxie siècle sous le triple effet de la croissance démographique mondiale, du développement économique et de l’industrialisation rapides des pays émergents, enfin de l’urbanisation galopante. Ce qui continue de poser une question centrale, celle de la finitude des ressources fossiles et de l’essor des ressources renouvelables, qui ne sont tout au plus aujourd’hui que des ressources d’appoint, en aucun cas de substitution.
À lire aussi : Les grands marchés de l’énergie aujourd’hui et demain
En revanche, le progrès technique dans le domaine énergétique est le « grand espoir » du xxie siècle pour reprendre l’expression consacrée d’Alfred Sauvy : pétroles et gaz non conventionnels, développement de la pile à combustible, usage de l’hydrogène, maîtrise de la fusion nucléaire.
Dans ce contexte, alors que les énergies ont été au cours du xxe siècle des sources de rivalités et de conflits et que les États font un retour en force depuis les années 2000 sur le marché des énergies, justifiant l’expression de « Grand Jeu », elles seront peut-être amenées à remplir, paradoxalement, le rôle de catalyseur de la coopération internationale.