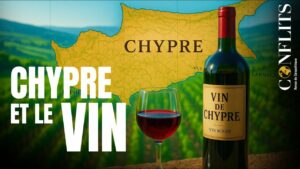Après le Siècle d’or, l’Espagne, dans la mémoire collective, a sombré dans les ténèbres, l’immobilisme et la décadence. Cette image participe de la légende noire espagnole, qui enferme ce pays dans l’obscurantisme et le sous-développement. Pourtant, cette opinion de rue est loin de la réalité. L’Espagne a connu une vie intellectuelle riche et dense tout au long du XVIIIe siècle. C’est ce que Nicolas Klein analyse et présente pour les lecteurs de Conflits, dans une série en trois épisodes.
Deuxième partie – Racines et branches de la pensée des Lumières espagnoles
L’ancienneté de la pensée réformiste espagnole
La pensée espagnole, qu’elle soit de nature théologique, philosophique ou politique, est ancienne puisqu’elle remonte au Moyen Âge, où elle fleurit (entre autres) dans les universités fondées à cette période : Palencia, Salamanque, Lérida, Valladolid, Huesca, Calatayud, Gérone et Barcelone [simple_tooltip content=’Carrasco, Raphaël ; Dérozier, Claudette ; et Molinié-Bertrand, Annie, Histoire et civilisation de l’Espagne classique (1492-1808), Paris : Nathan, 1991, page 164 ; et Klein, Nicolas, « Inégalités, course aux diplômes et manque de visibilité internationale : les défis de l’université espagnole », Conflits, 28 janvier 2020.’](1)[/simple_tooltip]. La consolidation du système universitaire espagnol se poursuit à la Renaissance et à l’âge baroque avec près d’une trentaine d’établissements d’enseignement supérieur fondés entre 1483 et 1624 – sans compter les universités du Nouveau Monde [simple_tooltip content=’Carrasco, Raphaël ; Dérozier, Claudette ; et Molinié-Bertrand, Annie, op. cit., pages 164-165.’](2)[/simple_tooltip].
C’est de ces établissements (et notamment des Colegios Mayores que nous citions précédemment) [simple_tooltip content=’Ibid., pages 167-169.’](3)[/simple_tooltip] que sont issus les letrados, juristes et grands administrateurs d’abord issus des classes défavorisées, qui sont destinés ensuite à divers organes de gouvernement nationaux, régionaux et locaux (Conseils royaux, Audiences provinciales, Chancelleries, postes de corrégidors, etc.) [simple_tooltip content=’Ibid., pages 169-171.’](4)[/simple_tooltip] Si l’enseignement classique (logique, rhétorique, théologie, droit civil, droit canon, médecine) reste à l’ordre du jour [simple_tooltip content=’Defourneaux, Marcelin, L’Espagne au Siècle d’Or, Paris : Hachette, 1996 (troisième édition), page 191.’](5)[/simple_tooltip], le renouvellement apporté par ces prestigieux letrados explique la supériorité de l’administration des Habsbourgs d’Espagne sur celle des autres pays européens, notamment au début du règne de Philippe II (1556-1598) [simple_tooltip content=’Parker, Geoffrey, Felipe ii – La biografía definitiva, Barcelone : Planeta, 2011 (quatrième édition), traduction de Gordo del Rey, Victoria Eugenia, pages 480-484, 529-531, 609-613 et 762-772.’](6)[/simple_tooltip], souverain considéré comme l’« inventeur » des gouvernements polysynodaux [simple_tooltip content=’Carrasco, Raphaël ; Dérozier, Claudette ; et Molinié-Bertrand, Annie, op. cit., pages 23-25.’](7)[/simple_tooltip].
La révolution administrative et idéologique qui accouche précocement de la monarchie absolue espagnole [simple_tooltip content=’Hildesheimer, Françoise, Du Siècle d’Or au Grand Siècle – L’État en France et en Espagne, xvie-xviie siècle, Paris : Flammarion, 2000.’](8)[/simple_tooltip] est en partie à l’origine de l’absolutisme français, comme l’a bien montré la recherche historiographique récente [simple_tooltip content=’Schaub, Jean-Frédéric, La France espagnole – Les racines hispaniques de l’absolutisme français, Paris : Seuil, 2003.’](9)[/simple_tooltip].
A lire aussi: Podcast – La philosophie de Descartes
Salamanque, les arbitristes et les novatores
C’est aussi à l’ombre de l’Université de Salamanque [simple_tooltip content=’Defourneaux, Marcelin, op. cit., page 188.’](10)[/simple_tooltip] que naît la seconde scolastique espagnole, couramment désignée sous le nom d’École de Salamanque. Ce groupement de penseurs, professeurs, juristes et théologiens (parmi lesquels Martín de Azpilicueta, Tomás de Mercado, Francisco de Vitoria, Martín Fernández de Navarrete, Miguel Caja de Leruela, Diego de Covarrubias, Juan de Mariana, Luis de Molina, Bartolomé de las Casas, Martín González de Cellorigo, Francisco Suárez ou encore Domingo de Soto [simple_tooltip content=’Quesada Marco, Sebastián, Diccionario de civilización y cultura españolas, Madrid : Istmo, 1997, pages 167-168 et pages 174-176.’](11)[/simple_tooltip]) renouvelle profondément la science politique et juridique. Il transforme et crée en effet de nombreux concepts, voire des branches inexistantes jusqu’alors : droit de propriété, usure et intérêts, juste prix, finances publiques et taxes, droit international, etc. [simple_tooltip content=’Azevedo Alves, André et Moreira, José Manuel, The Salamanca School, New York : Continuum, 2010.’](12)[/simple_tooltip]
À partir de la fin du XVIe siècle, la pensée espagnole mute à nouveau avec l’apparition de l’arbitrisme (arbitrismo), terme d’abord péjoratif créé en 1613 par Miguel de Cervantes dans la nouvelle Le Colloque des chiens. Le nom masculin arbitrio désigne alors le « moyen extraordinaire » qu’un souverain peut employer pour atteindre une fin donnée ou résoudre une situation complexe [simple_tooltip content=’Diccionario de la Real Academia, entrée « arbitrio ».’](13)[/simple_tooltip]. Les arbitristes (arbitristas), à l’image de Cellorigo, Fernández de Navarrete, Sancho de Moncada, Luis Ortiz ou Luis Valle de la Cerda, tentent d’influencer le souverain en lui proposant un mémorial sur un sujet donné, généralement de nature économique (spéculation, traitement fiscal injuste, concentration excessive de la propriété agricole, endettement de l’État, exportation de capitaux et de matières premières, dépeuplement) [simple_tooltip content=’Quesada Marco, Sebastián, op. cit., pages 40-41 ; et Dubet, Anne et Sabatini, Gaetano, « Arbitristas – Acción política y propuesta económica » in Martínez Millán, José et Visceglia, María Antonieta (éds.), La monarquía de Felipe iii, Madrid : Fondation Mapfre, 2009, volume iii (La Corte), pages 867-870.’](14)[/simple_tooltip].
Il y a donc chez les arbitristas (dont beaucoup sont issus de l’École de Salamanque) la conscience d’une série de problèmes concrets que le gouvernement de l’Espagne doit s’atteler à résoudre au nom du bien commun – thématique largement reprise à l’époque des Lumières [simple_tooltip content=’Abellán, José Luis, Historia crítica del pensamiento español, Madrid : Espasa-Calpe, 1981, tome iii (« Del Barroco a la Ilustración (siglos xvii y xviii) »), pages 312-330.’](15)[/simple_tooltip].
Entre la fin du règne de Charles II (1665-1700) et le début de celui de Philippe V (1700-1746), alors que l’Espagne connaît un changement de dynastie dans le cadre d’une guerre de succession (1701-1714), les arbitristes laissent leur place à un nouveau courant de pensée, celui des novatores. En 1700, ils fondent la Société royale de Médecine et de Sciences de Séville, chargée de diffuser leurs idées, qui reposent sur l’atomisme. Ces chercheurs (représentés par Diego Martínez Zapata, Luis de Losada, Alejandro Avendaño, Martín Martínez, Tomás Vicente Tosca, Juan Bautista Berni ou Juan de Cabriada) prônent avant tout la réforme de l’enseignement supérieur espagnol, qui doit privilégier à leurs yeux les sciences physiques et naturelles plutôt que la scolastique abstraite. Ils font la jonction entre le renouveau arbitrista et la rationalité des Lumières en gestation [simple_tooltip content=’Quesada Marco, Sebastián, op. cit., page 333.’](16)[/simple_tooltip].
Cette transition n’est pas spécifique à l’Espagne [simple_tooltip content=’Hazard, Paul, La Crise de la conscience européenne, Paris : Boivin et Compagnie, 1935 ; et Abellán, José Luis, op. cit., pages 281-296.’](17)[/simple_tooltip]. Outre-Pyrénées, c’est Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), précurseur de l’Ilustración, qui fait connaître les théories de Galilée, Isaac Newton, René Descartes, Wilhelm Leibniz, John Locke ou encore Pierre Bayle pour renouveler la philosophie et les sciences. Feijoo défend une plus grande ouverture de l’Espagne au reste de l’Europe. L’ecclésiastique n’est pas le seul à soutenir de telles thèses puisqu’il est précédé par Francisco Gutiérrez de los Ríos, auteur d’un traité intitulé El hombre práctico o discursos sobre su conocimiento y enseñanza (1680) [simple_tooltip content=’Mestre Sanchis, Antonio et Pérez García, Pablo, « La cultura en el siglo xviii español » in Alvar Ezquerra, Alfredo (dir.), La cultura española en la Edad Moderna, Madrid : Istmo, 2004, pages 397-407 ; et Fernández Sanz, Amable, « La Ilustración española – Entre el reformismo y la utopía » in Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Madrid : Presses de l’Université Complutense, 1993, n° 10, pages 57-71.’](18)[/simple_tooltip].
A lire aussi: La tragédie de l’Espagne vide et ses multiples facettes
Des querelles durables et un héritage ambigu
Si l’on peut porter au crédit des Lumières espagnoles, qui se nourrissent des courants précités, un certain nombre de réformes réussies (revalorisation du travail, du commerce, de l’industrie et de l’agriculture ; réorganisation de l’administration ; métamorphose de l’éducation et de l’université) [simple_tooltip content=’Carrasco, Raphaël ; Dérozier, Claudette ; et Molinié-Bertrand, Annie, op. cit., pages 323-324.’](19)[/simple_tooltip], il faut aussi signaler qu’ils contribuent à approfondir de vieilles fractures entre partisans d’une voie ibérique (surtout tournée vers l’Amérique) et une voie européenne [simple_tooltip content=’Klein, Nicolas, « Entre grand large et continent, la géopolitique espagnole écartelée », Conflits, 5 février 2020.’](20)[/simple_tooltip].
Cet affrontement entre casticistas (partisans de la casta, c’est-à-dire de la tradition nationale) et extranjerizantes (que l’on nomme par la suite europeístas) s’illustre par l’opposition d’une grande partie de l’Église espagnole aux nouveaux modes de réflexion introduits en péninsule Ibérique [simple_tooltip content=’Fernández Sanz, Amable, op. cit.‘](21)[/simple_tooltip]. Les résistances à la publication d’ouvrages jugés contraires à la religion sont le fait du tribunal du Saint-Office, mais ce dernier censure presqu’autant que la monarchie elle-même – comportement qui n’a rien d’anormal dans l’Europe de l’époque [simple_tooltip content=’Loupès, Philippe, L’Espagne de 1780 à 1802, Paris : Cdu Sedes, 1985, pages 211-219.’](22)[/simple_tooltip].
Au XVIIIe siècle, le casticismo musical s’insurge contre la prédominance de formes venues du reste du continent (en particulier de France et d’Italie) et cette attitude favorise le succès populaire des genres espagnols, comme la zarzuela ou la tonadilla [simple_tooltip content=’Quesada Marco, Sebastián, op. cit., page 88.’](23)[/simple_tooltip]. Les Italiens Domenico Scarlatti et Luigi Boccherini, qui finissent tous deux leurs jours à Madrid, exercent une quasi-tyrannie à la cour de Ferdinand vi (1746-1759) et de Charles III (1759-1788) [simple_tooltip content=’Loupès, Philippe, op. cit., pages 209-210.’](24)[/simple_tooltip], tout comme le castrat Farinelli avait rencontré un immense succès auprès de leur père [simple_tooltip content=’Varga, Suzanne, Philippe V, roi d’Espagne, petit-fils de Louis xiv, Paris : Pygmalion, 2011, pages 492-510.’](25)[/simple_tooltip]. Les rares Espagnols à percer, comme l’organiste et claveciniste Antonio Soler (1729-1783), sont leurs élèves [simple_tooltip content=’Quesada Marco, Sebastián, op. cit.‘](26)[/simple_tooltip]. La littérature elle aussi témoigne de cette prépondérance européenne, notamment française et anglaise. On le constate chez Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), surnommé « le Molière espagnol », ou chez José Cadalso (1741-1782), dont les Lettres marocaines sont inspirées de Montesquieu et les Nuits lugubres, d’Edward Young [simple_tooltip content=’Loupès, Philippe, op. cit., page 210.’](27)[/simple_tooltip].
C’est de cette époque que date le qualificatif peu flatteur d’afrancesado (« francisé »), repris au moment de la Révolution française et de l’invasion napoléonienne (1808-1814). La revendication des arts et belles lettres de l’Espagne sert d’arme de guerre idéologique face aux influences étrangères, jugées impies et nocives par certains secteurs. La montée en puissance du mouvement casticista est favorisée par le destin de Louis xvi (« cousin » de Charles IV (1788-1808), lequel tente de sauver le souverain français de la guillotine [simple_tooltip content=’Fourny, Marc, « Louis xvi : comment l’Espagne tenta de sauver la tête du roi », Le Point, 26 septembre 2018.’](28)[/simple_tooltip]) et par la censure que subissent de nombreux ouvrages étrangers [simple_tooltip content=’Nourry, Philippe, Histoire de l’Espagne – Des origines à nos jours, Paris : Tallandier, 2013, pages 382-384 ; et Loupès, Philippe, op. cit., pages 225-256.’](29)[/simple_tooltip].
Durant l’occupation de la péninsule Ibérique par le Premier Empire, les opposants à Napoléon Bonaparte ne sont pas tous des adversaires des nouveaux courants idéologiques – ce qui explique la promulgation de la Constitution de 1812 (l’une des premières en Europe) [simple_tooltip content=’Pellistrandi, Benoît, Histoire de l’Espagne – Des guerres napoléoniennes à nos jours, Paris : Perrin, 2013, pages 64-78.’](30)[/simple_tooltip]. La lutte entre Ancien Régime et libéralisme se poursuit durant les deux siècles suivants, avec des reformulations en fonction de l’époque : réaction carliste de 1833 à 1876, difficultés à accoucher d’un régime parlementaire de 1875 à 1931 puis sanglante guerre civile de 1936 à 1939, suivie d’une dictature qui perdure jusqu’en 1975 [simple_tooltip content=’Ibid., pages 84-221 et 341-423.’](31)[/simple_tooltip].
C’est par le biais de la thématique des « deux Espagnes » (dos Españas) que ce conflit séculaire est souvent abordé [simple_tooltip content=’Quesada Marco, Sebastián, op. cit., page 154.’](32)[/simple_tooltip]. Même s’il ne nous appartient pas de discuter la pertinence de ce concept, il faut toutefois se montrer prudent lorsqu’il s’agit de l’appliquer aux Lumières espagnoles.
La plupart d’entre eux sont en effet modérés, profondément chrétiens et patriotes [simple_tooltip content=’Loupès, Philippe, op. cit., pages 175-177.’](33)[/simple_tooltip] même si favorables à une évolution de la doctrine religieuse [simple_tooltip content=’Carrasco, Raphaël ; Dérozier, Claudette ; et Molinié-Bertrand, Annie, op. cit., pages 323-324.’](34)[/simple_tooltip]. C’est probablement le peintre Francisco de Goya (1746-1828), à cheval sur deux périodes, qui illustre le mieux ces tensions inhérentes à l’époque. Favori de la cour, coqueluche de l’aristocratie, il ne cache pourtant pas sa proximité avec les idées les plus avancées de son temps. Néanmoins, désenchanté face à la cruauté de la guerre déclenchée par Napoléon, il évolue difficilement dans l’Espagne absolutiste de Ferdinand vii (1808-1833) et choisit l’exil en France en 1824 [simple_tooltip content=’Ibid., pages 327-343.’](35)[/simple_tooltip].
La gravure Le Sommeil de la raison engendre des monstres, qui fait partie des Caprices, porte un titre ambigu en espagnol, le terme sueño désignant à la fois le somme et le songe. Est-ce lorsqu’il abandonne la raison chère aux Lumières que l’homme dérive et se perd dans l’horreur de l’irrationalité ? Ou la raison poussée à son paroxysme et imposée par la force finit-elle par produire des horreurs semblables à celles que Goya représente sur les dernières années de sa vie ? Aucun des représentants de l’Ilustración n’est à même de résoudre cette dichotomie.