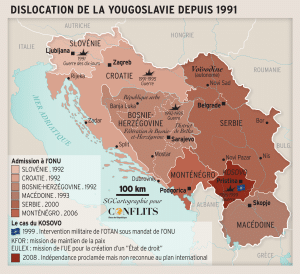La vente du carbone est en enjeu économique mondial. Le secteur climatique est très dépendant des États et de leur politique de subvention, ce qui modifie régulièrement le marché du carbone.
La géopolitique du carbone s’établit autour de trois puissances principales : l’UE (6 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) la Chine (30 %,11 milliards de tonnes deCO2 équivalent par an) et les États-Unis (11 %). Si la seconde est la première émettrice de gaz à effet de serre (GES). L’UE se veut toujours exemplaire en matière d’énergie verte, avec son Pacte vert, et son objectif ambitieux de décarbonation, bien qu’en 2024 ses émissions se sont inscrites en hausse de 4,6 %. Alors qu’en Chine, qui se positionne comme le leader des énergies renouvelables et championne du nucléaire, elles ont baissé de 2,7 %, soit un peu plus qu’en Inde, actuellement troisième émetteur mondial (- 2,2 %). Quant aux États-Unis, dont les émissions ont augmenté de 4,2 % ? Sortis à deux reprises de l’accord de Paris du 12 décembre, ils sont devenus climatosceptiques, non seulement dans les mots, mais dans les faits. Dès son retour à la Maison-Blanche, l’administration Trump a affiché sa volonté d’atteindre à la domination énergétique en supprimant tous les obstacles au développement des énergies fossiles, en enterrant quasiment l’éolien et le photovoltaïque, tout en montrant sa volonté de relancer le nucléaire, du fait de la demande en électricité des data centers qui consomment d’ores et déjà 4,4 % de l’électricité du pays et dont la demande apparaît exponentielle. De plus la Maison-Blanche s’est lancée à l’assaut des sciences du climat, coupant les crédits de recherche, réduisant les activités de surveillance océanographique mondiale dont ils détenaient la moitié du réseau mondial. Une étude du site spécialisé Carbon Brief estimait que la politique du président Trump pourrait entraîner une hausse de 4 milliards de tonnes des émissions américaines, chiffre certainement situé au haut de l’échelle.
À lire également : Le nucléaire demeure une source énergétique majeure
La transition énergétique ralentit sa marche
Cependant, quelle que soit la politique anticlimatique du président américain, la transition climatique, bien qu’appelée à réduire son rythme, est en marche, en grande partie grâce à la Chine, qui s’est engagée en ce domaine dans une compétition avec les États-Unis.
Pour preuve les dépenses qui sont dédiées aux renouvelables (plus de 2200 milliards de dollars par an) sont désormais le double des investissements consacrés au développement des hydrocarbures (1000 milliards de dollars contre 1350 milliards en 2015, lors de la signature de l’Accord de Paris). C’est bien sûr loin du compte, car, selon l’AIE, ce sont 3000 milliards de dollars qui devraient être consacrés aux énergies vertes au niveau mondial chaque année pour préserver l’objectif de réduire la hausse moyenne des températures au-dessous de 1,5 °C. Aussi, la plupart des experts considèrent que cet objectif est dorénavant hors d’atteinte, en s’appuyant notamment sur la hausse régulière de la consommation mondiale de pétrole, qui ne devrait atteindre son pic qu’en 2030 avec 106 millions de barils/jour contre 104, 5 millions en 2024. De manière plus précise, le Stockholm Energy Institute (SEI) en analysant les feuilles de route énergétiques des 20 pays qui représentent à eux seuls 80 % de la production mondiale des fossiles ( Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Allemagne, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Koweït, Mexique, Nigéria, Norvège, Qatar, Russie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, et États-Unis) a établi que ces États prévoient de produire d’ici la fin de la décennie 120 % de plus que le volume de combustibles fossiles nécessaire de limiter le réchauffement à 1,5°C.
Certes la guerre en Ukraine a accéléré la transition énergétique en Europe. En 2022, l’éolien et le solaire ont produit conjointement plus d’électricité (22 %) que le charbon (16 %), mais aussi davantage que le gaz. On peut se demander si un tel effort pourra être poursuivi. De même on a assisté à un grand bond en avant de l’énergie verte en Europe ; bien que celui-ci est encore lent et concentre dans quelques pays. En cinq ans, l’Afrique, qui se met au vert à son tour, a mis en service vingt fois moins de puissance électrique (14 GW) que ce que la Chine a pu réaliser en une année pour une population équivalente.
Mais en sens contraire, Donald Trump a relancé le charbon en diminuant les redevances dues par les sociétés minières de 12,5 % à 7 %¨de la valeur du combustible extrait et les réglementations environnementales ont été allégées, allant à l’encontre de la décision prise en mai 2014 par le G7, qui représente 38 % de l’ économie mondiale et 21 % des émissions de gaz à effet de serre, de fermer leurs centrales à charbon avant 2035, lorsque celles-ci ne sont pas adossées à des dispositifs de captage et de capture du CO2. Aussi, la production de charbon aura augmenté de 6 % et 200 centrales à charbon du pays (10 % des centrales électriques au charbon en activité dans le monde) ont redémarré. Mais le cas américain ne fait pas exception. La Chine possède la moitié des centrales au charbon en activité dans le monde, qui produit 60 % de son électricité. Et la moitié de la population mondiale vit dans des pays où le charbon représente 30 % de la production électrique. L’Asie du Sud représente 10 % de la production charbonnière mondiale, qui assure 46 % de son mix énergétique et dont elle couvre le tiers des exportations mondiales.
Du fait de l’orientation anticlimat de Donald Trump, la finance verte n’a plus le vent en poupe. Aux États-Unis, les fonds durables subissent des sorties d’actifs sous l’effet d’un net ressentiment anti – ESG (les principes environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance). Ces fonds durables, ou ISR (investissements socialement responsables) ne représentent plus qu’une fraction de la finance verte. Aujourd’hui plus que 10 % du marché mondial obligataire est considéré comme vert.

Le soleil couchant se profile derrière la centrale électrique au charbon de Boxberg à Neuliebel, le 15 août 2025. (C) SIPA
La Chine, hyperpuissance du renouvelable
Si les États-Unis de Donald Trump s’orientent à fond dans le développement des énergies fossiles, la Chine tient à se profiler comme une hyperpuissance de la transition écologique. Elle dispose de 80 % de la capacité de production des panneaux solaires dans le monde, de 60 % pour les éoliennes, construit la moitié de la soixantaine de réacteurs en chantier sur la planète et domine 70 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Elle concentre les 2/3 des capacités de solaire et d’éolien en cours de constriction dans le monde et a déployé en 2024 sur son territoire l’équivalent des deux tiers de l’ensemble du stock cumulé des capacités solaires et éoliennes de l’UE depuis plus de vingt ans.
Cette montée en puissance de la filière électrique résulte d’une volonté des provinces d’assurer leur rattrapage économique en bénéficiant de larges subventions. Le leader mondial des batteries électriques CATL (38 % du marché mondial) est installé dans la province du Fujian et le deuxième BYD (15 %) à Shenzhen (Guangdong)
Son savoir-faire dans les batteries automobiles lui permet de prendre l’avantage dans un autre secteur clé : les armoires de stockage d’énergie de source intermittente, nécessaires pour rendre le solaire et l’éolien viables à grande échelle. Malgré cela, la Chine a encore, émis 12 milliards de tonnes de CO2 en 2024, soit 30 % du total de la planète pour seulement 18 % de la population. La part du charbon dans son mix énergétique a certes baissé de 70 % en 2010 à 58 % en 2024, mais le pays en brûle toujours 40 % de plus que le reste du monde. La domination chinoise dans l’économie de la transition consolide sa position sur la scène internationale et lui donne bien des atouts dans les négociations climatiques. Pékin ne cesse d’insister sur le fait que c’est lui qui rendra la transition possible pour tous.
À lire également : Sans forestiers, les forêts sont en dangers
La COP 30 de Belen sera-t-elle fidèle à ses promesses ?
Dans ces conditions, on se demande si la décision prise lors de la COP 28 à Dubaï, consistant à tripler la capacité des renouvelables (dont le coût a baissé de 40 % en dix ans) sera confirmée à Belen. Atteindre un tel objectif nécessitait 12 000 milliards de dollars d’investissement dans le système électrique jusqu’en 2030. De son côté l’UE, sans abandonner explicitement son « Pacte vert » donne désormais la priorité à un pacte pour une industrie propre, ce qui est de nature à remettre en cause l’objectif d’une réduction de ses émissions de 55 % d’ici 2035. Aussi, il sera difficile pour l’UE de s’en tenir à sa directive énergies renouvelables, qui vise à atteindre une part de 42,6 % dans le mix énergétique en 2030 (contre 24,6 % en 2023).
Lors de son discours d’investiture de novembre 2023, le président Luiz Inacio Lula da Silva, qui accueille la COP 30 de Belen en novembre, a promis de faire du Brésil « un leader dans la lutte contre la crise climatique ». « Notre objectif est d’atteindre zéro déforestation en Amazonie (d’ici 2030) et zéro émission de gaz à effet de serre dans la matrice électrique ». De fait il a multiplié les mesures pour tenir ses engagements, en renforçant les contrôles contre le déboisement illégal, mis en place une politique de transition énergétique avec un potentiel d’investissement de 330 milliards d’euros et ratifié une loi créant un marché du carbone obligatoire. Cependant, malgré ces promesses, Petrobras, le géant pétrolier public, prévoit d’explorer un nouveau champ de pétrole, estimé à 10 milliards de barils, dans la couche dite « présalifaire » près de l’embouchure de l’Amazone, ce qui ferait potentiellement passer le Brésil du huitième au quatrième rang de producteur mondial. Face à l’impératif de lutter contre la pauvreté, il n’est pas réaliste que le Brésil, comme les autres pays en développement, surtout en Afrique, renonce à l’extraction fossile.
Les Brésiliens l’appellent le « mutirao » les soit une mobilisation collective en vue d’atteindre un objectif, il en faudra beaucoup pour que le vœu de la présidence brésilienne de la COP 30, celui de sauter d’» une ère de la négociation » à une « ère de la mise en œuvre » soit atteint. Les États devront, entre autres, progresser sur une feuille de route de Bakou à Belen afin de débloquer une enveloppe de 1300 milliards de dollars pour assurer la transition énergétique des pays du Sud. Près de la moitié de l’humanité vit « dans une zone de danger » a maintes fois annoncé Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’ONU. Selon le 6e rapport du GIEC, de 800 millions à 3 milliards de personnes pourraient souffrir d’un manque d’eau chronique en raison de la sécheresse, alors que de 3,3 à 3,6 milliards de personnes sont déjà « très vulnérable » face au réchauffement.
À lire également : Le nouveau « Grand Jeu » : réserves d’énergies et ressources naturelles en Asie