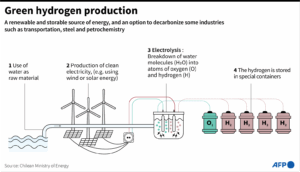À l’instar de nombreuses notions de philosophie politique comme l’État, la justice ou la liberté, la souveraineté présente bien des zones d’ombre et bien des équivocités lorsque l’on veut s’emparer du concept. Souvent référée à un coup d’envoi aristotélicien, elle se conjugue difficilement avec le concept moderne forgé par Jean Bodin (1530-1596) ou les présupposés que charrient les traités de Westphalie d’octobre 1648. En effet, se dégagent plusieurs problèmes de fond dès qu’en commence l’examen et que se trouve analysée l’étymologie du terme, à savoir superus en latin médiéval, où s’entend avant toute chose super – littéralement « au-dessus » – indiquant une supériorité, une éminence, bref l’établissement d’une hiérarchie[1] au sommet de laquelle s’établit une puissance supérieure que rien ne saurait transcender.
Article Paru dans la Revue Conflits n°51
Le fil directeur des ambiguïtés réside dans l’ambivalence de l’idée de supériorité : celle-ci n’a de sens qu’exercée sur une autre entité ainsi ramenée à un rapport de subordination faisant basculer la souveraineté dans le domaine du pouvoir. Mais le fait est que cela ne saurait épuiser la complexité du concept, car celui-ci dessine également la carte d’une prérogative par laquelle une entité donnée, en tant qu’elle serait souveraine, serait en mesure de se donner à elle-même ses propres lois, ses propres règles et, partant, de ne pas être dépendante d’une entité extérieure. Et l’on voit alors le lieu précis du problème : une indépendance n’est pas la même chose qu’un pouvoir suprême, une autonomie ne s’identifie pas à la supériorité d’un pouvoir ni à une supériorité envers ce dont elle est indépendante. C’est donc à même cette ambivalence qu’il nous faut nous installer pour envisager aussi bien les difficultés du concept que ses richesses.
L’indépendance n’est pas la souveraineté
Une première clarification conceptuelle peut nous être donné par Aristote dans son traité fondateur Les Politiques, dont il faut redire à quel point il constitue une tentative rare de penser le politique à partir de lui-même, et de ne rien introduire d’étranger à la cité pour rendre compte de son fonctionnement. Le propos initial d’Aristote est anthropologique : il pense l’homme comme un « animal politique », comme un zoon politikon, donc comme un animal dont la nature ne peut s’accomplir que dans la vie collective de la cité ; autrement dit, l’homme n’accomplit son humanité que par l’exercice politique de sa citoyenneté, la cité comme cadre politique étant de ce fait le moyen par lequel peut être accomplie la fin qui anime l’homme et la condition nécessaire – quoique insuffisante – de l’obtention du bonheur consécutive à une vie menée conformément à la nature humaine.
Mais une fois posée une telle anthropologie pour laquelle l’homme accompli est un citoyen (politês) et non un individu, encore faut-il comprendre ce qu’est une cité (polis) comme moyen de l’accomplissement humain. Les Politiques montrent que « la communauté achevée formée de plusieurs villages est une cité (polis) dès lors qu’elle a atteint le niveau de l’autarcie (autarkéias) pour ainsi dire complète ; s’étant donc constituée pour permettre de vivre, elle permet, une fois qu’elle existe, de mener une vie heureuse[2] ». Le terme central est celui d’autarcie où il faut entendre le substantif arkhè qui signifie « pouvoir » ou « principe », et auto qui signifie « par soi-même ». Ainsi se comprend ce que peut être l’autarcie par laquelle se définit une cité : il s’agit d’abord de la capacité de la communauté à se donner par elle-même et à elle-même les principes sous lesquels elle veut vivre ; une cité est d’abord une communauté capable d’autodéfinir les règles fondamentales sous lesquelles pourra s’ordonner la vie collective et ainsi s’accomplir la nature politique de l’homme.
C’est pourquoi Aristote peut ajouter que « le ce en vue de quoi, c’est-à-dire la fin (télos), c’est le meilleur, et l’autarcie (autarkéia) est à la fois une fin (télos) et quelque chose d’excellent (béltiston)[3] ». En somme, il y a une forme d’identité entre la fin que vise à accomplir l’homme et l’autarcie puisque, pour accomplir sa nature, il doit vivre politiquement, c’est-à-dire vivre selon des principes déterminés par la cité elle-même et par elle seule, si bien que l’autarcie n’est rien d’autre que la fin et l’excellence même de la nature humaine. Il en découle mécaniquement que la cité conforme à la nature humaine doit être indépendante des autres cités au sens où les principes qu’elle se donne ne doivent pas être tributaires de l’ingérence d’une autre cité ; une cité libre est donc une cité indépendante, capable de déterminer par elle-même la forme politique sous laquelle elle veut vivre.
Mais c’est justement là qu’intervient une nuance rarement aperçue[4]. Si Aristote dit volontiers que la cité est indépendante, car autarcique, il ne dit jamais qu’elle est souveraine. L’indépendance n’est pas l’affirmation d’une supériorité au regard des autres cités, mais est la revendication d’une non-soumission politique par laquelle seule peut s’accomplir l’humanité de l’homme. On pourrait rétorquer que les Grecs ne disposaient pas de la notion de souveraineté, et que telle est la raison pour laquelle Aristote n’identifie pas l’indépendance de la cité à la souveraineté. Or, rien ne serait plus faux, car le grec dispose du terme kurios qui est littéralement le « souverain » ou le « maître » en tant qu’il exerce une domination, et de l’adjectif kurion qui exprime le fait d’être souverain. Il convient donc de prendre acte de la rigueur conceptuelle d’Aristote qui comprend fort bien qu’une indépendance n’a rien à voir avec l’affirmation d’une supériorité, et que si souveraineté il y a, elle ne peut se jouer au niveau de la cité elle-même, mais uniquement à l’intérieur de cette dernière dans des relations internes de pouvoir.
Souveraineté : Un sujet au cœur du politique
Pouvoir souverain ou cité souveraine ?
Demandons alors à Aristote ce qui peut être souverain, ce qui peut être qualifié de kurios, et pour ce faire reportons-nous au livre III des Politiques : « Une constitution (politéia) est pour une cité une organisation des diverses magistratures (arkhon) et surtout de celle qui est souveraine (kurias) dans toutes les affaires. Partout, en effet, ce qui est souverain (kurion), c’est le gouvernement (politeuma) de la cité, mais la constitution (politeia) c’est le gouvernement (politeuma)[5]. » L’autarcie consiste d’abord pour la cité à se constituer en tant que cité, à ne pas être une simple collection de villages, mais bien une communauté constituée de manière politique. Or, se constituer, c’est-à-dire se doter d’une forme politique, c’est en même temps déterminer quel pouvoir (arkhè) primera sur tous les autres, déterminer quel pouvoir détiendra la suprématie et pourra être dit souverain (kurion). On comprend donc que ce n’est pas la cité comme telle qui est souveraine, mais bel et bien un pouvoir précis au sein de la cité, et qui, du fait même de sa supériorité reconnue, pourra exercer le gouvernement – qui n’est donc pas un pouvoir exécutif.
En outre, que ce soit aux citoyens de déterminer la constitution par laquelle est établi le pouvoir souverain n’implique en aucun cas que les citoyens soient souverains ; pour le dire avec le vocabulaire des droits de l’homme (article 3), Aristote ne juge pas que la participation du citoyen à la détermination constitutionnelle équivaille à dire que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». Chez Aristote, la forme démocratique du pouvoir est un cas particulier, celui où le pouvoir souverain échoit au peuple lui-même. Mais il est essentiel de ne confondre la vie politique des citoyens, inhérente à toute cité et en vertu de laquelle une constitution ne peut s’établir que conformément à la discussion des citoyens, ni avec la souveraineté du peuple ni avec l’érection du peuple comme détenteur du pouvoir suprême qui en ferait le souverain. En d’autres termes, la participation du citoyen à la vie politique n’implique ni souveraineté de la nation, ni forme démocratique du pouvoir.
La constitution (politéia) d’une cité a donc deux versants. Le premier est constitutif : il est ce par quoi une cité est bien une cité, c’est-à-dire une forme de vie politique définie par son autodétermination en vertu de laquelle elle peut se donner à elle-même des principes collectifs, signalant du même geste son indépendance. Le second est institutionnel : il vise à déterminer un pouvoir souverain au sein de la cité et, prise en ce sens institutionnel, la constitution fixe le pouvoir apte à gouverner – qui peut être dans l’idéal le pouvoir d’un citoyen d’exception (monarchie), de plusieurs citoyens vertueux (aristocratie) ou d’un cadre mixte (politie).
On comprend donc que l’indépendance, au sens aristotélicien, n’est pas la souveraineté, car à l’échelle de la cité – on peut transposer le raisonnement aux États –, l’idée d’une supériorité est vide de sens : la cité n’est supérieure à rien. En revanche, l’indépendance est la condition de possibilité pour que la cité détermine institutionnellement et par elle-même, c’est-à-dire constitue, ce qui sera le pouvoir souverain en son sein et auxquels obéiront les citoyens, lequel pouvoir ne restera légitimement souverain que s’il parvient à défendre les principes généraux que la cité s’est donnés.
A lire aussi,
Podcast. Platon / Aristote : la République et la cité. Damien Theillier
Émergence d’une souveraineté d’État
Dans ces conditions se comprend ce qu’est la révolution moderne de la souveraineté : elle n’est plus tant la domination d’un pouvoir sur les autres au sein d’un cadre politique que l’affirmation de la souveraineté du cadre politique lui-même, sans doute parce qu’il fallait que le cadre politique pût, en matière politique, se dire supérieur à l’autorité religieuse. Autrement dit, si l’idée d’indépendance entre cités suffisait amplement au monde antique pour penser l’exercice du politique, l’advenue d’une autorité religieuse transpolitique à travers la figure papale a profondément changé la donne, et contraint les États naissants à se dire souverains en tant qu’États pour affirmer leur supériorité politique (ou temporelle) à l’endroit du pouvoir papal, et ce, en vue de sauver la possibilité même du politique.
Ainsi, lorsque Jean Bodin théorise en 1576 la souveraineté à nouveaux frais après des siècles de rivalité entre le pape et l’empereur, le propos se fait-il remarquablement clair : « La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République, que les Latins appellent majestatem, les Grecs arkhan éonsian et kurian arkhè et kurion politeuma[6] […]. » La République comme nom générique d’un cadre spécifiquement politique se fait donc souveraine, et cette souveraineté du cadre politique est puissance absolue et perpétuelle de ce même cadre. Cela signifie que Bodin passe du pouvoir à la puissance du fait même qu’il lui faut affirmer la possibilité d’une source politique à des décisions publiques. Autrement dit, une République souveraine n’est rien d’autre que l’affirmation de soi du cadre politique lui-même, en tant qu’il est le seul à être légitime dans le domaine concerné – le domaine politique – et qu’il ne saurait se subordonner à une autorité religieuse. Mieux encore, passer du pouvoir à la puissance, c’est faire de la volonté le cœur même de la souveraineté : est souveraine la République qui peut vouloir par elle-même et simultanément accomplir ce qu’elle veut. En ce sens, la souveraineté moderne dit que le politique est un vouloir, ce dont Rousseau prendra toute la mesure avec la notion de volonté générale.
Par conséquent, pour être opérante, cette puissance doit être absolue en ceci qu’elle ne saurait être dépendante de différents pouvoirs – songeons par exemple au cas français où le pouvoir royal dépendait pour les lois de la promulgation locale des Parlements[7] – qui serait un émiettement de la volonté. En somme, cette affirmation de soi s’accompagne d’une revendication d’unicité du lieu du pouvoir libéré de la pluralité des Parlements. C’est pourquoi Bodin croit – à tort – que son concept de souveraineté rejoint celui de pouvoir souverain grec. S’il est vrai que l’auteur de la République détermine l’unicité d’un pouvoir suprême, il n’en demeure pas moins que, chez lui, c’est l’État au sens propre qui est souverain et qui, pour exercer une telle souveraineté, suppose de n’être pas morcelé en différents pouvoirs qui se neutraliseraient. Preuve en est que l’affirmation même du cadre politique – la puissance – est perpétuelle et donc inhérente à la continuité de l’État et non à une magistrature particulière.
Ainsi le premier livre de la République de Bodin assume-t-il une triple supériorité de la souveraineté : une supériorité de la République comme cadre générique politique sur l’autorité religieuse pour traiter des questions qui concernent justement la vie politique – telle est la puissance inhérente à la souveraineté qui dit l’auto-affirmation du politique –, supériorité qui se prolonge dans l’unicité d’un pouvoir non partagé, non morcelé, rendant immédiatement exécutoire la décision au sein de la vie étatique et dont le premier marqueur sera la capacité à établir des lois – des règles universelles au sein de la République. Enfin, une telle approche établit paradoxalement la supériorité de l’État sur le prince ; celui-ci n’est jamais que le détenteur occasionnel d’un pouvoir qui ne lui appartient intrinsèquement pas.
Toutefois, et contrairement à ce qu’une lecture hâtive pourrait laisser croire, Bodin n’assimile pas la puissance absolue à une puissance illimitée : qu’elle affirme les droits du politique contre les assauts religieux et qu’elle délie la décision politique de son morcellement en plusieurs pouvoirs est une chose ; mais en inférer que la souveraineté ne se heurte à rien en est une autre. De fait, Bodin établit trois limitations fondamentales de la souveraineté : 1) la loi divine (révélée) contre laquelle elle ne peut s’exercer ; 2) le droit de propriété individuelle, qui ne saurait être violé ; 3) dans le cas français, le respect des lois fondamentales du royaume qui forment une sorte de sagesse coutumière de la nation.
A lire aussi,
Pacte ou compromis, la souveraineté française au Moyen-Âge
Hésitations de la souveraineté et lieu vide du pouvoir
Ces deux approches conceptuelles de la souveraineté permettent in fine d’établir deux évidences. La première tient au caractère strictement relationnel de la souveraineté, laquelle ne peut être qu’une relation de domination sur quelque chose, en vertu d’une supériorité. La seconde se déduit de la première et établit que l’idée d’un État souverain est inconcevable à l’échelle internationale.
Cela est manifeste dans les traités de Westphalie de 1648 dont le coup de maître consiste à produire un équilibre à partir du déséquilibre dont la souveraineté est porteuse. Ces traités affirment d’abord, pour les 350 États allemands, une superioritas territorialis, une supériorité territoriale qui permet à chaque État de fixer sa souveraineté par rapport à son territoire et non par rapport aux autres États. L’État exerce une domination – reconnue par les autres États – sur le territoire qu’il maîtrise, mais une telle supériorité n’est pas nommée souveraineté, car il ne s’agit pas d’engager de rapport de domination envers les autres États. Cela est évident dans la conceptualité aristotélicienne qui explique fort bien qu’une cité indépendante à l’endroit des autres n’engage pas de souveraineté – donc de supériorité – à l’endroit de ces dernières.
Mais en même temps, Westphalie consacre bien ce que Bodin avait conçu, à savoir une souveraineté d’État, ce que reprendra du reste Hobbes dans le Léviathan avec le concept de potestas et que ratifiera Le Fur en 1896 en considérant que la souveraineté ne peut être qu’une qualité d’État, par laquelle ce dernier se détermine depuis l’affirmation de sa propre volonté. Mais, pour cette raison, la puissance absolue des États se heurte de fait à la volonté politique des autres États, la pluralité même de ces derniers générant une relativisation du caractère absolu de la puissance souveraine. À cet effet, on doit noter le caractère insoluble de la souveraineté d’État lorsqu’elle est envisagée entre États souverains, et dont le droit international révèle presque l’absurdité à travers la notion d’égalité souveraine établie par la charte de l’ONU (art. 2, § 1), dont on sent la nécessité, mais qui est au sens propre un oxymore.
On pourrait alors se rabattre sur l’aspect strictement institutionnel de la souveraineté et ne chercher qu’à établir au sein d’un État donné quel pouvoir pourrait être suprême – quel serait le lieu de la souveraineté –, mais l’on retomberait en réalité dans bien des tourments. D’une part, il faudrait déterminer la légitimité d’une telle souveraineté, et l’on serait tenté de l’enraciner dans la nation selon l’incitation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Mais si la nation est détentrice de la souveraineté, cela nous fait quitter le domaine strictement politique et impose de considérer le peuple de manière métaphysique, comme une espèce d’individu unique dont la volonté serait une. Comme le disait fort bien l’abbé Adrien-Quentin Buée en 1792 dans son Nouveau dictionnaire, « pour considérer la Nation comme souveraine, il faut la considérer comme individu ; individu métaphysique ; par conséquent, souveraineté métaphysique. La volonté d’un individu seul est une et indivisible. » Ce faisant, nous serions contraints à faire du peuple une sorte d’entité métaphysique unifiée par l’on ne sait quelle grâce, et l’on comprend mieux pourquoi Aristote ne fait pas du peuple un peuple souverain. D’autre part, il faudrait rendre compte, si le peuple est souverain, de la délégation de sa souveraineté à un pouvoir auquel il accepterait d’obéir. Mais comment une telle délégation peut-elle avoir lieu sans contradiction, c’est-à-dire sans établir que le peuple est simultanément supérieur à tout et inférieur au pouvoir auquel il obéit ? C’est afin d’éviter une telle contradiction que Rousseau avait refusé toute délégation de la souveraineté à des représentants.
Peut-être est-il temps de revenir à cette idée chère à Claude Lefort – et récemment remise au goût du jour par Raoul Moati[8] – de « lieu vide du pouvoir », afin de sauver l’idée de souveraineté en renonçant paradoxalement au lieu de son incarnation pour en sauver la cohérence.
[2] Aristote, Les Politiques, I, 2, 1252b28-30, traduction Pierre Pellegrin, GF, 1990, 1993², p. 90.
[3] Ibid., 1252b-34, p. 90.
[4] À la notable exception de Pierre Dardot et Christian Laval dans Dominer, La Découverte, 2020.
[5] Ibid., III, 6, 1278b9-11, p. 225.
[6] Jean Bodin, Les Six Livres de la République, I, 8, édition de Gérard Mairet, LGF, 1993, p. 111.
[7] Sur ce point, les études d’Arlette Jouanna, Le Pouvoir absolu et Le Prince absolu (Gallimard, 2013 et 2014) sont désormais indispensables.
[8] Cf. Raoul Moati, La démocratie captive, Hermann, 2022.