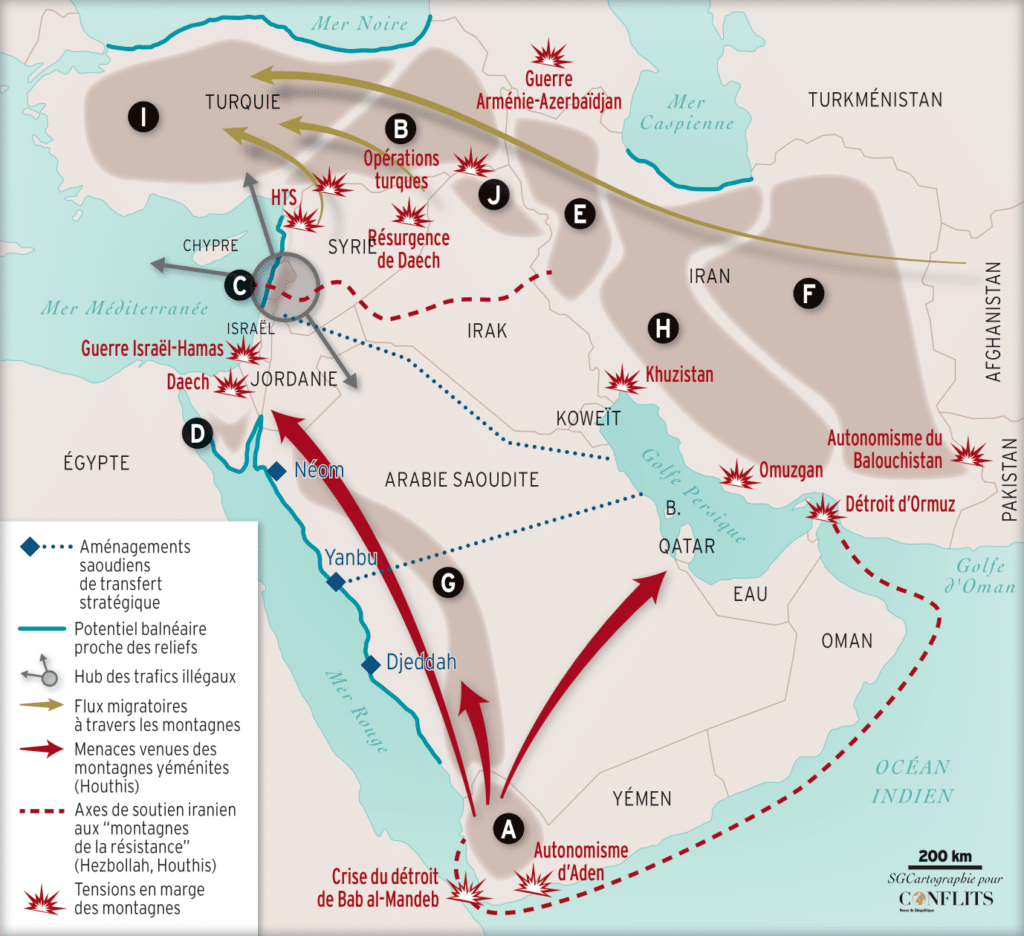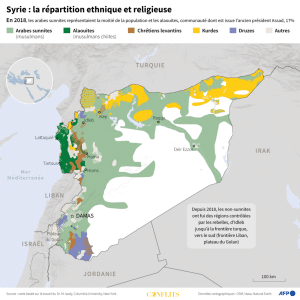Les relations entre Israël et la Turquie sont complexes et méfiantes. Entre crainte de militarisation et déploiement de troupes, les deux pays sont prudents et attendent des États-Unis de jouer le rôle d’arbitre.
Le Premier ministre Benyamin Netanyahou s’est récemment rendu à Washington pour une visite éclair, ponctuée d’un entretien avec le président américain Donald Trump. À l’ordre du jour, selon la presse : les tarifs douaniers — les exportations israéliennes ayant été frappées d’une taxe de 17 % —, la question des otages, Gaza, et bien entendu l’Iran. Toutefois, un autre sujet aurait également mérité d’être abordé : le rôle de la Turquie dans la Syrie post-Assad, et plus largement, l’évolution des relations entre Jérusalem et Ankara, aujourd’hui au plus bas depuis l’arrivée des islamistes au pouvoir.
Ankara cherche à faire de la Syrie un levier géopolitique en installant une présence militaire durable dans ce pays affaibli. Cette ambition s’accompagne d’une offensive diplomatique destinée à réintégrer le programme américain F-35, dont la Turquie a été exclue en 2020. Selon la presse turque, Israël utilise son influence à Washington pour bloquer cette tentative turque. Derrière ce bras de fer diplomatique se dessine une inquiétude plus profonde du côté israélien : celle de voir la Turquie profiter du vide syrien pour transformer la Syrie en un vassal, non seulement sur le plan économique ou politique, mais également — et surtout — sur le plan militaire.
L’inquiétude turque
Ce qui inquiète le plus Jérusalem est la possibilité de se retrouver avec une présence militaire turque — au sol comme dans les airs — à proximité immédiate de ses frontières. Une telle évolution compromettrait gravement l’autonomie opérationnelle de Tsahal en Syrie. Cette autonomie est un intérêt israélien vital, car l’Iran a transformé la Syrie d’Assad en base arrière du Hezbollah libanais.
Depuis 2015, la Russie s’est imposée comme acteur central du théâtre syrien, en assurant la survie du régime de Bachar el-Assad. Pour Israël, cette présence a entraîné une nécessaire coordination militaire avec Moscou, notamment à travers un mécanisme de déconfliction mis en place dès 2015 afin d’éviter les confrontations accidentelles dans l’espace aérien syrien.
Ce système a permis à Tsahal de maintenir une autonomie opérationnelle relative, en menant des frappes ciblées contre des infrastructures iraniennes et des convois du Hezbollah, sans provoquer de réaction directe de la part des forces russes. Néanmoins, cette autonomie était fragile et dépendante du bon vouloir du Kremlin. La chute d’Assad a levé ces contraintes, mais désormais, avec sa montée en puissance en Syrie, la Turquie pourrait devenir un nouvel acteur contraignant dans l’espace aérien syrien, réduisant la liberté de manœuvre d’Israël.
Cette crainte s’est traduite récemment par des frappes aériennes ciblées sur la base de Tiyas (T4) et sur l’aéroport militaire de Palmyre, tous deux situés dans la province syrienne de Homs. Ce sont précisément ces deux sites que la Turquie envisageait, selon plusieurs sources, d’investir dans le cadre de sa stratégie de redéploiement.
Derrière cette offensive militaire discrète se cache un projet technologique ambitieux. Ankara envisage d’y installer ses propres systèmes de défense aérienne : le Hisar-O à moyenne portée, le Hisar-U, et surtout le SIPER à longue portée. Il est également question d’un éventuel déploiement du système russe S-400, sous réserve de l’approbation de Moscou.
La base aérienne de Tiyas (T4), située à l’ouest de Palmyre, dans la province syrienne de Homs, se trouve à une distance estimée à 220 kilomètres de la frontière israélienne. Si la Turquie y déploie des systèmes de défense aérienne à longue portée, comme le SIPER ou le S-400, cette base pourrait menacer partiellement l’espace aérien israélien, en particulier dans le nord du pays.
Transformer l’équilibre régional
Dès lors, l’installation de batteries à T4 ne serait pas une simple opération défensive, mais une transformation de l’équilibre aérien régional. Elle placerait l’armée de l’air israélienne sous la menace constante d’une surveillance — et d’une interception potentielle — restreignant de facto sa liberté d’action, non seulement en raison de sa capacité technique, mais en raison du « coût » politique et stratégique de toute violation d’un espace désormais contesté. La Turquie cherche à s’imposer comme une puissance militaire autonome, capable de projeter sa force au-delà de ses frontières. Le ciel devient ainsi un espace politique autant que tactique : chaque radar déployé, chaque système activé constitue une déclaration d’intention. Si, sous Bachar el-Assad, Israël devait coordonner ses actions avec Moscou, une militarisation turque de la Syrie signifierait une nouvelle dépendance stratégique, cette fois envers Ankara.
La volonté de Recep Tayyip Erdoğan de réintégrer le programme F-35 s’inscrit dans cette même logique. Depuis l’acquisition en 2017 du système S-400 auprès de la Russie pour 2,5 milliards de dollars, Washington a imposé à la Turquie des sanctions dans le cadre de la loi CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, adoptée en 2017 sous l’administration Trump, qui constitue un cadre juridique de sanctions visant trois pays désignés comme adversaires stratégiques des États-Unis). En 2020, Donald Trump a formellement exclu Ankara du programme F-35 en réponse à la décision d’Ankara d’acquérir le système de défense antiaérienne russe S-400, jugée incompatible avec les intérêts de sécurité des États-Unis et de l’OTAN. Privée de ces avions, la Turquie a envisagé d’autres options, telles que l’Eurofighter Typhoon européen. Mais la politique ouvertement anti-israélienne du président turc a poussé l’Allemagne à bloquer les négociations.
Armement de la région
Aujourd’hui, Erdoğan revient à la charge. Un rapport de Fox News a récemment révélé que Trump envisage de lever les sanctions et de reprendre les ventes de F-35. Son équipe étudie les voies juridiques et techniques pour contourner les restrictions en vigueur. Cette évolution pourrait redéfinir les rapports de force dans le ciel du Proche-Orient. La réintégration de la Turquie dans le programme bénéficierait non seulement à son armée de l’air, mais aussi à son industrie de défense. Des entreprises comme Turkish Aerospace Industries ou Aselsan, qui fournissaient déjà plus de 900 composants pour les F-35 avant leur exclusion, retrouveraient leur place dans la chaîne de production.
Dans ce tableau complexe, un fait singulier mérite d’être relevé : Israël et l’Iran, souvent opposés sur presque tout, partagent ici une inquiétude commune : la montée en puissance régionale de la Turquie. Pour l’Iran, le basculement de la Syrie — autrefois pilier du corridor chiite et plateforme logistique pour le Hezbollah — vers l’orbite turque représente une perte stratégique majeure.
Les États-Unis se trouvent depuis plusieurs années — en réalité depuis 2009 et le virage anti-israélien d’Erdoğan — dans une position délicate, contraints d’opérer un arbitrage stratégique entre deux alliés majeurs et de plus en plus opposés, Israël et la Turquie. L’administration américaine s’efforce de maintenir une relation fonctionnelle avec Ankara, en dépit de tensions persistantes (acquisition du système S-400, dérives autoritaires, répression intérieure, proximité avec des groupes islamistes et critiques virulentes d’Israël). Parallèlement, le soutien à Israël demeure une constante de la politique étrangère américaine, fondée sur des intérêts stratégiques communs, un appui bipartisan au Congrès et une coopération militaire étroite.
Lorsque les intérêts des deux partenaires entrent en conflit, Washington adopte généralement une position d’équilibriste. Ces dernières semaines, l’administration Trump semble décidée à réévaluer la place de la Turquie dans sa stratégie régionale. Cette inflexion s’inscrit dans une volonté plus large de restaurer certaines alliances négligées ou fragilisées ces dernières années.
Lors de sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, Donald Trump a proposé une médiation directe entre Israël et la Turquie. Réaffirmant ses liens personnels avec Erdoğan, qu’il qualifie de « très intelligent », Trump s’est dit convaincu de pouvoir « arranger les choses ». Cette déclaration traduit une conviction stratégique : malgré ses dérives et ses partenariats ambigus, notamment avec Moscou, la Turquie ne peut être durablement écartée du camp occidental.
Le dossier des F-35
L’aspect le plus concret de ce rapprochement réside dans la réouverture du dossier F-35. Une issue favorable marquerait le retour d’Ankara dans l’écosystème stratégique américain, avec des conséquences majeures pour l’équilibre régional, en particulier vis-à-vis d’Israël.
Pour Washington, cet arbitrage repose sur un calcul géopolitique : la Turquie demeure un acteur clé de l’OTAN, un verrou entre l’Europe et l’Asie, et un pays capable d’influencer plusieurs théâtres sensibles — Syrie, Irak, mer Noire, Méditerranée orientale. En renouant avec Erdoğan, Trump espère à la fois contenir l’influence croissante de la Russie et de l’Iran, et réduire la dépendance turque à l’égard de Pékin et Moscou.
Côté israélien, la perspective d’un réarmement turc avec des technologies occidentales suscite une vive inquiétude. Jérusalem redoute un affaiblissement de sa supériorité aérienne qualitative, d’autant que les relations avec Ankara restent marquées par la méfiance et l’hostilité.
Les Américains chercheront probablement à encourager leurs deux partenaires à établir des mécanismes de gestion de crise — lignes rouges, téléphone rouge, partage de l’espace aérien, comités conjoints — afin d’éviter incidents et escalades. En revanche, il serait illusoire d’espérer une recomposition stratégique durable : la région restera saturée de rivalités croisées.