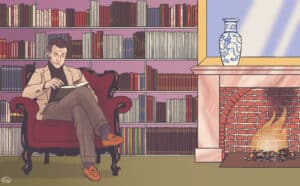La conception moderne de la guerre juste, celle qui figure notamment dans le catéchisme de l’Église catholique, se réfère à saint Thomas d’Aquin, qui se fonde lui-même sur saint Augustin. Mais qu’y avait-il avant ce dernier ? C’est ce que sur quoi se penche Bellum iustum, aux origines de la conception occidentale de la guerre juste , l’ouvrage que Jean-François Chemain a tiré de sa thèse d’histoire du droit.
« Les Romains ont conquis leur empire en défendant leurs alliés ». Étrange paradoxe qui ne fait pas peur à Cicéron, son auteur. Bellum iustum… L’obsession de Rome, pendant les douze siècles de son existence, fut que ses guerres fussent justes, car telle était la condition de sa victoire. Mais la conception qu’elle se faisait de cette justice a connu, sur une période aussi longue, des évolutions importantes.
Lire aussi : L’Europe et la romanité. Entretien avec Rémi Brague
Dans les temps archaïques, aux origines de l’Vrbs, il s’agissait moins de « justice » que de « justesse » d’un rituel de déclaration de guerre qui devait être scrupuleusement respecté par les prêtres fétiaux, qui en avaient la responsabilité. L’effet en était alors magique, marqué par l’ensauvagement du légionnaire qui se transformait en bête fauve, mettant en déroute l’ennemi terrorisé. Puis on y mêla les dieux, Jupiter en premier, que les fétiaux devaient convaincre de la justice de la cause de Rome (iusta causa) pour que, du haut du ciel, il prenne parti pour elle. Ces prêtres ne lésinaient pas sur la casuistique : Rome avait toujours raison, c’est sans doute pour cela qu’elle se persuada rapidement que Jupiter lui avait promis l’empire du monde. La foi absolue (fides) des Romains soulevait des montagnes.
Lire aussi : Rome face aux invasions barbares
Puis la politique entra en jeu, quand la plèbe obtint l’égalité des droits avec le patriciat : la procédure de déclaration de guerre s’enrichit de l’obligation d’obtenir le iussum populi (l’ordre du peuple) à la guerre, et les dieux de la plèbe, à commencer par Fortuna, la « fortune de Rome », furent à leur tour concernés. C’est alors que la Ville mit en avant le concept de maiestas populi Romani : la majesté du peuple romain imposait aux autres peuples un respect auquel tout manquement constituait une « juste cause » de déclaration d’une « guerre juste », donc victorieuse.
Il revint à Cicéron de formaliser les tâtonnements, chez un peuple peu porté sur la chose, de la justification philosophique de la guerre romaine. Puisant aux sources stoïciennes, aristotéliciennes, sophistes ou académiques, les Romains construisirent une théorie pragmatique, selon laquelle leurs guerres étaient justes dès lors qu’elles avaient pour but de réunir les peuples civilisés, dont c’était l’intérêt, dans un empire commun, qui avait vocation à s’étendre à l’humanité tout entière. Avec eux, des règles devaient être respectées, et les moyens rester modérés. L’inhumanité des peuples barbares, en revanche, les excluait de l’humanitas, et contre eux tout était permis, jusqu’à les exterminer. César mena donc ses guerres contre les Gaulois et les Germains sans respecter aucune règle : elles étaient justes par la nature même de l’ennemi.
La christianisation de l’Empire, au IVe siècle, ne changea pas grand-chose : on attribua au Dieu des chrétiens ce qu’on prêtait naguère à Jupiter, et les guerres romaines devinrent justifiées, et donc victorieuses, par le fait qu’elles se confondaient avec la défense de l’Église. Mais l’accumulation des défaites, et la prise de Rome par les Wisigoths, en 410, conduisirent saint Augustin à refonder la théorie romaine de la guerre juste. Celle-ci doit avoir une juste cause, être défensive, décidée par une autorité légitime, et proportionnée à la menace, mais même quand ces critères sont réunis on ne saurait désormais être assuré de la victoire. La Cité de Dieu, qui seule doit importer au chrétien, ne saurait être confondue avec la Cité des Hommes, mortelle. Il peut être dans les plans de Dieu de vouer cette dernière à la défaite, voire à la disparition. Et c’est bien ce qui ne tarda pas à arriver.
Jean-François Chemain, Bellum iustum. Aux origines de la conception occidentale de la guerre juste, Apopsix, 2018, 354 p., 26€.