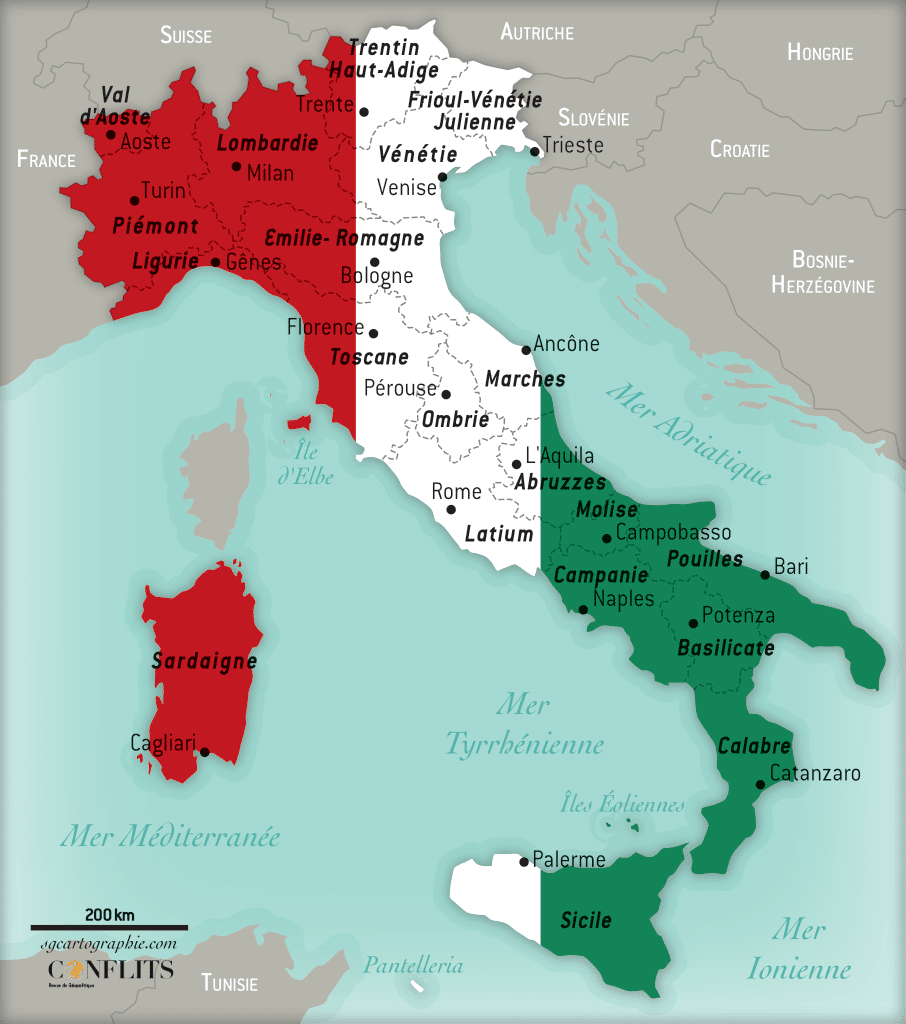La géopolitique ne s’arrête pas aux frontières de la France. Elle ne se confond pas non plus avec les États-Unis d’Amérique, en dépit de l’abondance de leur production. Il existe à travers notre continent de nombreuses écoles de géopolitique que Conflits entend vous faire découvrir. Première étape de ce
Tout d’Europe, l’Italie, avec le plus connu et le plus influent des géopoliticiens de la péninsule, Lucio Caracciolo.
Vous êtes né à Rome en 1954. Est-ce un atout pour devenir géopoliticien ?
Rome constitue un excellent point d’observation géopolitique parce qu’elle est chargée d’histoire universelle. Et puis elle est encore le centre de rayonnement de l’Église catholique, c’est-à-dire d’une structure religieuse universelle qui a influencé pendant des siècles la géopolitique italienne, européenne, mondiale. Et qui continue à le faire sur un mode mineur.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre famille ainsi que sur votre adolescence. L’Italie des années 1970 est marquée par des luttes politiques intenses. Y avez-vous participé ?
Je suis né dans une famille d’intellectuels. Mon père était un historien de l’économie et de la société italienne, ma mère était historienne du droit. Lorsque nous étions enfants, mon frère, qui était un artiste, et moi suivions nos parents quand ils étaient invités à des congrès historiques internationaux.
J’ai encore le souvenir vivant de l’un de ces voyages. C’était en août 1968 et nous avions embarqué sur le navire yougoslave Jedinstvo (« Unité ») pour une croisière/congrès d’historiens. Le soir du 20 août j’ai vu les marins yougoslaves terrorisés à la nouvelle de l’invasion de la Tchécoslovaquie. « Nous serons les prochains » disaient-ils.
Et qu’en avez-vous pensé vous-même ?
L’entrée des chars soviétiques à Prague fut un choc pour moi aussi. Je m’intéressais déjà à la politique et nous la respirions chaque seconde à la maison. Mes parents étaient communistes, même s’ils avaient quitté le Parti en 1956 après Budapest. Pas pour devenir plus modérés d’ailleurs, mais au contraire pour devenir plus extrémistes ! Moi aussi j’ai été communiste, militant pour la Fédération de la jeunesse communiste italienne (FGCI) de 1971 jusqu’en 1975. Il s’agissait dans mon cas d’un communisme « à l’italienne », plutôt ingénu, fondé sur le rejet de l’URSS comme de la Chine, sur une sympathie très modérée pour le « modèle » yougoslave et sur l’espoir que naisse une traduction nationale et démocratique des
idéaux communistes. En un mot j’étais le plus à droite de ma famille – ce qui n’était pas très difficile. En même temps, j’avais un oncle qui avait combattu pour la république de Salo, fasciste absolument pas repenti, cultivé et intelligent ; j’ai donc appris à écouter l’autre son de cloche. C’est un élément fondamental pour mes futures études historiques et géopolitiques. J’ai participé très jeune au mouvement étudiant du « mai rampant », mais sans trop m’engager. Je n’aimais pas son radicalisme et son spontanéisme. En revanche j’ai appris beaucoup de mes années
de militantisme à la FGCI, entre 1971 et 1975, au contact de cette exceptionnelle école de politique, de culture et d’humanisme qu’a été le Parti communiste italien, avec ses militants souvent merveilleux et sa grande ouverture internationale.
Vous vous êtes orienté alors vers des études de philosophie. Cela vous a-t-il été utile ensuite pour vos activités de géopoliticien ?
J’ai commencé à travailler à 19 ans comme rédacteur de la revue de la FGCI Nuova Generazione avant de passer à 22 ans à La Repubblica, un nouveau journal de la gauche laïque et libérale où je suis resté jusqu’à la trentaine. Mes études universitaires s’en sont trouvées plutôt fractionnées, si bien que je n’ai été diplômé qu’en 1984 !
Je n’ai jamais réussi à me concentrer sur une seule matière, je suis curieux de trop de choses. L’organisation assez libérale des études de philosophie à l’université de Rome m’a permis d’étudier Hegel comme l’art antique, Marx comme l’histoire du fascisme, Proudhon ou Stirner comme l’école de Barbizon. J’ai d’ailleurs soutenu ma thèse de laureato sur la renaissance et la liquidation de la social-démocratie allemande dans la zone d’occupation soviétique (1945-1946). Pour cela j’ai vécu
quelques mois à Berlin-Est, dans un hôtel du SED (le parti-État de l’Allemagne « démocratique »), avec des terroristes palestiniens et des espions bulgares, faisant semblant d’être un bon « camarade », sous surveillance constante. J’en étais ulcéré, mais j’ai appris des choses que je n’ai pas oubliées.
Pour revenir à la philosophie, elle est bien sûr utile pour la géopolitique. C’est en effet son exact opposé : elle s’évade du temps et de l’espace et cherche à dépasser les conflits en élaborant des formules abstraites et universelles. Elle se prétend souvent une science et produit des théories, ce que la géopolitique justement ne doit pas, ou ne devrait pas, faire. Il n’y a pas de meilleur moyen pour connaître quelque chose que d’étudier son parfait contraire.
En outre, à cause de son abstraction, la philosophie constitue une formidable gymnastique mentale. Ainsi elle nous aide à créer des liens, à imaginer des connexions qui peuvent être utiles en géopolitique. À condition de ne pas tomber dans la trappe des « modèles » ou des analogies historiques. Quand on est surchargé de cartes et de dates, lire quelques pages de la Phénoménologie
de l’Esprit, de préférence commentées par Jean Hyppolite, ou de l’Apologie de la contingence d’Odo Marquard, un sceptique allemand qui est mon philosophe préféré, cela élargit l’esprit. Mais j’apprécie aussi Alexandre Kojève, même s’il s’agit du plus géopolitique des philosophes du XX e siècle.
Puis vous devenez rédacteur en chef à MicroMega. Est-ce alors que votre intérêt pour la géopolitique s’est affirmé ?
J’ai travaillé pendant huit ans à La Repubblica comme journaliste politico-parlementaire. Peu utile pour la géopolitique directement, beaucoup pour comprendre les logiques de pouvoir. J’ai abandonné le journalisme en 1982 pour achever mes études en Allemagne, comme je l’ai dit plus haut. J’ai étudié les relations entre Allemands des différentes zones d’occupation ainsi qu’entre eux
et les occupants, après guerre ; cela supposait de croiser des points de vue géopolitiques différents et cela m’a fait comprendre, par exemple, l’importance des origines et des enracinements dans les décisions des leaders politiques. Un seul exemple : si l’on ne comprend pas la haine du rhénan Adenauer pour Berlin la prussienne, on ne comprend pas la naissance et les premiers pas de la RFA.
De 1986 à 1994 j’ai été rédacteur en chef de la revue culturelle et politique Micromega. C’est là que nous avons décidé d’affronter le thème de la géopolitique, terme jusqu’alors proscrit car il était associé au nazisme et au fascisme. Nous avons publié un dossier sur la géopolitique sous la direction de Michel Korinman, avec la participation de quelques collaborateurs d’Hérodote. C’est alors que j’ai eu le privilège de rencontrer Yves Lacoste.
Michel Korinman me proposa alors de créer ensemble une revue de géopolitique italienne, Limes, que nous avons codirigée de 1993 à 2000 et dont Lacoste fut au départ conseiller spécial de la direction. Limes est donc née avec une marque française forte, et ceci avant tout grâce à Michel Korinman, sa rigueur, sa passion. En même temps Limes était, et reste, une revue italienne, enracinée dans notre histoire et notre culture.
Quelle a été l’influence de Michel Korinman sur vous ?
Michel Korinman m’a ouvert un monde que je ne connaissais pas, celui de la géopolitique. Tout ce que j’ai appris – ou j’ai cru apprendre – dans ce domaine dérive de notre collaboration.
Avez-vous bénéficié de soutiens pour vous lancer dans l’aventure de Limes ?
L’éditeur en était L’Espresso. Faire partie d’un grand groupe d’édition a bien sûr facilité notre succès. Mais ce succès alla plus loin que les prévisions les plus optimistes. Le premier numéro, sur les conflits yougoslaves, fut aussitôt réimprimé et nous en avons vendu à peu près 15 000 exemplaires, un chiffre qui représente aujourd’hui encore la moyenne de nos ventes. Quelques numéros ont même atteint les 100 000 exemplaires. En liaison avec la revue est né un mouvement géopolitique, articulé par exemple autour des clubs Limes présents en Italie et au-delà, et autour de nombreux événements publics que nous organisons chez nous et dans le monde.
Que signifie pour vous ce titre « Limes » ?
Un bon titre doit avoir plusieurs significations. Pour moi Limes veut dire au moins deux choses. En s’attachant à l’étymologie latine, il désigne un critère d’analyse puisqu’il n’y a pas de géopolitique sans limites. Par ailleurs le mot renvoie au limes romain, qui n’est pas seulement le terme de l’Empire, comme on le croit aujourd’hui, mais le point de départ de ses voies de pénétration dans les terres barbares (c’est-à-dire inconnues, ou presque).
Dans l’éditorial du premier numéro de Limes, vous regrettez que les hommes politiques de votre pays aient évacué l’idée de nation, vous critiquez l’idée de « patriotisme constitutionnel » chère à Habermas. Vous pensez que la nation signifie encore quelque chose à l’heure de la mondialisation et de l’Union européenne ?
Lors de la parution de Limes, et après avoir lu l’éditorial écrit par Michel Korinman et moi, quelques bien-pensants nous ont accusés de fascisme, ce qui nous a fait bien rire. La raison est qu’en Italie, jusqu’à il y a quelques années, le terme de « nation » était compris de façon négative, comme la préférence pour un nationalisme agressif. En fait être une nation signifie partager certaines valeurs
et surtout une idée et une pratique de la vie en commun, à travers des institutions légitimes.
La solution alternative à la nation n’est pas le patriotisme constitutionnel, qui n’existe que dans la tête d’Habermas. Un bel oxymore ! Vous Français, vous avez connu plusieurs constitutions ; combien de fois avez-vous changé de patrie ? Je ne crois pas non plus à la solution du cosmopolitisme, comme certains l’espèrent ou font semblant de l’espérer. La solution alternative à l’État-nation hétérogène, berceau de la démocratie en Europe occidentale, est toujours le racisme ou toute autre forme d’irrationalité viscérale et violente. Et d’un autre côté l’Empire, ou plutôt ce qui reste de cette idée.
Vous ne croyez pas que la mondialisation ou la construction européenne condamnent l’État- nation ?
Je ne crois pas vivre l’époque de la globalisation et de l’Union européenne. En ce qui concerne la première, je n’ai pas bien compris de quoi il s’agit : au sens strict, elle suppose un point de vue universel, donc l’absence de conflits. Fin de la géopolitique et des géopoliticiens. Ne serait-ce que pour des raisons corporatistes, je ne peux adhérer à ce « passe-partout » (sourire).
Quant à l’Union européenne, c’est un bluff grandiose. Une tentative pour abolir l’histoire, elle-même abolie par l’histoire. Un objet fétiche, maintenu sur pied pour des raisons strictement utilitaristes par quelques États membres afin de protéger leurs intérêts nationaux respectifs, mais sans âme ni projet.
Dans ce même éditorial vous critiquez le déterminisme géographique : les empires terrestres ne sont pas condamnés à combattre les thalassocraties dites-vous. Vous insistez sur le fait que tous les cas sont des exceptions. Vous ne croyez pas en la généralisation ?
J’ai dit et je confirme que je déteste le flou, c’est-à-dire les généralisations, et le déterminisme géographique, la prétention de transformer en science politique des phénomènes supposés de géographie physique. La géopolitique est dynamique et ouverture, ou bien elle n’est pas. Les lois générales, laissons-les aux sciences dures. Quand j’entends dire que la géopolitique est la science qui étudie les fondements géographiques de la politique, je m’embrouille. Construire des modèles d’interprétation des conflits qui se prétendent définitifs et universels, a-spatiaux, dans la meilleure des hypothèses c’est de la poésie, dans la pire de l’escroquerie. Political science.
À l’inverse, l’étude de cas peut paraître fatigante, mais elle en vaut la peine.
Vous refusez donc absolument l’idée qu’il y aurait des lois de la géopolitique ? Ne peut-on en tirer des leçons ?
Non, la géopolitique n’est pas une science, elle ne peut dont pas faire de prédiction.
Dans le questionnaire que nous vous avons soumis, vous vous dites « passionné de géopolitique et d’histoire ». Et la géographie ?
J’aime la géographie humaine : une passion. Je cherche à utiliser la géographie physique : une nécessité, parfois.
Dans ce même questionnaire vous dites que les États-Unis sont le pays le moins géopolitique de la planète. Que voulez-vous dire ?
Les Américains ont tendance à recourir aux modèles pour bâtir leurs stratégies. Les fameuses lessons learned. Ils croient pouvoir appliquer les leçons de la guerre de Cuba à celles du Vietnam ou d’Iraq…C’est du dopage politologique. Et nous en avons importé des doses massives chez nous ! Malheureusement, à force de parler l’anglais de la political science, on risque de désapprendre à penser.
« Quant à l’Union Européenne, c’est une tentative pour abolir l’histoire, elle-même abolie par l’histoire »
L’école géopolitique italienne a-t-elle des particularités ? Pouvez-vous la présenter à nos lecteurs rapidement ?
Il n’y a pas d’école géopolitique italienne, ou alors je ne la connais pas. La raison en est que l’Italie ne se pense pas comme un sujet géopolitique. Aussi, quand à Limes nous réfléchissons à nos intérêts géopolitiques, nous sommes persuadés que ces réflexions ne trouveront aucune application pratique. En même temps cette frustration rend souvent les analystes italiens particulièrement originaux, sensibles. Et libres. Il n’existe pas chez nous de mainstream géopolitique d’État car il n’y a
pas véritablement d’État.
Vous appelez à un nouveau rôle géopolitique pour l’Italie. Lequel ?
L’Italie posséderait, si elle le voulait, des cartes pour être reconnue comme un sujet géopolitique d’importance, au moins dans l’espace européen et méditerranéen. Un exemple : si l’Italie fait banqueroute, l’euro explose. Si la Grèce, le Portugal et même peut-être l’Espagne font banqueroute, l’euro peut survivre.
Et pourtant nous continuons à nous penser comme l’objet des politiques des autres. C’est que nos élites se méfient de notre peuple. Si nous ne nous respectons pas nous-mêmes nous ne pouvons attendre le respect d’autrui. C’est ce mal que nous devons soigner pour avoir un rôle en Europe et dans le monde.
C’est peut-être un mal incurable. Mais peut-être pas.
Faites-nous un peu mal – les Français adorent cela. Vous avez intitulé un éditorial récent de Limes consacré à la France : « L’impossibilité d’être normal ». Sommes-nous des monstres ?
Je vois dans quelques élites françaises une certaine tendance à vouloir paraître plus qu’elles ne sont. Donc à ne pas vouloir jouer un rôle « normal », c’est-à-dire réaliste, sur la scène géopolitique globale. À certains moments, cette attitude peut constituer une force. À la longue, me semble-t-il, elle affecte la puissance française.
[encadre]Le questionnaire de Lacoste
Inspiré du questionnaire de Proust, ce questionnaire, élaboré avec l’aide d’Yves Lacoste, est
adressé à toutes les personnalités invitées dans les grands entretiens de Conflits pour servir de
base à l’entretien.
Votre définition de la géopolitique ?
L’analyse des conflits de pouvoir dans des temps et des espaces déterminés, cartographiés, en croisant les points de vue des différents acteurs. Et si possible la capacité à tirer quelques pistes de solution.
Vous sentez-vous d’abord géopoliticien, géographe, historien, économiste, autre chose ?
Je suis un passionné de géopolitique et d’histoire.
La vertu cardinale d’un géopoliticien ?
Creuser dans la profondeur historique des conflits, car la géopolitique est avant tout archéologie.
Le péché capital pour un géopoliticien ?
Le flou. C’est-à-dire la science politique. Et le déterminisme géographique.
Votre maître (ou vos maîtres) ?
Michel Korinman.
Votre voyage le plus instructif ?
Tous mes voyages aux États-Unis, le pays le moins géopolitique du monde qui produit le plus de géopolitique au monde.
Votre sujet d’étude de prédilection ?
L’histoire européenne.
Le fondement de la puissance selon vous ?
La connaissance de nos limites. Et des limites d’autrui. D’où le nom de notre revue, Limes.
La nation la plus puissante dans 20 ans ?
La Chine, à condition qu’elle continue à faire profil bas.
Le pays ou la région dont l’évolution vous inquiète ?
L’Italie. Si mon pays se décompose et perd ses racines culturelles, ce sera une perte
énorme, et pas seulement pour nous Italiens. Le processus a commencé depuis un moment et peut-être ne durera-t-il pas longtemps. [/encadre]
[encadre]Bibliographie
[/encadre]