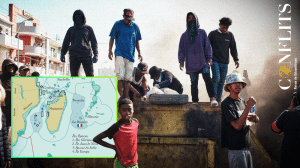La Géorgie, carrefour historique entre empires, affiche aujourd’hui un visage moderne tout en préservant son identité millénaire et sa foi chrétienne. Tiraillée entre influence russe, ambitions européennes et investissements chinois, elle s’impose comme un territoire stratégique au cœur des nouvelles routes commerciales eurasiennes.
Jean-Baptiste Bless
Dès l’atterrissage à Tbilissi (« ville chaude », en raison de ses sources thermales), la Géorgie offre un visage qui n’a plus grand-chose d’un pays soviétique. Si l’aéroport, très aéré, fait d’abord penser à Paris Roissy, c’est en fait une entreprise turque qui l’a rénové et étendu dans les années 2000. Les panneaux sont en géorgien et en anglais, il faudra attendre les sites touristiques pour lire du russe… Tiraillé depuis toujours entre différentes zones d’influence, ce pays intrigant nous ouvre ses portes.
Une capitale pleine de contrastes
En route, le contraste entre la magnificence des bâtiments officiels et la vétusté de certaines rues adjacentes est frappant. La Place de la Liberté et la grande avenue Rustaveli, du nom du poète médiéval, n’ont rien à envier aux allées des capitales européennes. La vieille ville ne semble en revanche pas particulièrement attirer les investisseurs, en dehors de sa rue principale. Une promenade le long du fleuve permet de découvrir le quartier d’affaires, perché sur la colline opposée, où se rassemblent enseignes européennes, gratte-ciel et chantiers résidentiels. Un peu plus plus loin, sur de la terre battue, une maison effondrée et un mini bar à vin récent se font face. La nuit, entre la forteresse de Narikala érigée au Ve siècle par le roi fondateur Vartang Gorgassal, et les églises qui brillent de mille feux, le fleuve Koura (Mtkvari en géorgien) serpente entre les falaises noires.
Les touristes viennent de partout, surtout de Russie et d’Europe, mais ils sont aussi indiens et chinois… Depuis une dizaine d’années, le pays s’est ouvert au monde entier. Politiquement, ce sont deux univers qui se rencontrent : le drapeau bleu aux étoiles jaunes flotte partout dans la capitale, tandis que les graffitis ne révèlent pas une russophilie évidente… D’ailleurs, deux régions séparatistes, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, sont occupées par l’armée du grand voisin avec la complicité des indigènes. Avant eux, les Perses, les Arabes, les Mongols et les Turcs se sont aussi disputé ce territoire charnière.
Culture millénaire et actualité brûlante
La première destination des visiteurs est habituellement la Kakhétie, région du vin et de la table, aux collines vertes parcourues de voitures Lada. Le pays produit plus de 500 variétés, souvent vinifiées dans de vastes amphores d’argile appelées qvevris. Deux spécialités au menu : le vin ambré, fait de jus de raisin blanc macéré dans sa pulpe, et le vin rouge mi-doux, dont la fermentation est interrompue précocement. La moitié de la production du pays part vers la Russie, « mais nous le livrons, car rien de bien n’est jamais venu du Nord », nous souffle un jeune vigneron. En Géorgie comme en Arménie, la culture du vin s’enracine bien avant la conversion de ces deux nations au christianisme, les récipients retrouvés remontant à plus de cinq millénaires. À ce jour, la moitié des familles produit son propre breuvage et celui-ci se boit d’une traite avec un toast.
Après le vin, la montagne. La route militaire russe, construite par les Tsars, relie Tbilissi à la frontière russe. Le Col de la Croix (ou Jvari) représente le seul passage ouvert entre les deux pays et permet le commerce avec l’Arménie, confinée entre des voisins hostiles, et l’Iran. Mais cet axe sert aussi à la Russie pour contourner les sanctions via la Turquie. Au passage le plus délicat, les Chinois construisent d’ailleurs avec des fonds européens (!) un tunnel pour favoriser ce transit (!!). En contrebas du col, le site de Stepansminda, toujours en construction, n’a rien à envier à certaines stations alpines. L’ascension du mont Kazbek (5047 m) se fait au départ du monastère cruciforme de la Sainte Trinité qui surplombe la vallée.
La foi comme pilier de la nation
À l’extrémité sud de cette route, à Mtskheta, non loin de Tbilissi, la cathédrale résonne chaque dimanche des chants polyphoniques traditionnels. Fondée au IVe siècle, après la conversion miraculeuse de la reine Nana grâce à Sainte Nino, patronne du pays, la ville forme toujours le cœur spirituel du pays, après en avoir été la capitale. Femmes et hommes de tous âges se mêlent pour une liturgie de trois heures qui nous fait remonter les siècles. À quelques dizaines de kilomètres de là, le musée de Gori en souvenir de Staline offre un contraste saisissant : rien n’y a bougé depuis 50 ans et le natif du pays continue de provoquer un brin de fierté dans la population. Un peu plus loin, Ouplistikhé, site datant de l’âge du fer, laisse imaginer ce que fut le centre politique et religieux dans l’Antiquité.
Au Sud, le massif du Petit Caucase fait frontière avec la Turquie. Le monastère troglodytique de Vardzia y évoque 900 ans d’histoire. Construit par le roi Giorgi III et sa fille Tamar à la fin du XIIe siècle pour servir de refuge, il a accueilli jusqu’à 1 000 moines. Un tremblement de terre l’a détruit quelques décennies plus tard et les Perses ont brûlé ce qui en restait ; seules subsistent des fresques en l’honneur de la Vierge Marie dans l’église de la Dormition. Puis le site s’est vu occupé par les bergers durant la présence ottomane. Avec l’arrivée de la Russie au XIXe siècle, les lieux retrouvent leurs fonctions religieuses, avant d’être transformés en musée par les Soviétiques. Actuellement, quatre moines et un novice y résident.
Un pays tourné vers la mer
En remontant une heure vers le nord, la ville d’Akhaltsikhé témoigne pour la première fois de la présence ottomane et du mélange des cultures. Le château étonnamment restauré en 2011 réunit style géorgien classique et mosquée circulaire. Mais les architectes du XXIe siècle ayant visiblement laissé parler leur fantaisie, quelle place est laissée à l’authenticité ?
Il faut ensuite passer le col de Goderdzi à 2 025 m et rouler plusieurs heures à travers des vallées escarpées pour redescendre plein ouest sur la mer Noire et la ville de Batoumi. Un autre monde : climat doux, espèces exotiques, entre palmiers et bananiers. Une ville bondée de touristes en été et qui accueille des minorités turques, mais aussi russes et ukrainiennes, israéliennes et iraniennes. Tout le monde se retrouve pour faire la fête, jouer de l’argent et parler de guerre ou de paix… La vieille ville a été rénovée et sa place principale ne s’appelle pas pour rien « Place de l’Europe » : le port accueille les ferries venus de Bourgas en Bulgarie, sur la côte opposée. Au centre de la place, une statue de Médée, construite en 2007, rend la toison d’or. Mais au-delà des symboles, le terminal de Batoumi écoule surtout vers l’Europe les volumes pétroliers de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan. Les ports de Poti et Kulevi complètent l’offre plus au nord, notamment pour les containers venus de Chine et les produits en vrac. Les trois terminaux sont gérés par des sociétés étrangères.
La ligne de crête comme politique
De retour à Tbilissi, la place de la Liberté rappelle les manifestations récentes contre le gouvernement. Celui-ci dispose pourtant d’une solide base populaire, mais sa ligne distante envers l’Union européenne lui attire la colère d’une frange de la jeunesse, qui associe encore Europe avec liberté et avenir. Le parti « Rêve géorgien » au pouvoir préfère quant à lui la ligne de crête, sans doute par crainte du puissant voisin, mais aussi par intérêt commercial. Outre l’axe nord-sud, la Géorgie représente aussi pour la Chine un point de passage sur la « ceinture du milieu », troisième voie des routes de la soie. L’Église locale encouragerait-elle la méfiance envers ce continent qui prêche des modes de vie peu orthodoxes ? La communication du gouvernement le laisse pour le moins entendre.
Un rapide regard sur la carte permet de bien comprendre la volonté de la Géorgie de ne pas choisir un camp contre les autres. Pays de transit, tampon entre les Empires, il se doit de continuer son chemin propre, se défendant des courants divergents qui traversent sa société. Entre présence militaire russe et influence occidentale, il souhaite continuer de vivre à son gré, fier de sa langue originale, de son histoire mouvementée et de l’attrait récent qu’il provoque chez les visiteurs venus de tous horizons.