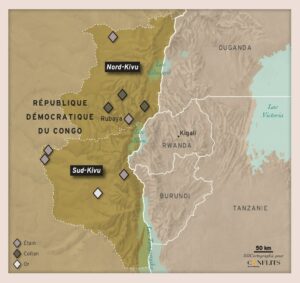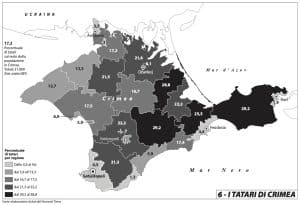De Philippidès à la guerre en Ukraine, la communication demeure au cœur du commandement militaire. Mais à l’ère numérique, la multiplication des capteurs, la guerre électronique et la cybermenace bouleversent ses fondements : comment commander efficacement lorsque chaque émission, chaque signal, devient une cible potentielle ?
« Nous sommes victorieux ! » s’écrie Philippidès en s’effondrant sur l’Acropole, annonçant la victoire de l’armée athénienne à Marathon. Déjà, dans l’Athènes du IVe siècle avant le Christ, la transmission rapide et fiable des messages conditionnait la capacité à commander les armées.
Cette nécessité de communication, indissociable de la conduite de la guerre, traverse les siècles sans perdre de sa pertinence. Elle constitue l’un des fondements intemporels de l’art du commandement.
L’histoire militaire regorge d’exemples qui illustrent cette permanence. Ainsi, Heinz Guderian, d’abord chef d’un centre de télégraphie sans fil pendant la Première Guerre mondiale, deviendra le père de la cavalerie blindée allemande. Il dotera ses chars d’un poste radio, offrant à chaque équipage la capacité de recevoir et transmettre des ordres en temps réel. Ce progrès technique fut l’un des piliers de la « blitzkrieg », la guerre éclair, qui permit à la Wehrmacht d’imposer un rythme opérationnel inédit au début du second conflit mondial. Plus près de nous, l’image de Barack Obama suivant en direct, depuis la salle de crise de la Maison-Blanche, l’opération d’élimination de Ben Laden, symbolise la version contemporaine de cette même logique : la supériorité dans la communication garantit la maîtrise du commandement. Depuis l’Antiquité, la capacité à transmettre l’information détermine celle de décider, de coordonner et, finalement, de vaincre.
A lire également : Le commandement militaire à la française, une doctrine en évolution
Aujourd’hui, l’invasion russe de l’Ukraine marque un nouveau changement de paradigme dans l’histoire du commandement militaire. Premier conflit d’envergure de l’ère numérique, il constitue le laboratoire grandeur nature d’une révolution silencieuse, mais profonde : la transformation des moyens de commandement, de l’organisation des postes de commandement (PC) et, in fine, du style de commandement lui-même.
Au début du XXIe siècle, les armées occidentales sortaient de deux décennies de guerres de contre-insurrection. Ces opérations, menées notamment en Afghanistan ou au Sahel, reposaient sur une surabondance de moyens de communication et d’outils numériques.
Chaque véhicule, voire chaque soldat, pouvait être géolocalisé en permanence grâce au GPS. Les PC étaient massifs, concentrant en un même lieu les moyens informatiques, logistiques et décisionnels, comme au camp de Gao durant l’opération Barkhane. Ce modèle, adapté à des opérations asymétriques contre des adversaires dépourvus de capacités d’interception et de frappe à longue distance, ne répond plus aux exigences de la guerre de haute intensité telle qu’elle se déploie aujourd’hui en Ukraine.
Les postes de commandement fixes, visibles, massifs et dotés de nombreuses antennes sont devenus des cibles faciles. L’ère des PC invulnérables, protégés et proches du front, appartient désormais au passé.
Trois évolutions majeures expliquent cette transformation radicale.

Volodymyr Zelensky visite le poste de commandement et d’observation du troisième bataillon de la brigade présidentielle séparée Hetman Bohdan Khmelnytskyi, le 26 juin 2023. Credit:Ukrainian Presidency/SIPA/2306291241
L’omniprésence des drones : la fin de l’invisibilité du champ de bataille
L’apparition des drones légers, portatifs et bon marché a bouleversé le rapport à l’espace et à la dissimulation. Outils de renseignement, d’observation, mais aussi de frappe, ils permettent à n’importe quelle unité d’obtenir une image instantanée et précise du champ de bataille sans risquer la vie d’un pilote.
Cette transparence nouvelle rend impossible l’installation de structures visibles. Les premiers mois du conflit en Ukraine ont montré combien les postes de commandement non camouflés et mal protégés, qu’ils soient russes ou ukrainiens, étaient vulnérables aux frappes d’artillerie.
L’art du camouflage et de la mobilité, que l’on croyait relégué aux échelons subalternes, redevient une compétence centrale des états-majors de brigade et de division.
A lire également : Micro-drones biomimétiques : l’extension du domaine de la guerre
Face à cette menace permanente, les armées redécouvrent des pratiques que la guerre de contre-insurrection avait fait oublier : dispersion des unités, changement fréquent de position, usage intensif du terrain, et réduction du volume visible des moyens de communication.
On assiste aussi à un glissement progressif vers l’installation des postes de commandement en milieu urbain, au cœur des villes ou des zones habitées. Ce choix, autrefois proscrit pour éviter les interférences radio, permet désormais de se fondre dans l’environnement civil et de brouiller les pistes visuelles et thermiques.
La guerre électronique : le champ de bataille électromagnétique
À cette transparence visuelle s’ajoute une transparence électromagnétique. La guerre électronique, discipline ancienne mais désormais amplifiée par la révolution numérique, s’impose comme une arme décisive.
La concentration des émissions électromagnétiques – radios, liaisons satellitaires, transmissions de données – signale immanquablement la présence d’un quartier général. Les armées russes comme ukrainiennes en ont fait l’expérience : la détection d’un volume anormal d’émissions suffit souvent à déclencher une frappe d’artillerie de précision.
À l’est du Dniepr, nombre de postes de commandement ont été anéantis en quelques minutes pour avoir trop communiqué.
Dès lors, la discrétion électromagnétique devient un impératif vital. Les états-majors adoptent des procédures de communication extrêmement brèves et codifiées. Les émissions sont limitées dans le temps, parfois dissimulées dans le flux du réseau téléphonique civil.
Certaines unités vont jusqu’à déployer de faux moyens de communication, laissés inactifs sur le terrain, afin de tromper les capteurs ennemis. La dispersion et la sobriété deviennent les maîtres mots.
Cette approche, bien qu’elle complique la coordination, accroît la résilience des structures de commandement en rendant leur détection plus difficile.
La cybermenace : un nouvel ennemi invisible
Enfin, la troisième grande évolution réside dans l’émergence de la cybermenace. Les réseaux informatiques militaires sont devenus des cibles de premier ordre. Leur neutralisation peut paralyser les chaînes logistiques, perturber les approvisionnements énergétiques ou désorganiser la coordination entre unités.
Le poste de commandement, véritable cœur numérique de la manœuvre, se trouve ainsi au centre de toutes les vulnérabilités.
Pour s’en prémunir, les armées ont développé plusieurs réponses. D’abord, la montée en puissance du « cyber-combat » : recrutement de spécialistes capables de défendre les réseaux nationaux ou d’attaquer ceux de l’adversaire, à l’image du régiment cyber de l’armée de terre.
A lire également : L’Union européenne face à la cybermenace
Ensuite, le cloisonnement des réseaux informatiques : chaque système est isolé, compartimenté, afin qu’une intrusion ne contamine pas l’ensemble. Ce principe, comparable à la compartimentation d’un navire pour éviter le naufrage après une voie d’eau, est redevenu central.
Il met toutefois fin à la fluidité d’échange qui caractérisait les guerres de contre-insurrection. Là où l’interconnexion généralisée avait entraîné une « obésité informatique », la dispersion des PC impose désormais la spécialisation : renseignement, logistique et opérations fonctionnent sur des réseaux distincts, avec des accès restreints.
Un nouveau style de commandement : de la supervision à l’intention
Ces bouleversements techniques et structurels ont une conséquence directe : la transformation du style de commandement.
Pendant les deux premières décennies du XXIe siècle, les états-majors pouvaient se permettre une coordination étroite, presque centralisée. Chaque officier disposait d’un accès large à l’ensemble des informations opérationnelles. Le chef d’état-major, installé dans un environnement stable et sécurisé, pouvait suivre en temps réel les décisions, vérifier leur application et imposer des procédures standardisées. Le contrôle, la vérification et la traçabilité dominaient la culture du commandement.
Ce modèle, hérité des guerres d’Afghanistan et d’Irak, est désormais caduc.
La dispersion géographique, la sobriété électromagnétique et le cloisonnement numérique obligent à repenser en profondeur la relation entre chef et subordonnés. Le commandement direct, continu et omniscient n’est plus possible.
À sa place émerge une approche fondée sur la confiance, l’autonomie et la responsabilité : le commandement par « l’intention ». Prôné par le général Schill, chef d’état-major de l’Armée de Terre, ce modèle repose sur un principe simple : le chef fixe un objectif clair, mais laisse à ses subordonnés la liberté d’en déterminer les moyens. Il donne le sens de l’action plutôt que la méthode.
Dans le contexte des guerres numériques, ce style de commandement s’impose par nécessité. Un poste de commandement mobile, discret et faiblement communicant ne peut fonctionner efficacement que si chaque échelon comprend parfaitement l’intention supérieure et agit avec initiative.
L’efficacité repose désormais sur la clarté de l’intention et la qualité de la formation des cadres, bien plus que sur la densité des transmissions. L’autonomie et le culte du résultat doivent être intégrés à chaque procédure, à chaque prise de décision.
Ainsi, la révolution numérique, loin de réduire le rôle de l’humain dans la guerre, en réaffirme paradoxalement la centralité.
À mesure que les moyens techniques se perfectionnent, c’est le jugement, l’initiative et la confiance qui redeviennent les véritables moteurs du commandement. Le champ de bataille de 2025 ne sera pas seulement un espace de drones, de signaux et de données, mais aussi – et surtout – un espace où le chef saura inspirer, orienter et déléguer avec discernement.
Le commandement du futur sera celui qui, tout en maîtrisant la technologie, saura en dépasser les limites pour redonner à la décision humaine toute sa valeur.
A lire également : L’innovation est au cœur de l’armée de terre. Entretien avec le général Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de terre