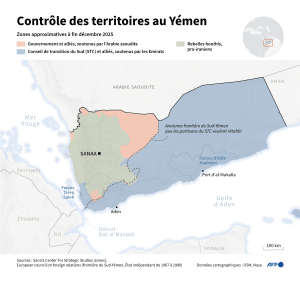À l’idée d’Occident il faut préférer le concept de romanité, plus à même de décrire la structuration du monde et l’influence d’une civilisation sur un espace.
Article paru dans le N58 de Conflits. Drogues. La France submergée.
Des funérailles de François à la messe d’intronisation de Léon XIV en passant par le conclave, plusieurs semaines durant, Rome fut, une nouvelle fois, le centre du monde. Dans un décor somptueux, qui mêle les rives du Tibre, les vestiges de l’Antiquité et les palais de la Renaissance, se sont déroulés ces moments clefs de la vie de l’Église qui donnent la définition de ce qu’est la romanité. La notion d’Occident est limitée, elle apporte plus de confusion que de clarté. L’Occident est trop lié à la guerre froide et à la logique des blocs, avec une idée de frontière imperméable. Alors que la notion de romanité est plus historique, plus culturelle et aussi plus souple. La romanité se rattache aux livres, à l’art, à la culture, au politique et à une certaine vision du monde. À l’origine, l’Occident est un espace, il s’agit du monde latin de l’Empire romain, l’Orient étant la partie grecque de Rome. L’Occident renvoie à la notion de « ouest », qui est aujourd’hui monopolisée par les États-Unis, quand « romanité » associe l’Orient et l’Occident dans un même espace culturel. Au Caire et à Tanger, nous ne sommes pas en Occident, mais il y a néanmoins des traces de la romanité, dans les vestiges romains et dans les strates historiques. Buenos Aires n’est pas tout à fait l’Occident, mais c’est néanmoins une ville romaine, du fait de son architecture et de sa culture.
Qu’est-ce que la romanité
La romanité part de l’Empire romain et englobe à la fois l’Orient et l’Occident, la partie grecque et la partie latine de Rome. Elle est d’abord un héritage, celle de la Grèce, mais aussi celle des philosophies orientales, qui ont profondément imbibé le monde romain. À ces fondements philosophiques et religieux, Rome apporte une structure juridique ainsi qu’une vision urbanistique. La romanité s’exprime autant dans les idées : le droit, la famille, la pensée de la guerre, que dans la vie quotidienne : l’organisation des villes, la gastronomie, les modes vestimentaires, l’art. La romanité est une pensée politique, un mode de vie sociale, une vision du monde présent et de la mort. Elle s’est poursuivie dans l’Église catholique, qui est l’héritière de Rome. Non seulement parce que son siège est situé dans la Ville éternelle, mais aussi parce que ses langues sont le latin et le grec, que sa liturgie prend ses racines dans l’histoire profonde des mondes helléniques et hébraïques, que les vêtements des prêtres, lors de la messe, sont des vêtements romains, issus de la toge et de la dalmatique.
La romanité est donc à l’origine la culture romaine, la manière d’être romain, exprimée dans un espace donné, celui de l’Empire romain. Avec la diffusion du christianisme et celle des Européens, la romanité se diffuse à son tour hors de son espace d’origine. La romanité n’est pas l’Occident, car son sens se comprend dans une définition moins politique et idéologique. La romanité touche aussi aux modes de vie, aux façons d’être, de penser le monde.
Critères de la romanité
On peut retenir plusieurs critères pour définir la romanité.
Le premier est celui de la sphère culturelle : la romanité se rattache à l’Empire romain, à son histoire et à sa mythologie. De là découle une philosophie, issue de la Grèce, de ses mythes et de ses histoires, mais aussi de la littérature romaine (comme Virgile). Cette sphère culturelle concerne tous les domaines de l’art : la littérature, la peinture, l’architecture, le cinéma, la photographie, etc. Elle est le substrat original.
Le deuxième critère est celui du droit. L’idée de fonder une société sur le droit, ce qui suppose le respect de la personne et sa défense par rapport au groupe. Le droit romain permet l’émergence de l’individu sur la tribu, la définition de la famille monogame et donc, avec le monde chrétien, l’égalité de nature entre l’homme et la femme.
Le troisième critère est celui des modes de vie. La romanité s’exprime notamment dans les repas, qui est le moment social et culturel par excellence. Autour de ces repas, le vin a toute sa place, lui qui est la boisson phare de Rome, jusqu’à devenir le sang du Christ dans la religion chrétienne. Jules César disait que la frontière entre la civilisation et la barbarie était celle du vin et de la bière, tant dans le monde romain le vin est associé à la civilité. Partout où il y a de la vigne, il y a la romanité. Les religions qui interdisent l’usage du vin, comme l’islam, et les régions où la vigne est absente, comme en Inde et en Chine, ont défini d’autres critères sociaux et normatifs pour leurs repas, qui sont là aussi des moments de convivialité, mais hors de l’espace mental de la romanité. Au vin s’ajoutent les céréales, notamment le blé, sous toutes ses formes, la place du théâtre et des loisirs dans la cité.
Le quatrième critère est celui de l’apport du christianisme comme héritier et perpétuateur de Rome. En se diffusant, le christianisme permet la diffusion de la romanité, à condition de modifier en profondeur les modes de vie et de pensée selon les autres critères de la romanité. En Afrique noire, par exemple, bien que la couche chrétienne soit présente depuis plus d’un siècle, ce n’est pas un espace de romanité.
Le cinquième critère est celui du rapport de la ville et de la campagne. Comme lieux de production, de commerce, d’échanges, villes et campagnes sont profondément imbriquées. La ville est le creuset de la civilité, de l’urbanité, c’est-à-dire de la manière d’être. La pensée romaine de la ville se retrouve aussi dans les mégapoles américaines et brésiliennes. La ville n’est pas uniquement un espace d’habitat, mais aussi une façon de penser l’homme, l’architecture étant une pensée anthropologique exprimée dans la pierre.
Le sixième critère est celui de la permanence mémorielle de la Méditerranée. La romanité s’exprime aujourd’hui bien loin de son espace méditerranéen d’origine, mais elle n’est pas qu’une pure idée détachée des lieux et de l’espace. Si elle s’étend au-delà de la Méditerranée, le mare nostrum demeure comme références culturelles et nostalgiques. Si les Anglais ont autant voulu contrôler Malte, l’Égypte et Suez, si l’Allemagne s’est entichée de contrôler Tanger, c’est aussi parce que ces deux pays septentrionaux voulaient se rattacher à l’espace méditerranéen. Pour les pays d’Amérique latine, la mémoire de la Méditerranée demeure dans les modes de vie (le vin, le blé) et dans le substrat culturel qu’elle apporte. Rome et la Grèce sont des visites obligées de la bourgeoisie d’Argentine et du Chili. D’une certaine façon, la romanité est une Méditerranée étendue.
Rome et ses ennemis
Au sein même de l’Occident, la romanité a eu ses ennemis. Quand le chancelier Bismarck lance son Kulturkampf, son combat pour la culture, le but recherché est l’éradication du catholicisme parce que trop lié à la romanité. Pour le chancelier allemand, la romanité s’oppose à l’unité de l’Allemagne et surtout s’oppose à l’essence même de ce qu’est la culture allemande. Le mouvement völkisch, en cherchant à retrouver, c’est-à-dire à fabriquer, selon ses concepts, les racines païennes des peuples du nord, est un mouvement occidentaliste qui rejette la modernité. Le summum du combat entre romantisme völkisch et romanité eut lieu durant la Seconde Guerre mondiale, jusque dans le choix des symboles. En prenant comme attribut la croix gammée, les nazis ont voulu prioriser leurs racines aryennes, pensée qui s’oppose viscéralement à la romanité. À l’inverse, quand l’amiral Thierry d’Argenlieu, prêtre carme, choisit la croix de Lorraine comme symbole de la France libre, c’est pour opposer la croix romaine à la croix aryenne, témoignant par ce symbole que ce conflit est autant une guerre de nations qu’une guerre de civilisation. C’est finalement la romanité qui triompha, grâce à l’engagement de l’Amérique, avant que le concept ne soit absorbé par la notion d’Occident.
À Hong Kong et à Singapour, à Santiago du Chili et dans les villages d’Europe, partout où se trouvent des héritages de Rome se trouve des parcelles de romanité. Un concept qui dit davantage ce qu’est l’Europe dans son essence, d’où vient notre civilisation et ce qui la distingue des autres cultures. Une façon, aussi, de démontrer que Rome n’a pas disparu avec la chute politique de l’empire.