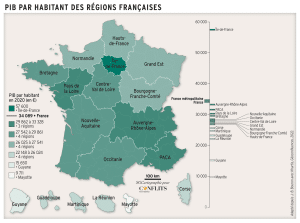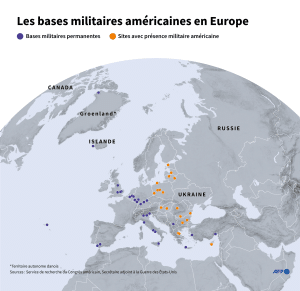L’Espagne est toujours là, malgré la guerre civile, les fluctuations politiques (république, dictature, monarchie), les forces centrifuges régionalistes. Toujours là et, dans bien des domaines, novatrice. Madrid est en plein essor, sa culture s’exporte et sert sa puissance, le terrorisme basque n’agit plus, les sécessionnistes catalans n’ont pas eu gain de cause. Derrière les fractures ibériques, il y a des leçons espagnoles, dont le cœur est la réflexion sur la nation.
Article paru dans le numéro 48 de novembre 2023 – Espagne. Fractures politiques, guerre des mémoires, renouveau de la puissance.
Bâtir une nation. Pour un pays, la guerre civile est le conflit le plus ardu à résorber tant celui-ci déchire le corps social même après la mort des principaux acteurs. La déflagration causée par cette grande fragmentation de la nation se répercute dans les mémoires et dans les lectures de l’histoire, activant et renforçant les clivages politiques. Face à l’histoire, la mémoire, l’oubli, l’amnistie sont quelques-uns des leviers à actionner pour ceux qui veulent bâtir la paix et retisser le corps social en ruine. Si une nation ne peut exister durablement sur le mensonge historique, elle ne peut pas non plus avoir d’avenir quand le ressentiment mémoriel est sans cesse activé. Si l’Espagne est un pays composé de plusieurs régions, unies par une culture et par un roi, elle est sans cesse confrontée au défi de maintenir son unité et de ne pas céder aux forces qui rêvent au démembrement. L’Espagne est, en Europe, l’un des laboratoires d’une nation en construction et en légitimation perpétuelle. Avoir une langue, une foi, une histoire, une culture commune ne suffit pas. Il faut aussi une volonté, qui échappe aux nombreux indépendantistes dont la volonté suprême est de se défaire d’un corps politique qu’ils jugent oppressif. Le combat pour la nation se joue donc en premier dans l’instruction et la transmission d’une histoire commune qui permet de vibrer aux noms des mêmes héros et de tressaillir à l’évocation des mêmes lieux : Cervantès, Charles Quint, le siècle d’or ; l’Escorial, l’Alhambra, la Plaza de Toros à Séville.
Accepter les mémoires. Que la mémoire soit multiple et plurielle est normal et correspond au sain développement intellectuel d’un pays. Il est logique que différentes approches et interprétations cohabitent et se confrontent. En revanche, quand la mémoire devient objet politique et instrumentalisation des passions communes à des fins électoralistes, la menace de la partition n’est jamais loin. C’est ce que vit l’Espagne depuis quelques années, au niveau national par l’enrôlement de la dépouille de Franco pour livrer des combats contemporains, au niveau régional par la réécriture de l’histoire par les indépendantistes, qui tiennent à faire coïncider discours politiques et histoire officielle. Quand les forces politiques n’ont plus en vue l’unité et sont prêtes à jouer la déchirure pour conserver leurs sièges et leurs postes, la menace de rupture pèse sur un pays. La guerre des mémoires veut empêcher l’écoute, le débat, le pluralisme pour imposer une vision unique et s’emparer de la domination des esprits. Vu de France, le regard peut être embrumé par sa tradition jacobine, les débats sur l’indépendance des régions paraissent vains. Que pourrait peser un Pays basque ou une Catalogne indépendante dans le grand jeu mondial ? Ces débats semblent aussi d’un autre temps, comme congelés dans les tensions du siècle précédent, à l’heure où l’Espagne, comme le reste de l’Europe, est confrontée à une immigration massive et au risque de déclassement de l’Europe face à la Chine et à l’Asie.
A lire également
Géopolitique d’une Espagne à cheval sur plusieurs mondes
Oser l’union. Si la nation implique « un vivre ensemble », elle suppose aussi un « vouloir mourir pour ». Mourir pour défendre un pays, une culture, sa famille, une conception de la civilisation. Le sacrifice de sa vie ne peut se faire que pour un bien plus grand. Quand les calculs électoraux immédiats l’emportent sur le projet politique au long court, c’est bien ce corps social qui est dissous. Les fractures espagnoles ne se limitent pas à la péninsule ibérique, elles sont aussi un défi pour les autres pays d’Europe. L’Espagne réunissait toutes les conditions pour éclater et disparaître, elle est pourtant toujours là. Preuve, une fois de plus, que l’histoire n’est jamais écrite d’avance et que le pire n’est pas toujours ce qui advient. Cette défaite du déterminisme est une autre leçon espagnole qui montre bien le rôle des hommes dans la conduite de l’histoire.