L’ONU ne sera jamais un gouvernement mondial. Elle est un forum où discutent les gouvernements. Et aussi un plan de carrière pour les militaires de pays pauvres et les fonctionnaires internationaux.
Un article à retrouver dans le N61. Outre-mer : La France des 13 fuseaux horaires.
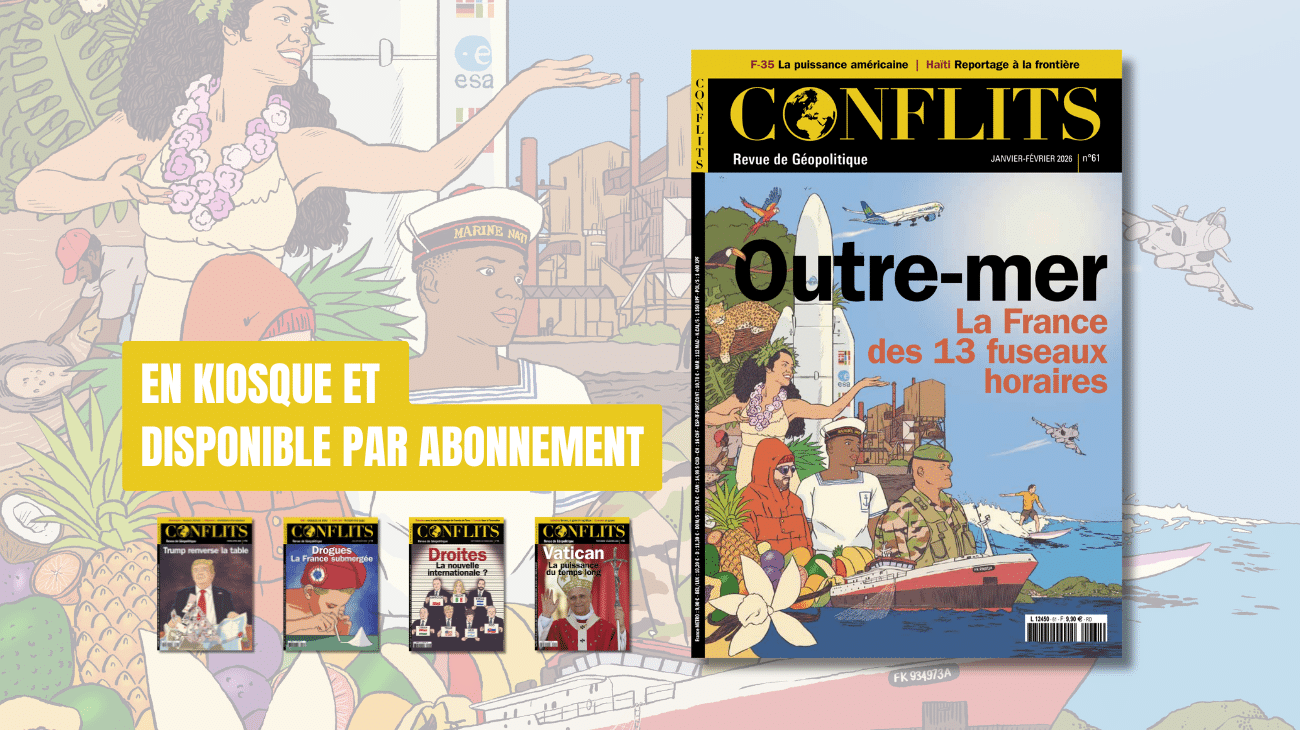
En 1945, dans le champ de ruines laissé par la Seconde Guerre mondiale, l’Organisation des Nations unies fut conçue comme la promesse d’un monde nouveau. Malgré l’expérience décevante de la Société des Nations qui l’avait précédée, ses fondateurs croyaient toujours possible de conjurer le spectre de la guerre totale en dotant la communauté internationale d’un cadre institutionnel où le droit, la coopération et le dialogue primeraient sur la force. De San Francisco à Lake Success, l’ONU incarna très tôt l’espérance d’une gouvernance universelle, capable de surmonter les rivalités nationales pour instaurer une paix durable.
Un forum qui perdure
Pourtant, après huit décennies, une vérité structurelle, la même qui avait fait échouer son prédécesseur, reste toujours de mise : l’ONU est un forum et non un gouvernement. Le Conseil de sécurité, conçu comme l’organe exécutif chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales, est régulièrement paralysé par le droit de veto que détiennent ses cinq membres permanents. Cette règle, pensée en 1945 pour garantir la participation des grandes puissances à la nouvelle organisation, est devenue une entrave majeure à son efficacité. Croire qu’une réforme du Conseil de sécurité pourrait remédier à cette impuissance structurelle relève de l’illusion. Car en quoi l’élargissement du cercle des membres permanents à l’Inde, au Brésil ou à l’Allemagne modifierait-il la réalité fondamentale, c’est-à-dire la possibilité pour chacun d’entre eux d’apposer un veto bloquant ?
Échec des missions militaires
Les opérations de maintien de la paix, autre bras armé supposé de l’organisation, souffrent des mêmes contradictions. Dépendantes du bon vouloir des États contributeurs, aux mandats souvent restrictifs et aux moyens limités, elles se révèlent incapables d’agir face à des acteurs déterminés et bien organisés. Le Rwanda en 1994 reste le symbole d’une mission déployée trop tard, trop faiblement dotée et paralysée par des instructions ambiguës. La Finul, installée au Sud-Liban depuis 1978, illustre l’impuissance face à la détermination du Hezbollah, qui n’a pas hésité à s’en prendre aux Casques bleus pour leur signifier les limites de leur action. Derrière ces missions se trouvent souvent des militaires venus de loin, parfois davantage motivés par la solde que par l’engagement.
Ainsi, les contingents envoyés par le Népal, pilier du maintien de la paix onusien depuis la fin des années 1950, illustrent ce paradoxe. Son armée fournit régulièrement troupes et observateurs, au point que le pays figure dans le top 5 mondial des contributeurs aux côtés du Rwanda, du Bangladesh, de l’Inde et de l’Indonésie. En 2023, plus de 5 600 Casques bleus népalais étaient déployés dans une douzaine de pays, du Liban au Soudan du Sud, en passant par la RDC, le Mali et la Centrafrique.
Le contraste entre la solde d’un soldat népalais au pays et celle qu’il perçoit sous l’égide des Nations unies illustre l’attrait et l’ambiguïté de ces missions. Alors qu’au Népal le salaire militaire se limite à quelques centaines de dollars, l’allocation onusienne atteint en moyenne 1 000 à 1 200 dollars par mois, soit deux à trois fois le revenu national. Cette différence transforme la participation aux missions en opportunité économique majeure, parfois plus recherchée que le service au pays. Elle souligne aussi une dépendance structurelle, car envoyer des soldats au Liban, en Afrique ou ailleurs sous mandat de l’ONU ne relève pas seulement de la diplomatie mais constitue pour le Népal une source de prestige, de devises et d’incitations sociales dépassant la stricte vocation militaire. Cela pose la question du degré d’engagement réel des soldats, contraints de risquer leur vie dans des contextes dangereux, alors qu’une motivation essentielle reste l’amélioration rapide de leur situation économique.
Derrière ces limites se cache une évidence. L’ONU n’a pas d’armée propre, pas de police internationale, pas de fisc mondial. Elle dépend des contributions financières, logistiques et militaires des États, c’est-à-dire précisément de ceux qu’elle est censée encadrer. Chaque décision collective est conditionnée par la volonté et les calculs des grandes puissances. L’ONU peut émettre des normes, mais elle ne peut pas les faire respecter. Elle peut voter des résolutions, mais leur mise en œuvre dépend toujours des États.
Échec du gouvernement mondial
Cette contradiction est au cœur de son fonctionnement. L’ONU incarne l’idéal d’une communauté politique mondiale, mais sans les attributs d’un État souverain. Elle demeure un théâtre diplomatique important et utile, mais non une autorité capable de contraindre. Ses votes massifs à l’Assemblée générale sont déclaratifs, ses condamnations symboliques, ses résolutions appliquées à géométrie variable. Aller plus loin supposerait un scénario utopique, l’avènement d’un gouvernement mondial, qui paraît aujourd’hui non seulement impossible mais de plus en plus impensable. L’ONU est donc condamné à souffrir du hiatus entre la promesse d’un ordre international pacifié, et la réalité d’une posture symbolique, impuissante ou instrumentalisée par les rapports de force.

© Abdul Kader Al Bay/ZUMA Press Wire) SIPA
En définitive, l’ONU n’est pas et ne sera jamais le gouvernement mondial rêvé par certains en 1945. Elle ne peut prétendre au monopole universel de la violence légitime, ni à une capacité d’imposer la loi commune. Mais elle reste un médiateur institutionnel et un outil diplomatique essentiel dans un monde d’États souverains. Elle est aussi un lieu où se jouent des logiques de carrière et des trajectoires professionnelles. Et malgré les frustrations, contradictions et critiques, l’ONU est un employeur prestigieux et très recherché, la clé des carrières dont rêvent de nombreux jeunes ambitieux et talentueux à travers le monde.
Le cœur diplomatique de l’ONU ne se limite pas à New York, où plus de 10 000 diplomates, experts et personnels administratifs œuvrent au sein des 193 délégations permanentes. S’y ajoutent les missions établies à Genève, Vienne et Nairobi. À ce réseau s’adosse l’appareil administratif onusien, qui compte environ 37 000 employés. Si l’on élargit la focale à l’ensemble du système, en incluant agences spécialisées et missions de terrain, le total dépasse 130 000 personnes déployées sur tous les continents.
“Même si nous ne disposons pas d’un état mondial, nous avons déjà se fonction publique”
Les 37 000 employés du secrétariat et des agences centrales se répartissent entre environ 26 000 fonctionnaires internationaux, classés dans les grilles P et D, et 11 000 personnels dits « services généraux », recrutés localement. Les premiers perçoivent des rémunérations allant de 70 000 dollars annuels pour un jeune professionnel à près de 180 000 dollars pour un directeur, tandis que les seconds bénéficient de salaires supérieurs à la moyenne locale, comme à Genève où un assistant peut toucher près de 70 000 francs suisses par an. Ces traitements sont nets d’impôt, car les fonctionnaires de l’ONU ne paient pas de taxes nationales sur leurs salaires. À ce privilège s’ajoutent des allocations de logement, de scolarité et des primes de zone difficile.
Au-delà du secrétariat, plus de 90 000 personnes servent dans les missions de terrain, soit environ 70 000 militaires, 7 000 policiers et 13 000 personnels civils, qui assurent logistique, administration et appui technique. Là encore, les rémunérations reflètent la hiérarchie des statuts : les soldats et policiers touchent une solde nationale complétée par une indemnité forfaitaire de l’ONU, ce qui en fait une ressource économique majeure pour les pays contributeurs du Sud. Le système est aussi un vaste champ sociologique, où se développent carrières et trajectoires, avec des stages prestigieux et des expériences décisives pour les parcours professionnels.
Collusions et ententes internes
Depuis quelques décennies, le monde humanitaire et celui des Nations unies forment ainsi un continuum professionnel qui dépasse les appartenances institutionnelles. Les personnes y circulent selon une logique de carrière, en suivant un circuit transnational de l’expertise et du réseau. Les jeunes professionnels entrent souvent par les agences comme l’Unicef, le HCR, le PNUD ou le PAM, recrutés comme junior professional officers ou comme experts thématiques. Ils acquièrent une expérience, se constituent un capital relationnel dans les réseaux diplomatiques et interinstitutionnels, puis deviennent attractifs pour les grandes ONG internationales comme Oxfam, Amnesty, Save the Children, CARE ou le Norwegian Refugee Council. Ces organisations recherchent à la fois la technicité et la connaissance du système onusien avec lequel elles travaillent en permanence.
Une troisième étape conduit nombre de ces experts vers les grandes fondations philanthropiques, telles l’Open Society de George Soros, la Fondation Gates, la Fondation Rockefeller ou la Fondation Ford. Ces institutions, qui financent massivement des programmes humanitaires, éducatifs ou sanitaires, recrutent volontiers d’anciens cadres de l’ONU et des ONG. Elles y trouvent un double avantage : bénéficier de leur expérience institutionnelle et asseoir leur légitimité internationale. Pour les intéressés, ce passage offre plus de ressources, davantage de liberté stratégique et une position centrale dans la définition des priorités globales.
Ces trajectoires illustrent l’entre-soi d’une élite humanitaire globale, partageant un langage commun, des expériences similaires et des ambitions convergentes. L’ONU n’est donc pas seulement une bureaucratie internationale, elle constitue aussi le sas d’entrée d’un marché de carrières mondialisées, au profit d’une élite transnationale. Ainsi, même si nous ne disposons pas d’un État mondial, nous avons déjà sa fonction publique.








