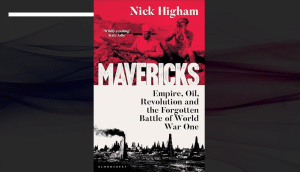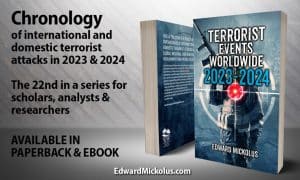Lord Charles Moore est l’auteur de la biographie autorisée de Margaret Thatcher, publiée en trois tomes, de 2003 à 2019. Ancien rédacteur en chef du Daily Telegraph et du Spectator, où il tient toujours des chroniques, il est un fin connaisseur des évolutions du Parti conservateur depuis les années 1970.
Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?
Par Maximilien Nagy, envoyé spécial à Londres
À quel point Margaret Thatcher a-t-elle réussi comme leader du Parti conservateur et Premier ministre britannique ?
Margaret Thatcher a remporté plusieurs succès durant ses années au pouvoir. Et son bilan mérite d’être reconnu, que l’on soit d’accord ou non avec ce qu’elle a fait.
Son premier succès fut de nature politique, avec trois victoires aux élections législatives auxquelles elle s’est présentée comme chef du Parti conservateur, en 1979, 1984 et 1988. Ses onze ans de pouvoir de 1979 à 1990 en ont fait le Premier ministre avec la plus grande longévité depuis le début du xixe siècle.
Ensuite, Mme Thatcher avait une idée claire de ce qu’elle voulait faire sur le plan économique et politique, et elle l’a largement accompli. Enfin, elle a contribué à gagner la guerre froide, ce qui représente une victoire diplomatique inédite.
Mais la plus grande force de la Dame de fer a été d’élaborer une doctrine, le thatchérisme. Il s’agit d’une doctrine marquée par un patriotisme fort, une fierté et une foi profonde dans la valeur de la culture et de l’histoire britannique et le rejet de la repentance coloniale.
Les principes qu’elle a portés pendant ses mandats se sont déclinés dans trois domaines : une défense forte, des marchés plus libres et donc, plus d’opportunités pour tous, en particulier pour les plus modestes.
Y avait-il aussi un thatchérisme diplomatique ?
Margaret Thatcher, fidèle patriote, pensait que les peuples anglophones, comme Churchill les appelait, avaient une mission principale à accomplir : défaire le soviétisme.
À la différence de la plupart de ses prédécesseurs, et à l’exception de Churchill, Maggie s’intéressait réellement à l’avenir des peuples soumis au joug soviétique. Là où ses prédécesseurs se limitaient à la diplomatie de haut niveau avec les Soviétiques, elle s’adressait directement aux populations de Pologne, de Hongrie et d’Union soviétique pour leur promettre la liberté. Ronald Reagan et elle ont mené le combat contre l’Union soviétique avec beaucoup d’efficacité.
La relation entre Maggie et Gorbatchev a contribué à faciliter le dialogue entre l’Union soviétique et l’Ouest. Qu’est-ce qui caractérisait la relation des deux dirigeants ?
Il faut d’abord se rappeler que Gorbatchev n’était pas un dirigeant soviétique comme les autres. Alors que ses prédécesseurs s’exprimaient de façon rigide et lisaient des déclarations préparées à l’avance, il aimait discuter et débattre. Et c’est aussi ce que préférait Mme Thatcher. D’ailleurs, son style incisif n’a pas facilité les choses à Gorbatchev. Durant l’un de leurs entretiens, elle lui dit : « Nous savons que vous subventionnez secrètement la grève des mineurs. » Gorbatchev, gêné, l’a nié, bien que ce fût vrai.
Une autre caractéristique de la personnalité de Mme Thatcher est qu’elle appréciait les hommes bien habillés, intelligents et élancés. Elle disait par exemple de Gorbatchev qu’il avait de « jolis yeux brillants ». Elle aimait Reagan pour son côté acteur de charme et ses costumes bien coupés, et Mitterrand pour ses qualités de séducteur. En revanche, Maggie n’aimait pas Helmut Kohl, qu’elle trouvait très corpulent et un peu pompeux. Les apparences comptaient beaucoup dans ses relations diplomatiques, peut-être même trop.
L’attitude de Thatcher à l’égard de Kohl était-elle marquée aussi par leurs divergences sur la réunification allemande ?
Absolument. Mme Thatcher fut une opposante farouche à la réunification de l’Allemagne pour deux raisons très liées : la crainte du retour d’une Allemagne forte et surtout d’une Union européenne trop puissante et allemande. Kohl disait toujours que « nous devons avoir une Europe allemande pour éviter d’avoir une Allemagne européenne ». Margaret Thatcher rétorquait alors qu’il s’agissait de deux concepts identiques, ce qui déplaisait à Kohl. Mais Thatcher a bien anticipé la situation actuelle de l’UE, qui reste largement dominée par l’Allemagne.
Un jour, elle m’a pris à part durant une réception. Je pensais d’abord qu’elle voulait me confier un secret. Ensuite, elle m’a demandé : « Vous savez ce qui ne va pas avec Kohl ? » Je lui répondis « non ». Elle me dit en retour : « Il est allemand ! » Cette anecdote résume bien sa vision de l’Allemagne, encore très marquée par la Seconde Guerre mondiale.
Avait-elle envisagé la question d’un retrait de l’Union européenne ?
Mme Thatcher a évolué sur la question de l’UE durant sa carrière politique. Au référendum de 1975, l’année de son élection à la tête du Parti conservateur, elle a soutenu le maintien du Royaume-Uni dans l’UE. Elle voyait avant tout les intérêts économiques de l’institution, en particulier le marché commun. Il s’agissait aussi pour elle d’un rempart contre le communisme, notamment en Espagne et au Portugal dans les années 1960, qui sortaient respectivement de l’ère de Franco et de Salazar.
En revanche, Mme Thatcher a toujours rejeté l’idée d’États-Unis d’Europe. Par exemple, elle s’est opposée au mécanisme de taux de change européen, prélude de la monnaie unique, si chère à Jacques Delors. Son opposition à l’intégration s’est accentuée durant ses années au pouvoir. Et en 1990, l’année de son départ, elle était convaincue qu’une sortie de l’UE était nécessaire. Mais elle a évité d’exprimer cette opinion en public, de peur de diviser son parti.
En revanche, elle a introduit la notion de référendum sur la monnaie unique. Cette seule démarche a poussé David Cameron à proposer le référendum de 2016 sur le Brexit.
Revenons à la politique intérieure. En quoi Mme Thatcher a-t-elle bouleversé le Parti conservateur de son temps ?
Son style et son discours tranchaient nettement avec celui des conservateurs traditionnels, posé, raisonnable, souvent consensuel. Le thatchérisme avait une caractéristique évangélique. Maggie savait expliquer ses politiques aux électeurs, avec un sens pratique hors du commun.
Jamais Mme Thatcher ne serait devenue chef du Parti conservateur, encore moins Premier ministre, dans une période de stabilité. Le parti aurait alors choisi un homme politique conventionnel. Mais elle a finalement émergé en 1974, après les deux défaites électorales des tories. Ses quatre années dans le gouvernement d’Edward Heath de 1974 à 1978 lui ont montré l’incapacité de son gouvernement à régler l’excès de contrôle étatique, l’hyperinflation et les pouvoirs des syndicats. On parlait à l’époque de la « maladie britannique », caractérisée par la récession économique et les conflits sociaux. À l’inverse, Mme Thatcher proposait un État fort, respecté, mais limité sur le plan économique.
Quel fut le degré d’influence de Friedrich Hayek et Milton Friedman sur la pensée et la politique de Thatcher ?
Mme Thatcher admirait Hayek, qu’elle connaissait personnellement, ainsi que Milton Friedman. Dans ses mémoires, elle explique avoir lu La Route de la servitude de Hayek à Oxford. Cela est peu probable, parce qu’à cette époque, elle s’intéressait davantage aux questions pratiques que théoriques. Mais elle croyait fermement que le contrôle de l’État conduisait à la servitude, comme Hayek l’a écrit. Thatcher avait aussi lu La Constitution de la liberté, qu’elle a un jour jetée sur la table pendant une réunion au Centre for Policy Studies, un think tank créé à son initiative, en disant : « C’est en cela que nous croyons ! »
Il existait toutefois une divergence entre Hayek et Friedman sur la vitesse d’ajustement monétaire. Friedman préconisait la progressivité ; Hayek, le choc frontal. Thatcher penchait pour Friedman. Dans les faits, elle appliqua plutôt la méthode Hayek, à cause du contexte économique d’hyperinflation et du niveau des taux d’intérêt, et ce fut un succès.
Que peut-on retenir de l’ère Thatcher dans le contexte actuel ?
Avant tout, le courage des convictions et de faire les bons diagnostics des problèmes du pays. Si les conservateurs veulent remporter la prochaine élection, ils doivent prendre le temps d’analyser les problèmes du pays et de l’Occident, avant de chercher une stratégie pour remporter la prochaine élection.