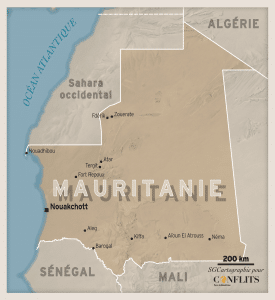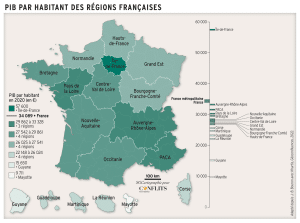L’Ouzbékistan a modifié sa loi sur les ONG. Le but ? Limiter les contrôles et faciliter les interventions humanitaires.
Par Eldor Tulyakov, directeur exécutif du Centre pour la stratégie de développement à Tachkent
La société civile, souvent considérée comme le pilier de la démocratie, a longtemps été confrontée à la méfiance, aux obstacles bureaucratiques et aux pressions politiques dans de nombreux États post-soviétiques. L’Ouzbékistan, qui ne faisait autrefois pas exception, a désormais pris une mesure décisive dans la direction opposée. La nouvelle loi radicale n’est pas destinée à restreindre les ONG, mais à les protéger, à les autonomiser et à les intégrer dans le cadre de gouvernance du pays, ouvrant ainsi la voie à une société civile plus solide.
Contrôle de l’État
Pendant des années, la législation ouzbèke a formellement interdit l’ingérence de l’État dans les activités des ONG. Mais il y avait un hic : cette interdiction n’avait pas de poids. La nouvelle loi change la donne en introduisant une responsabilité administrative pour les fonctionnaires qui entravent ou interfèrent illégalement dans le travail des ONG. Les contrevenants s’exposent désormais à des amendes pouvant atteindre quinze fois le taux de base, avec des sanctions encore plus sévères en cas de récidive.
Il s’agit d’un changement important. Dans une grande partie de la région, la charge de la conformité repose toujours entièrement sur les ONG. Dans le même temps, les fonctionnaires ne subissent aucune conséquence en cas d’abus. En revanche, l’Ouzbékistan crée un précédent : l’État lui-même est tenu de rendre des comptes lorsqu’il porte atteinte à la société civile.
Tout aussi important, la loi renforce le contrôle public. Les agences étatiques doivent désormais examiner et répondre aux rapports et recommandations produits par les ONG dans un délai d’un mois. Le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions administratives. Cette disposition élève le contrôle de la société civile du statut d’exercice symbolique à celui d’obligation légale, rapprochant l’Ouzbékistan des modèles de gouvernance participative observés en Europe.
Les réformes apaisent également les frustrations de longue date des ONG elles-mêmes. Les sanctions pour les infractions administratives mineures, telles que les retards dans la présentation des rapports, le défaut de notification des événements aux autorités ou l’utilisation de symboles non enregistrés, ont été considérablement réduites. Ce passage de la menace de la survie d’une organisation au traitement proportionné et équitable des infractions apporte un sentiment de soulagement à la communauté des ONG.
Transparence renforcée
Dans le même temps, la transparence est renforcée. Les ONG sont tenues de divulguer publiquement la manière dont elles utilisent leurs fonds et leurs biens, que ce soit sur leurs sites web officiels, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Cette mesure reflète les meilleures pratiques internationales, selon lesquelles la divulgation renforce à la fois la confiance des donateurs et celle du public.
Le message est clair : les ONG ne sont pas des adversaires à surveiller et à contrôler, mais des partenaires de la gouvernance qui doivent être à la fois libres et responsables.
Au-delà de l’allègement administratif, la loi comble les lacunes des cadres fiscaux et réglementaires. Le code fiscal oblige désormais les personnes morales et physiques à déclarer les fonds provenant de l’étranger à des fins sociopolitiques, une disposition visant à renforcer la transparence financière et à garantir la conformité avec les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, rassurant ainsi les partenaires internationaux quant à l’engagement de l’Ouzbékistan en faveur de la gouvernance mondiale.
Par ailleurs, la loi sur les droits d’État a été clarifiée afin de couvrir le réenregistrement des ONG et de leurs succursales, éliminant ainsi les ambiguïtés qui compliquaient auparavant leur statut juridique.
Un environnement plus serein
Ces améliorations peuvent sembler techniques, mais elles contribuent à créer un environnement plus prévisible pour la société civile, ce qui est particulièrement important pour les ONG internationales et les bailleurs de fonds.
La nouvelle loi reflète une transformation plus large en cours en Ouzbékistan depuis 2016 : le passage d’un modèle descendant, centré sur l’État, à un système plus inclusif où les citoyens et les groupes civiques partagent la responsabilité du développement national.
Pour les acteurs nationaux, cela signifie davantage d’espace pour défendre leurs intérêts, innover et demander des comptes au gouvernement. Pour les partenaires internationaux, notamment l’Union européenne, qui a fait de l’engagement de la société civile un pilier de ses relations avec l’Asie centrale, cette loi témoigne de la volonté de l’Ouzbékistan de se conformer aux normes mondiales en matière de gouvernance et de se présenter comme un partenaire crédible et réformateur. La loi offre également des avantages potentiels aux ONG internationales et aux bailleurs de fonds, en leur fournissant un environnement opérationnel plus prévisible et plus transparent et en renforçant leurs partenariats avec les acteurs locaux.
En comparaison, de nombreux pays d’Eurasie vont dans la direction opposée, en renforçant les restrictions imposées aux ONG, en particulier celles qui ont des liens internationaux. L’approche de l’Ouzbékistan se distingue donc : elle reconnaît qu’une société civile résiliente n’est pas une menace pour la stabilité, mais plutôt une garantie de celle-ci.
Bien sûr, aucune loi n’est une panacée. Sa mise en œuvre sera le véritable test. Il faudra rester vigilant pour garantir que les sanctions à l’encontre des fonctionnaires soient appliquées de manière équitable, que les divulgations des ONG soient proportionnées et accessibles, et que la voix de la société civile soit réellement entendue. Il peut être difficile de garantir l’application cohérente des sanctions, de veiller à ce que les divulgations des ONG ne soient pas trop contraignantes et de créer des mécanismes permettant une participation significative de la société civile. Cependant, ces défis ne doivent pas occulter les progrès significatifs que représente cette loi.