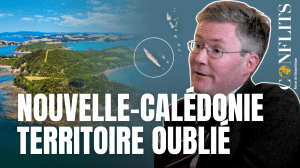Intervenue à Mayotte lors des inondations qui ont frappé l’île début février, l’association du Bouclier Bleu France se distingue des autres organisations dédiées à la protection du patrimoine par ses actions de prévention et ses opérations d’urgence visant à préserver le patrimoine en période de conflits ou de catastrophes naturelles.
Entretien avec Marie Courselaud, présidente de l’association Bouclier Bleu France
Article paru dans le N57 : Ukraine Le monde d’après
Pouvez-vous nous parler des origines de l’associmation ? Quand et pourquoi a-t-elle été fondée ?
L’association dépend du Blue Shield international, créé en 1996 à la suite du conflit en ex-Yougoslavie par les grandes organisations professionnelles du patrimoine : le Conseil international des musées (ICOM), le Conseil international des monuments et des sites (Icomos), le Conseil international des archives (ICA), et la Fédération internationale des associations et institutions des bibliothèques (IFLA). Ces organisations ont décidé de créer un organe international pour la protection du patrimoine en temps de guerre. Le Blue Shield international est considéré comme une instance consultative auprès de l’Unesco. À la suite de la création de ce bureau, des comités nationaux ont vu le jour un peu partout dans le monde. Celui du comité français a été créé en 2001. Il s’appelait initialement le Comité français du Bouclier Bleu et aujourd’hui Bouclier Bleu France.
Les premières missions étaient des missions de sensibilisation à la protection du patrimoine avec pour fer de lance la promotion de la convention de La Haye de 1954. L’origine tire donc ses racines de la protection du patrimoine en temps de guerre, mais avec une adaptation au contexte territorial. Le travail du Bouclier Bleu France est concentré principalement sur les risques naturels d’origine naturelle et anthropique, toujours avec un lien mais beaucoup moins fort qu’initialement, sur la question des conflits. Toutefois, ce lien se renforce aujourd’hui, et ce depuis 2022 et la guerre en Ukraine, avec un rapprochement de la Delpat (Délégation au patrimoine de l’armée de terre).
Aujourd’hui, le Bouclier Bleu France compte 500 membres de divers horizons, et 11 sections locales, installées dans toutes les régions de France, exceptées la Normandie et la Corse.
Pourquoi l’association porte-t-elle un tel nom et a-t-elle un tel emblème ?
La convention de La Haye de 1954 décrit un emblème, le bouclier bleu, qui a vocation à protéger les sites d’attaques ennemies, sites qui bénéficient d’une protection spéciale au titre de cette convention. Le bouclier bleu est à l’origine un écusson bleu et blanc, apposé sur des monuments pour éviter qu’ils soient détruits ou endommagés lors des conflits. C’est l’emblème international de la protection du patrimoine.
Qu’est-ce que le patrimoine ?
Le patrimoine désigne l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir.
Au Bouclier Bleu, nous agissons sur tout le patrimoine, culturel, naturel, immatériel. Notre action se fonde sur le patrimoine public, déjà en partie protégé, mais aussi sur le patrimoine non protégé et le patrimoine privé.
Sur quels terrains exercez-vous ? Et comment hiérarchiser les priorités ?
Les priorités se font par vulnérabilité. Aujourd’hui, le patrimoine le plus vulnérable est le patrimoine culturel, matériel, qui est l’objet de vols, de pillages. La vulnérabilité est également liée à l’implantation géographique qui peut être soumise à des incendies, des inondations, des tremblements de terre, des glissements de terrain.
Le patrimoine immatériel aujourd’hui n’est pas une priorité. Mais nous ne faisons pas de différences entre le public et le privé.
Quelles sont vos méthodes et comment agissez-vous pour mener à bien ces projets ?
Il y a d’abord un travail de sensibilisation fait auprès du grand public, des élus, des institutions publiques, sur la nécessité de prévenir les risques et de faire de la planification. Nous faisons de la formation à l’accompagnement en plans de sauvegarde, l’outil qui permet de gérer la crise. Nous avons constitué une réserve opérationnelle et formé des spécialistes : des conservateurs, des restaurateurs, des pompiers, des personnes du domaine de l’armée. Ils ont la capacité d’intervenir, soit à la demande des pompiers après un incendie ou une inondation, soit à la demande d’une institution publique ou privée, pour prendre en charge les collections sinistrées et les mettre en protection. C’est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus à Mayotte par exemple.
Cela passe aussi par une collaboration inter-service avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Armées qui sont nos trois principaux interlocuteurs. Nous appuyons et participons aux actions qu’ils conduisent et nous sommes des relais locaux.
Quel constat faites-vous sur la préservation du patrimoine en France aujourd’hui ? Est-ce un combat difficile à mener ?
La prise de conscience est de plus en plus visible. Au tout début, nous prêchions dans le désert, nous n’étions pas pris au sérieux. Aujourd’hui, les choses changent. Les tensions géopolitiques et le conflit en Ukraine nous rappellent que nous sommes vulnérables. Les tensions géopolitiques mentionnent que les choses ne sont pas immuables. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été un catalyseur pour les services publics, notamment auprès des sapeurs-pompiers qui ont eu cette obligation de travailler sur la planification. De plus, l’obtention de l’agrément de sécurité civile que nous avons obtenue en 2023 a permis de renforcer notre action et d’être entendu comme un acteur de la protection du patrimoine. Et aujourd’hui, la prise de conscience est bien meilleure, mais ce sont les moyens humains et financiers qu’il nous manque.
À lire aussi : Podcast ; Pompiers de Paris et Sécurité civile : l’Armée de Terre au service de la protection
Certaines préfectures se saisissent de ces sujets et rédigent des dispositions spécifiques Orsec visant à organiser la réponse à l’urgence pour le patrimoine. Il y a une vraie volonté d’intégrer cette cause dans les politiques publiques et de porter la voix sur ce sujet. Ainsi, le constat est mitigé mais beaucoup moins catastrophique que ce que l’on pouvait voir il y a une dizaine d’années. C’est donc plutôt encourageant.
En quoi consistent les campagnes de sensibilisation ?
Nous participons, par exemple, à des événements grand public, comme les Journées européennes du patrimoine, la Nuit des musées, les Journées de l’archéologie. Ce sont pour nous des occasions de rencontrer le grand public et de leur parler de la nécessité de protéger le patrimoine. Nous mettons à disposition sur notre site de nombreuses ressources documentaires.
Nous constatons également que, lorsqu’il y a une atteinte au patrimoine, les populations se mobilisent, comme le montre l’exemple de l’incendie volontaire de la bibliothèque de Grenoble qui s’est déroulé le 19 février, ou encore la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous remarquons combien les personnes sont attachées à leur patrimoine.
Cela passe aussi par la sensibilisation des élus avec des prises de rendez-vous, des directions régionales des affaires culturelles ou DRAC, des pompiers. C’est le travail de pèlerin que le Bouclier Bleu a toujours réalisé depuis sa création.
En quoi a consisté votre intervention à Mayotte ?
Notre dernière mission a eu lieu à Mayotte. Nous sommes intervenus sur une durée de quinze jours, par l’entremise de deux équipiers, à destination du MuMa, le musée de Mayotte, fortement impacté, et qui est le seul musée de France de l’île. Leur intervention a porté sur une évaluation des dégâts pour pouvoir ensuite chiffrer les travaux de restauration et une mise en protection des collections : mise à l’abri, conditionnement. Ce travail a été fait par une conservatrice-restauratrice et par un sapeur-pompier, issus de la réserve opérationnelle du Bouclier Bleu.
À lire aussi : Incendies en Amazonie : dérives et autojustifications médiatiques
Et pour la suite ?
Le Bouclier Bleu est au patrimoine ce que la Croix-Rouge est à la santé. Ce sont donc les urgences qui guident une partie des actions futures. Le Bouclier Bleu France ambitionne dans un avenir proche de créer un module européen mixte (patrimoine/pompier) rattaché au mécanisme de protection civile européen pour intervenir en dehors du territoire national.