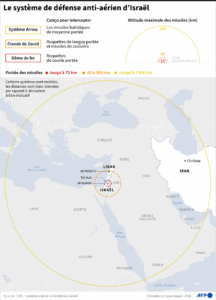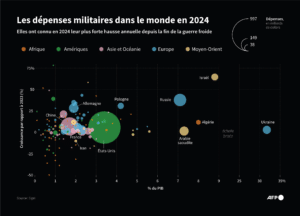Ce dernier numéro de la revue historique des armées se présente comme un recueil d’articles très divers, ce qui est la loi du genre « varia ». Des maîtres de musique en passant par le lobbying des marins de l’Assemblée nationale entre 1871 et 1876, jusqu’à l’état d’urgence en Afrique du Sud dans les années 1980, le lecteur pourra trouver des mises au point scientifiques inédites qui n’en sont pas moins importantes.
Retrouvez la Revue d’histoire militaire.
Lieutenant-colonel (R)Thierry Bouzard, Professeurs de musique : les chefs d’orchestre militaires.
Au XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe, il est fréquent, dans les villes de garnison, de voir et surtout entendre la musique du régiment se produire, le plus souvent dans le kiosque à musique de la promenade, lorsque cela existe dans la cité. De façon générale, la demande de musique, exécutée publiquement, est particulièrement forte. L’opéra, l’opérette, et de façon générale, les concerts attirent une population variée, tout comme les prestations des orchestres militaires qui contribuent, du fait de leur caractère gratuit, à une démocratisation de la musique.
L’orchestre régimentaire existe dans l’armée française depuis l’ordonnance de 1766, progressivement les maîtres de musique désignée par le commandement substituent les instruments d’harmonie au tambour. Les armées de la révolution poursuivent d’ailleurs cette tradition avec un conservatoire dédié qui contribue à la formation des musiciens.
Très rapidement l’institution militaire a pu s’adapter pour répondre à ses besoins en musiciens en faisant appel à des civils qui portent le nom peu élégant de gagistes, même si cela est parfaitement explicite. Pour sa part, le maître de musique avait une fonction d’enseignant. Dans cet article on apprend que la demande de musique vient essentiellement des régiments, d’autant plus que des dispositions réglementaires imposent aux officiers d’en assumer la charge, sans excéder une journée de solde par mois.
À lire aussi : L’histoire de l’Angleterre par le rock
Progressivement la musique militaire se développe, en même temps que dans le monde civil, et bien souvent les maîtres de musique des régiments sont à l’origine des harmonies municipales et des écoles de musique dépendant de la ville. Ce développement n’est pas dénué d’impact économique, car cette popularisation de l’harmonie attire des facteurs d’instruments comme Adolphe Sax, qui a fini par choisir la France après avoir refusé une proposition russe G anglaise.
Ces chefs de musique jouent également un rôle majeur en matière d’enseignement, en développant des méthodes pédagogiques qui ont été largement reprises dans le monde civil.
Les harmonies militaires contribuent également au rayonnement de leur pays, notamment lorsque le premier concours international de musique militaire est organisé à Paris en 1867. Le chef de musique est également un arrangeur en adaptant à l’orchestre en marche et à l’extérieur des pièces qui étaient destinées aux salles de concert.
On me permettra un petit clin d’œil amical à la musique des parachutistes, qui montre au fil des ans la vitalité de cette démarche qui permet le maintien de l’éducation musicale et qui mériterait sans doute que l’on y accorde encore plus intérêt.
Héctor Strobel del Moral, Défendre la République : la résistance mexicaine à l’intervention française, 1862-1867.
L’intervention française au Mexique est surtout connue par la bataille de Camerone le 30 avril 1863. Elle constitue le symbole le plus important pour la Légion étrangère et sa commémoration obéit tous les ans à un rituel immuable. Dans ce numéro le lecteur changera de point de vue à propos de cette guerre un peu oubliée qui traduisait surtout la volonté de Napoléon III de maintenir l’influence française sur le continent américain. Venant soutenir l’empereur Maximilien, l’armée française se heurte à une résistance mexicaine dont l’auteur de cet article présente les spécificités.
À lire aussi : Cartels au Mexique : vers une intervention militaire des États-Unis ?
Ce n’est pas une levée en masse patriotique qui permet de former le gros des troupes mexicaines, mais bel et bien un système de conscription forcée qui traduit surtout les divisions de la société mexicaine. L’article est d’autant plus intéressant qu’il montre surtout comment cette résistance à l’invasion a contribué à écrire le roman national mexicain. Le président libérateur Benito Juárez et ses généraux ont pu ainsi contribuer, même au prix d’une réécriture de l’histoire à la formation d’une identité nationale. On me permettra toutefois une petite remarque ironique, car, si les États-Unis, alors jeune nation, a pu apporter un soutien militaire aux républicains du Mexique, c’était contre espèces sonnantes et trébuchantes, une forme de deal qui apparaît aujourd’hui comme un clin d’œil de l’histoire.
Kristian Bruhn et Jan René Westh, France Danemark, 1870 : les préparatifs militaires secrets d’une alliance.
Pendant cette période la diplomatie secrète sert à construire des alliances militaires, en partant du principe que « l’ennemi de mon ennemi peut être mon ami ». Cela semble évident, lorsque l’on analyse avec attention les préparatifs secrets, bien évidemment, d’une opération militaire conjointe, franco-danoise en mer Baltique. Le Danemark conteste en effet l’annexion après la défaite dans la guerre des duchés du Schleswig en 1864, et entend bien le récupérer. Une guerre franco-prussienne, dont la France sortirait victorieuse, constitue donc une bonne affaire pour le pays.
Côté français, la position du Danemark en mer Baltique constitue incontestablement un avantage stratégique est déjà à cette époque une opération amphibie, pour dire clairement un débarquement, pouvait être envisagée. Les négociations ont pu aller très loin, et un corps expéditionnaire calibré à 28 000 hommes a même été prévu. Toutefois la pression russe et anglaise a fini par persuader le roi du Danemark Christian IX à maintenir sa neutralité. Il reste de cet épisode de très intéressantes études et des documents de préparation opérationnelle qui méritent, au moment où la mer Baltique redevient un point de tension, avec la Russie évidemment, d’être étudiés avec un regard neuf.
Sébastien Nofficial, Les marins de l’Assemblée nationale : un groupe de pression ? (1871-1876)
Benoît Tahon, Sélectionner et instruire : l’oreille dans la guerre moderne
Thibault Dubarry, De l’état d’urgence des années 1980 en Afrique du Sud – la loi martiale dans les townships comme contre-exemple de la militarisation des réponses face aux troubles civils.
Régulièrement, dans le débat public en France, l’appel à l’armée comme instrument de maintien de l’ordre est évoqué, comme une solution miracle, permettant de pallier le déficit d’effectifs des forces de sécurité intérieure. Bien que la situation ne soit évidemment pas comparable, le retour d’expérience de ce qu’a pu être l’instauration d’un état d’urgence permanent, ce qui constitue un paradoxe pour une mesure d’exception, montre toutes les limites de ce dispositif. Au milieu des années 70, l’indépendance de l’Angola et du Mozambique favorise une relance de l’activité de l’ANC, le parti qui lutte contre l’apartheid depuis les années 50. La bascule s’opère vers la lutte armée, ce qui entretient l’idée, au sein du gouvernement sud-africain, qu’il faut mener une guerre intérieure pour préserver le statu quo.
À lire aussi : Afrique du Sud. La nouvelle guerre des Boers ?
Des manifestations à caractère social, comme la lutte contre la hausse des loyers en 1984, suscitent la multiplication d’action conjointe de la police et de l’armée, ce qui aboutit avec le développement des manifestations, à l’instauration de l’état d’urgence. Les pouvoirs de police de l’armée sont très largement étendus et les forces engagées cherchent à occuper le terrain, notamment par des raids contre des militants identifiés de la lutte contre l’apartheid. Le gouvernement sud-africain a mené une guerre de contre-insurrection, ce qui au final, a contribué à l’effondrement du régime d’apartheid. Cela ne signifie pas pour autant que la situation sociale en Afrique du Sud ne mérite pas d’évoluer, notamment pour la question foncière. Pour les forces armées, l’intégration des noirs et des métis a pu largement progresser, même s’il reste encore du chemin à parcourir.