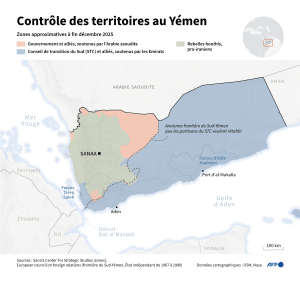Singapour est unique. En général, le visiteur français la trouve trop bien tenue, un peu comme une Suisse asiatique et, en effet, il y a quelque chose de protestant dans le civisme singapourien. La propreté des rues et le maintien des citoyens contrastent.
Singapour est une création britannique du temps où la Grande-Bretagne, empire colonial et maritime, était soucieuse d’occuper des points d’appui stratégiques. C’est elle qui a peuplé l’île de travailleurs étrangers.
En 1965, après une brève union orageuse avec la Malaisie, Singapour devenait indépendante sous la direction de celui qui a si fortement contribué à modeler la cité-État et ses institutions : Lee Kuan Yew (1923-2015). À l’époque, Singapour compte deux millions d’habitants dont une majorité chinoise, et deux substantielles minorités, malaise (musulmane) et indienne.
La cité-État dépend pour son eau potable de la Malaisie et pour sa sécurité de la présence de bases militaires britanniques.
Lee Kuan Yew est celui qui institue, avec volontarisme, une entité aussi harmonieuse que possible veillant à l’intégrité des institutions (héritées de la Grande-Bretagne) et particulièrement du judiciaire, à l’absence de discrimination, la non-tolérance à l’égard de la corruption (les hauts responsables sont royalement payés), enfin à la méritocratie. Le modèle imposé par celui qu’on hésite à qualifier de « despote éclairé » tant il se voulait démocratique est multiracial, multireligieux et multilinguistique. Le bilinguisme est adopté avec l’anglais en marge du mandarin, du malais et du tamoul. En moins de dix ans, la Singapore River et le bassin de la Kallang River sont contrôlés et libèrent Singapour de la dépendance en eau potable. Lorsque les Britanniques annoncent en 1968 qu’ils se retirent « à l’est de Suez », Lee Kuan Yew obtient que les bases militaires qui contribuaient à alimenter 20 % du budget de la cité-État soient reconduites pour trois ans. Un service militaire national de deux années est institué. Par ailleurs, les services spéciaux veillent étroitement à la sécurité de Singapour. Il s’agit d’éviter tout attentat (notamment islamiste) remettant en cause la bonne entente des communautés et le fonctionnement du port qui est à l’origine de la prospérité de la cité-État. Jusqu’à présent, la sécurité a été assurée pour les six millions de citoyens de Singapour tandis que la main d’œuvre étrangère (dont une proportion non négligeable de Chinois de Chine communiste) est contrôlée.
On ne rencontre pas de ghettos ethniques dans la mesure où il n’est pas permis de louer l’ensemble d’un immeuble à une communauté particulière. Il faut panacher de façon à ne pas assister à des concentrations créatrices de communautarismes hostiles. Cela n’empêche pas Singapour d’avoir un Chinatown plein de charme, un « Little India » très vivant et un quartier autour d’Arab street où l’on mange des cuisines issues du Moyen-Orient.
En 1971, une banque centrale est créée (Monetary Authority) et l’année suivante, la National Wages Council, qui veille à un consensus sur les salaires. En 1981, le Government of Singapore Investment Corporation (GIC) s’occupe d’investir les réserves du gouvernement. La même année est créé Chiangi international Airport, l’un des aéroports les plus importants d’Asie.
Lee Kwan Yew veut que le Housing and Development Board aide les Singapouriens à acheter leurs maisons et disposent de retraites et crée à cet effet le Medisave (1984).
Entre 1984 et 1989, une vaste campagne est lancée afin d’imposer la propreté des rues et des lieux publics et pour multiplier les espaces verts. L’écologie est ici prise au sérieux et la ville a été transformée en cité-jardin.
Pour pallier la relative exiguïté de l’espace, la cité s’est dotée d’un énorme sous-sol de magasins et de lieux de récréations surnommé hinterland.
Sur le plan politique, Singapour fait partie de l’Asean et a des rapports diplomatiques avec nombre d’États dont les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russe, la CEE, etc. Lee Kwan Yew cesse d’être Premier ministre en 1990 mais reste actif jusqu’en 2011. Il a 87 ans et son dernier discours rappelle l’importance de l’État de droit, de la nécessité de veiller à ne pas tolérer la corruption et de développer la méritocratie. Aujourd’hui, Singapour représente un modèle inimitable qui veille de très près à la bonne entente des divers groupes ethniques et religieux qui la composent tout en s’efforçant de conserver le maximum de liberté d’action et de préserver sa sécurité.