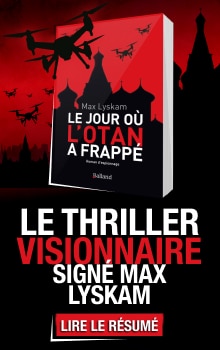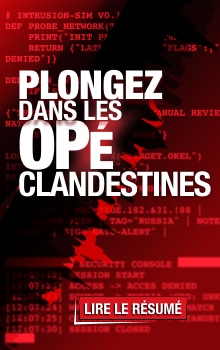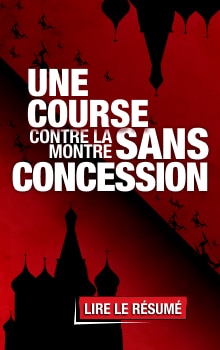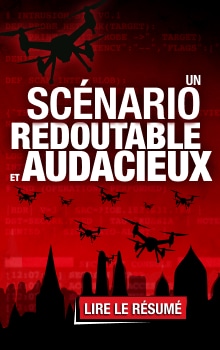L’Europe célèbre ses « clouds souverains », mais sa dépendance technologique reste entière. Et si, en matière de souveraineté numérique, elle se battait simplement sur la mauvaise échelle ?
Un débat piégé par les symboles
Le « cloud souverain » fait de nouveau florès dans les discours en Europe. À Bruxelles comme à Paris, on célèbre la montée en puissance d’acteurs comme OVHcloud ou Scaleway, présentés comme les fers de lance d’une autonomie numérique enfin conquises. Dans les télécoms, la défense d’un cloud « made in Europe » est devenue un argument stratégique, presque un réflexe politique. Mais derrière cette rhétorique rassurante, une question demeure : de quelle souveraineté parle-t-on vraiment ?
« Quand je dois faire des choix de cloud et que j’ai le choix entre Amazon, Microsoft ou Google, je ne suis pas très à l’aise » lançait il y a quelques mois au Forum InCyber Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies. Un malaise largement partagé, et compréhensible, dans un contexte où les données sont devenues des actifs stratégiques et où l’idée de les héberger sur des infrastructures américaines dérange.
Mais cette prudence, légitime, ne vise pas le bon étage du problème. Le débat européen sur la souveraineté numérique se concentre sur la nationalité des serveurs, des clouds ou des data centers. Il passe à côté de l’essentiel : la dépendance technologique structurelle qui traverse une bonne partie de la chaîne du calcul.
Sous le cloud, la chaîne invisible
Les serveurs, câbles et bâtiments de données sont la partie visible de l’infrastructure numérique. Mais la souveraineté liée à l’IA ne se joue pas principalement dans ces murs, elle se joue dans les couches industrielles et logicielles qui les font fonctionner. Or, ces couches sont presque entièrement extra-européennes.
Les processeurs et cartes graphiques qui animent les supercalculateurs mondiaux sont presque tous américains : Nvidia, AMD, Intel. La gravure des puces est dominée par TSMC (Taïwan) et Samsung (Corée). Les frameworks, environnements logiciels servant à entraîner les IA, comme TensorFlow (Google), PyTorch (Meta) ou CUDA (Nvidia), proviennent également des États-Unis. Même les supercalculateurs européens financés par la Commission, LUMI en Finlande, Jupiter en Allemagne, Adastra en France, tournent sur des architectures américaines.
Tant que ces briques ne seront pas maîtrisées localement, changer de prestataire cloud ou de pavillon national ne fera qu’habiller la dépendance sans la réduire.
Une souveraineté confondue avec la propriété
En France comme ailleurs en Europe, la souveraineté numérique est souvent assimilée à la propriété du matériel. On se félicite d’héberger ses données « chez soi », sur un cloud « de confiance » ; on s’inquiète quand un acteur public passe sous pavillon étranger. Mais posséder l’infrastructure n’équivaut pas à contrôler la technologie
L’affaire Exaion illustre ce contresens. Créée par EDF en 2020 pour développer un cloud bas-carbone, la société a signé un accord d’investissement avec l’américain MARA Holdings, suscitant des critiques autour d’une supposée atteinte à la souveraineté française.
Pourtant, non seulement Exaion représente une part infime des capacités de calcul nationales, mais en outre, l’entreprise s’appuie, comme tous les autres acteurs, sur des processeurs Nvidia et des logiciels américains. Le problème ne réside donc pas dans la prise de participation américaine.
Sortir du réflexe défensif
L’Europe n’est pas inerte : elle a lancé plusieurs initiatives pour regagner du terrain technologique. Le European Chips Act, doté de 43 milliards d’euros, veut relancer la production de semi-conducteurs sur le continent. Mais l’écart reste vertigineux face au budget autorisé de 280 milliards de dollars du CHIPS and Science Act américain.
Le projet SiPearl, censé mettre au point le premier processeur européen pour le calcul intensif, progresse lentement. Quant à Gaia-X, la tentative d’écosystème cloud européen, elle s’enlise dans les divergences nationales et les retards techniques.
Refuser toute alliance étrangère ne garantit pas une autonomie technologique. L’histoire montre même l’inverse. Dans les années 1960, la France a bâti sa filière nucléaire en s’appuyant d’abord sur les licences américaines de Westinghouse Electric, avant de franciser la technologie et de devenir exportatrice. L’autonomie s’acquiert par apprentissage, pas par isolement.
Le partenariat entre EDF et MARA Holdings pourrait s’inscrire dans cette logique : intégrer un savoir-faire mondial afin de renforcer, à terme, les compétences européennes en matière de calcul intensif et de gestion du système énergétique. La souveraineté ne découle pas de la nationalité du capital, mais de la conquête progressive des briques technologiques.
Changer d’échelle
Le numérique européen souffre d’un mal de perspective. Nous nous battons pour la localisation des serveurs, quand le pouvoir se situe dans les micro-architectures. Nous défendons les façades, quand la bataille se joue dans les « fabs » (les usines de production de semi-conducteurs), les laboratoires et les lignes de code.
Le vrai enjeu est de construire ce que l’on veut maîtriser. L’Europe peut encore écrire une souveraineté numérique ambitieuse, à condition de la penser comme un projet industriel, pas seulement comme un réflexe de défense.