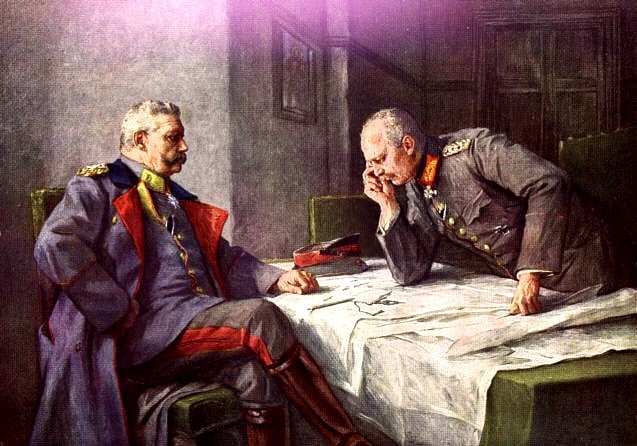Non loin du champ de bataille qui vit en 1410 la défaite des chevaliers teutoniques eut lieu, cinq siècles plus tard, une bataille qui tient dans le récit allemand de la Grande Guerre la même place que la Marne dans l’histoire de France.
Pierre Royer
Si, à l’inverse de la bataille médiévale[1], les Allemands conjurèrent la menace d’une invasion slave, la victoire de 1914 signe l’échec d’une vision stratégique qui les avait conduits à accepter le risque d’un conflit généralisé… qui s’avèrera plus vite fatal au IIe Reich que Grunwald ne le fut à l’ordre Teutonique.
À lire également
Tannenberg / Grunwald (15 juillet 1410). Le crépuscule des dieux
Le mythe du « plan Schlieffen »
L’alliance militaire franco-russe, conclue en 1892, était une mauvaise nouvelle pour les stratèges allemands : en cas de guerre, le pays pourrait être pris en tenaille entre deux adversaires redoutables, l’un par son armée dotée de matériels industriels modernes – dont le canon de 75 mm à tir rapide, mis au point en 1897 –, l’autre par un inépuisable réservoir humain. Deux ans après la démission d’Otto von Bismarck, le « chancelier de fer » architecte de l’unification allemande et de l’isolement diplomatique de la France, organisé pour la garantir, son œuvre volait en éclats et l’Europe commençait à s’organiser en deux blocs d’alliances rivaux. Ces alliances se voulaient défensives, donc dissuasives, mais imposaient de se préparer au scénario du pire : une guerre sur deux fronts dans le cas de l’Empire allemand.
C’est cette hypothèse de travail qui conduisit le général von Schlieffen à proposer, en 1905, une manœuvre audacieuse : concentrer l’essentiel des forces à l’Ouest pour vaincre rapidement la France en profitant du retard prévisible de la mobilisation russe. Dans le contexte de la fin de la guerre russo-japonaise, qui se terminait par une déroute russe tant sur terre que sur mer[2], et compte tenu des troubles intérieurs de la révolution de 1905, le choix semblait judicieux, mais n’avait pas vocation à perdurer. Or, après la retraite de Schlieffen, dès 1906, l’état-major impérial conserva ce schéma d’opérations, malgré le redressement de la Russie, avec deux conséquences tragiques : en cas de crise à l’Est, infiniment plus probable qu’à l’Ouest, il était impossible de circonscrire le conflit sans impliquer la France. Pour vaincre rapidement cette dernière, il était nécessaire d’éviter la frontière des Vosges, étroite et très fortifiée, pour passer par un pays neutre – la Suisse, malcommode, ou la Belgique, protégée depuis 1831 par un traité cosigné par la France, le Royaume-Uni et… la Prusse !
De sorte que le plan allemand, conçu en cas de généralisation du conflit, entraînait automatiquement cette généralisation : à partir de la mobilisation russe, l’armée allemande estimait avoir deux mois devant elle pour écraser la France, ce qui obligeait à lui déclarer la guerre. Et la violation de la neutralité de la Belgique fournirait un excellent casus belli au Royaume-Uni, qui n’avait aucune alliance formelle avec la France ou la Russie. Quant au plan de mobilisation à l’ouverture des hostilités, il concentrait sept armées sur les frontières occidentales et laissait la défense des frontières orientales aux 155 000 hommes de la 8e armée, confiée à von Prittwitz.
La rigidité conceptuelle ne se sentait pas seulement au niveau stratégique, mais aussi dans les concepts opératifs et manœuvres tactiques. La doctrine allemande reposait sur le primat de l’offensive[3], même sur un front oriental où les Allemands seraient en infériorité numérique. Plutôt que d’attendre stoïquement d’être submergés par le « rouleau compresseur » russe, comme disait la presse française, et pour perturber le plus possible la mobilisation ennemie, une attitude agressive était recommandée aux généraux, qui devaient rechercher, dans le plus pur style napoléonien, à empêcher les concentrations de troupes ennemies et à tirer le meilleur parti de toute supériorité ponctuelle obtenue par la manœuvre – c’était la « défense active ».
Les limites de la défense active
La prédominance de la théorie dans les conceptions militaires allemandes était aggravée par le fait que la plupart des commandants des grandes unités n’avaient jamais commandé au feu. Seul Prittwitz avait servi au temps des guerres de 1866 et de 1870-1871, ainsi que celui qui lui succéderait, Paul von Hindenburg, mais ce dernier était à la retraite en 1914. En revanche, les chefs de corps de la 8e armée et même Ludendorff, qui devait devenir son chef d’état-major fin août, avaient commencé leur carrière active après la victoire contre la France. Ce manque d’expérience des conditions réelles d’un conflit devait favoriser des projets de manœuvre minimisant le « brouillard de la guerre » et les contraintes logistiques, mais aussi des prises d’initiative frôlant parfois l’insubordination.
Ainsi, dans les premiers jours de la guerre, alors que Prittwitz veut aller méthodiquement à la découverte de l’ennemi qui a mobilisé, plus vite que prévu, deux armées de 180 000 hommes chacune, le chef du Ier corps, le général von François[4], appliquant à la lettre le concept de défense active, s’avance imprudemment vers l’est et échappe de peu à l’encerclement le 17 août à Stallupönen. C’est encore lui qui, se référant à la manœuvre de Cannes, enseignée comme modèle dans les écoles d’état-major prussiennes, préconise une double attaque sur les flancs de la 1re armée russe de Rennenkampf qui avance sur Gumbinnen, le 20 août. L’attaque au nord est plutôt réussie, mais finit par être stoppée, tandis que l’attaque au sud vire à la catastrophe.
Les Allemands sont donc obligés de reculer et de se redéployer pour couvrir à la fois la forteresse de Königsberg et la route vers Berlin, car la 2e armée russe, commandée par Samsonov, progresse au sud en direction de la Vistule. Les nouvelles de l’invasion russe, avec son cortège d’exactions, réelles ou fantasmées, sur les populations civiles, et des maladresses dans la transmission du rapport de Prittwitz à l’état-major impérial, laissant à penser qu’il envisage d’abandonner à l’ennemi la Prusse orientale, poussent Moltke à modifier le commandement de la 8e armée : Hoffmann, le chef d’état-major, passe sous les ordres de Ludendorff, nommé le 21 août, qui propose qu’Hindenburg remplace Prittwitz. Le 22 août, les deux généraux se retrouvent à Hanovre dans un train en partance vers l’est – ils ne se quitteront plus de toute la guerre.
À peine arrivés, les nouveaux chefs vont bénéficier de circonstances favorables et de coups de pouce du destin. Dans la première catégorie se situe l’absence de coordination des deux armées russes, Rennenkampf restant au nord des lacs de Mazurie pour menacer Königsberg, tandis que Samsonov veut refouler vers l’ouest le maigre corps laissé en face de lui, visant Allenstein[5] et la ligne de la Vistule. Les coups de chance sont que le 25 août, deux messages russes, transmis en clair, sont interceptés et révèlent les intentions ennemies à Ludendorff, qui peut ainsi anticiper la divergence des deux armées et l’isolement de Samsonov qui allait en résulter. Les jours suivants, les difficultés de communication entre les chefs russes et leur négligence quant à l’éclairage et la reconnaissance des positions ennemies, reposant presque exclusivement sur une cavalerie pléthorique, mais finalement apathique et aveugle[6], faciliteront grandement le déploiement du piège de Ludendorff. À un moment crucial – dans la journée du 27 août –, Samsonov reçoit même de la Stavka[7] une réponse urgente chiffrée dans un code dont ses services ne possèdent pas la clé !
La chance et l’inconséquence du commandement russe ne sont pas les seuls facteurs de la victoire allemande. Le sang-froid des nouveaux chefs de la 8e armée, et l’autorité avec laquelle ils domptèrent des subordonnés fébriles ou un peu trop indépendants furent sans doute décisifs. Ainsi, quand les Allemands découvrent le 27 août des troupes russes occupant Allenstein, donc menaçant leurs arrières et la seule liaison ferroviaire entre leurs corps d’armée, leurs chefs analysent froidement la situation, estimant que cela traduit plus un éparpillement excessif de l’armée de Samsonov qu’une réelle menace de débordement par l’ouest et maintiennent l’orientation de la manœuvre en cours d’une poussée convergente vers le sud et vers l’est pour achever la dislocation des deux corps russes déjà éprouvés par les engagements des jours précédents autour du Mühlensee. Comme le disait Ludendorff, toute menace recèle une opportunité.
À lire également
La lutte finale
Le 28 août, le XXe corps de Scholtz, placé au nord-ouest, qui avait freiné non sans mal l’avancée russe vers la Vistule les jours précédents, consolida ses positions à mesure que les Russes, épuisés et à court de ravitaillement, commençaient à se rendre pour s’assurer d’être nourris à leur faim. Les 29 et 30, quatre des six corps de la 8e armée commencent à converger pour écraser l’armée Samsonov : au sud, le Ier corps de François dépasse Neidenburg en avançant vers l’est ; au nord, le Ier corps de réserve de Below reprend Allenstein puis s’oriente vers le sud pour se lier avec Scholtz, parallèlement au XXXe corps de Mackensen qui marche plus à l’est et vise Willenburg, pour fermer la nasse autour des deux corps d’armée et demi aventurés, désormais très mal ravitaillés et en partie épuisés par plusieurs jours de marche et de combat dans un environnement boisé et lacustre, particulièrement pénible.
La progression allemande resta toutefois prudente. Ayant déjà éprouvé la ténacité des fantassins russes et leur science du camouflage ou de la mise en défense dans des retranchements de campagne, et voulant aussi éviter de répéter les erreurs de tir de l’artillerie, qui avait plusieurs fois bombardé ses propres troupes dans la précipitation, les généraux allemands déployaient méthodiquement leurs sections de mitrailleuses et leurs canons avant de hasarder leurs fantassins en rase campagne. Le 30 août, le 8e régiment de uhlans tombe sur le train de bagages combiné du XVe corps et de la 2e division, capturant un millier de chariots et près de 5 000 hommes. Ce même soir, à 20 heures, les troupes de François atteignent Willenburg : ce qui restait de la 2e armée était enfermé.
Le 31, la 2e armée avait cessé d’exister, ayant perdu 50 000 tués, 30 000 blessés et près de 90 000 prisonniers[8] – son chef lui-même s’était suicidé au soir du désastre. La 8e armée ne déplorait, en tout, que 13 000 pertes, seulement 8 % de son effectif initial. Les premiers rapports parlaient de « la bataille d’Allenstein », bientôt remplacée par Tannenberg, où aucun combat n’avait pourtant eu lieu, le village étant à près de 25 km à l’ouest de la région du Mühlensee et à quelque 40 km au sud-ouest d’Allenstein. Mais Hoffmann, féru d’histoire militaire, avait pointé le nom du village, traversé au cours d’un transfert de l’état-major, et Hindenburg, dont un ancêtre était mort en 1410, le proposa au Kaiser, comme une revanche à la fois familiale et nationale. Un imposant mémorial sera construit en 1924 près d’Hohenstein[9] pour le dixième anniversaire de la victoire, et Hindenburg y sera inhumé en 1934. Son corps sera ramené en Allemagne en 1944 devant l’avance des troupes soviétiques, qui rasèrent ultérieurement le monument.
Quinze jours plus tard, le tandem Hindenburg – Ludendorff remportait une autre victoire totale sur Rennenkampf dans la région des lacs de Mazurie (7-14 septembre), notamment grâce au renfort de deux corps d’armée et une division de cavalerie, prélevés sur le front ouest. Pourtant, au même moment, la victoire alliée sur la Marne (du 6 au 12) consacre l’impossibilité de terminer rapidement la guerre et l’obligation de combattre sur deux fronts, que Schlieffen avait voulu éviter. Mais l’occasion à saisir en 1905 était devenue un piège en 1914, en accréditant l’hypothèse d’une guerre courte, donc en facilitant l’acceptation du conflit.
À lire également
Podcast. La Russie, l’Empire et la guerre. Pierre Gonneau
[1] Voir Conflits no 52, juillet 2024.
[2] Voir Conflits no 36, novembre 2021.
[3] L’état-major français n’était donc pas le seul aveuglé par l’illusion de la puissance de l’offensive.
[4] Comme son nom l’indique, il s’agit d’un descendant de huguenots ayant fui la France sous Louis XIV.
[5] Aujourd’hui Olsztyn en Pologne.
[6] Les Allemands utilisent plus systématiquement les reconnaissances aériennes.
[7] État-major central de l’armée russe.
[8] Le décompte des pertes n’est pas complètement assuré en raison de l’ambiguïté des sources allemandes et de la contestation des Russes, qui ne reconnaissent qu’une perte globale de 90 000 hommes.
[9] Aujourd’hui Olsztynek, en Pologne.