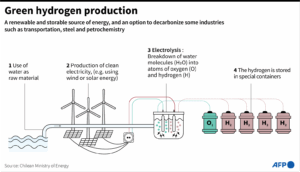Il fut une époque où les choses étaient simples, du moins dans le monde occidental. Il y avait un temps pour la paix et un temps pour la guerre, un temps pour l’ennemi et un temps pour l’ami. Le plus ancien traité de paix aurait été signé en Mésopotamie dès 2325 av. J.-C., il séparait nettement ces deux moments. Le phénomène se généralisa dans la Grèce antique au point que l’on voit dans ce pays le berceau du droit international.
La guerre a changé, et avec elle l’ennemi. Sans remonter à un lointain passé, Elie Barnavi distingue trois étappes: d’abord les traités de Westphalie (1648), qui, en consacrant les États-nations modernes, instaurent entre eux une «guerre rationnelle»; ensuite la Révolution française qui ouvre la voie à la guerre idéologique puis à la guerre totale; enfin, l’arme atomique qui rend la guerre conventionnelle improbable sinon impossible entre les grandes puissances et ouvre le champ à la «petite guerre [simple_tooltip content=’Le terme est parfois confondu avec la guerre asymétrique. Dans les deux cas s’opposent une armée traditionnelle avec sa puissance de choc, et des troupes irrégulières moins puissantes, plus souples, capables de se fondre dans le terrain et la population pour échapper aux coups de la première, puis de revenir pour la harceler. La «petite guerre» n’est pas chose nouvelle, l’Antiquité la connaissait (ainsi lors de la révolte de Numance contre Rome), l’Espagne dressée contre Napoléon en fournit un autre exemple. Elle est simplement passée au premier plan aujourd’hui.’](1)[/simple_tooltip]», à la guerre économique et depuis peu au cyber conflit.
Le tableau tracé par Barnavi peut être nuancé. Il n’en permet pas moins de définir les trois temps de l’ennemi.
Les trois temps de la guerre, les trois temps de l’ennemi
Au temps de l’État-nation, l’ennemi est celui qu’il combat. Il est parfois diabolisé et caricaturé, parfois exterminé (que l’on pense aux dragons de Louis XIV dans le Palatinat). Mais les souverains savent qu’il faudra bien faire la paix un jour, d’autant plus que de nombreux liens matrimoniaux unissent leurs familles entre elles. Il existe même une forme de respect entre combattants dont témoignerait la formule: «Messieurs les Anglais, tirez les premiers [simple_tooltip content=’Lors de la bataille de Fontenoy (1745). Cette invite est plus un piège qu’un acte de civilité – les Français allaient pouvoir tirer en second et avec plus de précision. La citation est d’ailleurs incertaine.’](2)[/simple_tooltip]» – même si elle est sans doute mal comprise. La Révolution met fin à la «guerre en dentelles», à supposer que celle-ci ait jamais existé. Aux savantes manœuvres des armées professionnelles, elle substitue le choc des bataillons de volontaires peu expérimentés mais nombreux – la France est alors le pays le plus peuplé d’Europe. Pour les enthousiasmer il faut une cause juste: la Marseillaise désigne l’ennemi comme ces tyrans «qui viennent jusque dans [nos] bras égorger [nos] fils, [nos] compagnes». L’ennemi devient (ou redevient si l’on pense aux guerres de Religion) un monstre, un mal absolu qu’il faut anéantir, à moins qu’il ne se rallie à la foi et à l’idéologie du vainqueur. Les Alliés refuseront deux fois à l’Allemagne l’idée d’un armistice pour exiger une capitulation sans conditions qui la mettait à leur merci.
L’après-Seconde Guerre mondiale voit la notion d’ennemi éclater. Il s’habille d’« orange» et de « carmin», les couleurs que l’armée française réserve lors de ses manœuvres aux (futurs?) ennemis dans lesquels il est facile de reconnaître les Soviétiques. Il prend aussi la forme du partisan des conflits coloniaux ou post-coloniaux, celui qui pratique la guerre asymétrique et qui se dissimule dès que les armées régulières le traquent. Il devient le terroriste qui se cache dans la foule et frappe quand et où on ne l’attend pas. Lancée dans les années 1970, la notion de « guerre économique» suppose qu’il existe sur ce terrain un ennemi encore plus difficile à identifier.
Cette périodisation inspirée par Barnavi peut sembler simplificatrice. La guerre entre États-nations dure au-delà de 1789; les guerres de religion, que l’on peut considérer comme des conflits idéologiques, existaient bien avant les traités de Westphalie et n’ont pas disparu ensuite; la période récente a vu et voit s’affronter des idéologies qui veulent anéantir leur ennemi – communisme contre capitalisme libéral, islamisme radical contre « mécréants». Les trois périodes déteignent les unes sur les autres, les ruptures ne sont pas nettes.
Reste un fait qui caractérise notre époque: il est beaucoup plus difficile de désigner l’ennemi. L’ennemi terroriste et le guérillero se dissimulent autant qu’ils le peuvent. L’ennemi économique (si l’on admet ce terme) et le hacker font preuve d’encore plus de discrétion. Et nous nous refusons à parler d’ennemi militaire conventionnel – ce serait envisager la possibilité d’une guerre nucléaire. Impensable! Sommes-nous entrés dans un monde sans ennemi? Dans son ouvrage « Qui est l’ennemi», l’ancien ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian se polarisait sur Daech. L’arbre qui cache la forêt?
Un monde sans ennemis?
Le terrorisme islamiste est le seul ennemi que nous nommons, et encore avec d’infinies prudences par peur des amalgames. Que l’on pense aux circonvolutions de nos responsables pour nommer l’islam radical et la façon dont nos ministres ont préféré au terme « État islamique» celui de Daech – on ne nomme qu’à condition d’être incompréhensible. C’est un ennemi bien commode selon Régis Debray: « Le djihadiste est le Barbare idéal et quasi théâtral avec sa pilosité, des pieds nus, sa tunique noire, ses coutelas et sa kalach car, sur la durée, maîtrisable et absorbable [simple_tooltip content=’In Civilisation, Gallimard, 2017.’](3)[/simple_tooltip].» Caricatural, il focalise toutes les attentions et fait oublier les autres ennemis en costume-cravate ou en uniforme. L’État islamique est un ennemi radical, sans doute, et notre propos n’est pas de le minimiser. Mais il a le défaut, si l’on peut dire, d’éclipser tous les autres dangers.
Pour le reste en effet, nous nous refusons à stigmatiser et nous hésitons devant ce geste qui est pourtant, selon Carl Schmitt, l’essence du politique. Pétrie de culpabilité, l’Europe hésite à renouer avec un passé de conquête et de violence et avec son préalable, la désignation de l’ennemi.
Cette clarification serait d’ailleurs inutile puisque, selon les optimistes, il n’y aurait plus d’ennemi, hors l’inévitable Daech bien sûr. Dans le domaine économique la mondialisation rendrait la notion obsolète. Faut-il d’ailleurs parler d’ennemi ou d’ami économique? Sans doute les exportations de nos partenaires concurrencent nos productions et menacent nos emplois, mais elles nous fournissent des produits plus variés et moins coûteux que les nôtres – c’est tout le sens de la théorie du libre-échange. Allons plus loin. En nous concurrençant, ces partenaires nous forcent à riposter et à devenir plus compétitifs, ils nous rendent meilleurs, ils se comportent comme des amis exigeants qui nous tirent vers le haut. Concluons: le marché mondial réduit les pouvoirs des États et abaisse les frontières, il fait émerger un monde unifié et pacifique.
Internet irait dans le même sens. Il nous permet d’établir des contacts immédiats avec n’importe quel interlocuteur dans n’importe quel pays. Puis-je prendre pour un ennemi l’étranger avec lequel je bavarde sur le Net et qui devient ainsi un familier? Du rapprochement et du dialogue naîtrait la compréhension et émergerait une société civile mondiale capable d’interdire aux États toute pratique belliqueuse.
Ajoutez à cela les organisations internationales, gouvernementales, comme l’ONU et la Cour pénale internationale, ou non gouvernementales comme les associations écologistes et pro-migrants. Dans le monde de demain la notion d’ennemi n’aurait plus sa place.
Les frontières entre civil et militaire, entre intérieur et extérieur, entre guerre et paix se fissurent et avec elles l’ennemi clairement identifié. Il faudrait plutôt parler de rival, de concurrent, d’antagoniste d’adversaire… autant de termes rassurants qui évitent de recourir à la notion d’ennemi, celui face auquel la violence est le seul recours selon Pierre Conesa. Ces précautions de langage servent surtout à se cacher la réalité: l’ennemi se différencie de tous ses synonymes par l’idée d’hostilité radicale.
La paix est un souhait, la guerre est un fait (Oswald Spengler)
Quittons le monde rêvé et revenons sur notre terre. Elle est loin d’être apaisée.
Les arguments économiques des libéraux pourraient convaincre si la concurrence était loyale et ne reflétait que les écarts de compétitivité entre entreprises. La réalité est toute différente: dumping, dumping, dumping subventions publiques, protectionnisme déguisé, espionnage industriel organisé par les États, rachat d’entreprises stratégiques, opérations de déstabilisation… Telles sont les règles de l’échange économique aujourd’hui, et d’ailleurs peu de pays se laissent abuser. Bien sûr la guerre économique n’est pas la guerre tout court, les chômeurs ne sont pas des morts et la victoire ne se conclut pas par l’annexion du vaincu, seulement par la conquête de ses marchés. Pas de violence au sens strict, mais la mort de l’entreprise en cas d’échec, et une multitude d’ennemis, ses concurrents décidés à prendre sa place.
» Le monde pacifié n’est pas pour demain. Ce que nous pouvons craindre n’est pas l’absence d’ennemis, mais le trop-plein »
Sur Internet la situation est encore plus compliquée. Il est difficile de déterminer d’où vient une attaque informatique: un an après avoir dénoncé l’action des services russes dans l’élection présidentielle américaine, les États-Unis n’ont pas été capables d’en fournir la moindre preuve certaine. Ils n’avaient pas pu le faire non plus en 2007 lorsque l’Estonie fut victime d’un blocage de son système informatique provoqué – on supposa que la Russie en était responsable, le hacker russe constituant un lieu commun aussi répandu que le terroriste islamiste, pas obligatoirement à tort. Mais il n’y avait pas de preuve et l’OTAN se garda d’accuser directement Moscou et plus encore d’activer l’article 5.
D’ailleurs, la plupart des ordinateurs mobilisés pour cette opération se trouvaient aux États-Unis. Car les hackers prennent le contrôle d’ordinateurs lointains situés dans toute la planète (on parle d’ordinateurs zombies): remonter jusqu’à eux est difficile. Ils sont tapis dans le Web aussi bien que les guérilleros dans la jungle ou les terroristes dans la foule. Les notions de territoire et de frontières sont bouleversées.
Pis, comme le démontre Olivier Kempf [simple_tooltip content=’In Alliances et mésalliances dans le cyberespace, Economica, 2014.’](4)[/simple_tooltip], Internet remet en question la pratique des alliances stratégiques et donc la notion d’ami. L’opacité du cyberespace fait de chacun un ennemi potentiel – l’action de la National Security Agency (NSA) l’a révélé à ceux qui en doutaient, et il n’y a pas que la NSA! Les alliances sont fragiles et peuvent virer à la mésalliance, selon les termes de Kempf, si nous en disons trop de nos systèmes de défense à un «allié». Dans le monde virtuel comme dans le monde économique tout partenaire peut se révéler hostile.
Quant à l’idée selon laquelle le rétrécissement des distances serait facteur de paix parce qu’il permet aux peuples de mieux se connaître, Samuel Huntington lui a tordu le cou dès le début de son Choc des civilisations. Le rapprochement provoque le choc des intérêts contradictoires et des valeurs inconciliables et fait de peuples autrefois lointains des ennemis proches aussi bien que des amis séduits par l’autre.
Les optimistes se trompent. Le monde pacifié n’est pas pour demain, Julien Freund nous le rappelait. «Comme tous les pacifistes vous pensez que c’est vous qui désignez l’ennemi. Or c’est l’ennemi qui vous désigne… Du moment qu’il veut que vous soyez l’ennemi, vous l’êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin.» Ce que nous pouvons craindre n’est pas l’absence d’ennemis, mais le trop-plein.
Il est vrai que nous avons plus de mal à les identifier. Ils prennent des visages divers à moins qu’ils ne préfèrent se dissimuler autant que possible avant de se révéler. Nous sommes loin de la Grèce antique quand la phalange ennemie apparaissait à l’autre bout de la plaine, mur scintillant de boucliers et de lances. Loin de l’Afrique quand les soldats anglais voyaient se détacher sur la terre ocre les couleurs vives de l’impi zouloue. Loin de Waterloo et des carrés anglais jaugeant les douze mille cavaliers que Ney avait rassemblés pour mener sa charge désastreuse. Anxieux, les soldats serraient instinctivement les rangs et se préparaient à l’impact, soucieux de ne pas riposter trop vite. Aucun ne se demandait si les intentions des adversaires étaient hostiles…
Les choses étaient claires alors, elles le sont beaucoup moins aujourd’hui. Ce n’est pas une raison pour renoncer à les décrypter et à désigner les menaces. La question «Qui est l’ennemi?» est plus nécessaire que jamais.