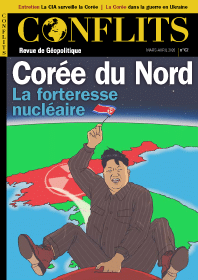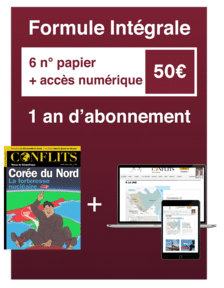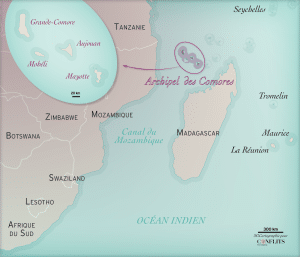Le second mandat du républicain s’est ouvert sous une foule de décrets. De retour à la Maison-Blanche, le milliardaire teste les limites politiques des institutions pour obtenir des résultats visibles et rapides, en particulier sur l’immigration. Quitte à remettre en cause l’équilibre des trois pouvoirs, en renforçant encore son image de leader autoritaire.
Article paru dans le no56 – Trump renverse la table
Oublié le prix des œufs ! Et celui du bacon ! Qui se souvient encore de Donald Trump, candidat, en pleine conférence de presse, posant autour de plusieurs paquets de céréales et embarquant avec lui, comme un enfant, une boîte de Cheerios, tout en promettant de baisser le coût des repas scolaires, quasiment magiquement ? Ou le républicain, visitant un supermarché au cœur de l’été 2024, et tendant un billet de 100 dollars à une mère de famille à la caisse d’un supermarché de Kittanning, une petite ville de Pennsylvanie ? « Tenez, ça va baisser un peu ! », lançait-il devant des rouleaux de papier hygiénique et des bouteilles de ginger ale sous le regard de clientes ébahies (et choisies soigneusement par le service de sécurité). Donald Trump avait promis des actions radicales pour diminuer, dès le premier jour de son second mandat, le coût des produits d’épicerie. Le chariot de supermarché, après tout, représente encore l’inquiétude majeure et immédiate des électeurs américains ayant choisi Donald Trump, après quatre ans d’inflation constante sous Biden. Lui seul pouvait rendre abordables à nouveau les produits alimentaires tout en augmentant, parfois drastiquement, les droits de douane… Une semaine après son investiture, la douzaine d’œufs s’échangeait, selon les États, de 4 à plus de 10 dollars, il est vrai sous l’effet de la grippe aviaire. Il n’y a pas de baguette magique contre la vie chère.
À lire aussi : Le travail agricole saisonnier aux États-Unis
Face au temps politique
Trump, président, doit affronter pour la seconde fois de sa vie le temps politique américain, fait de latence et d’attentisme. Une réalité qui lui avait coûté une défaite aux Midterms en 2018 et sa réélection en 2020. Un temps long où chaque décision économique prise dans le Bureau ovale met un temps considérable à produire ses effets dans le portefeuille des Américains. Dans vingt mois seulement arriveront les élections de mi-mandat, rarement favorables à l’exécutif en place, spécialement quand il est républicain. Priorité à l’instantané, aux images, aux actions qui frappent. Priorité à l’autorité avec un retour en grâce quasi inédit aux États-Unis : celui de l’exécutif. Trump sera roi en son pays.
Rarement Hail to the Chief, la marche militaire qui accompagne l’arrivée du président à des cérémonies, n’avait été autant en accord avec l’esprit du locataire de la Maison-Blanche. Trump veut réaliser beaucoup, rapidement, et enfoncer toutes les brèches en même temps. « Choc et effroi », disent ses conseillers pour décrire sa tactique, reprenant le nom d’une stratégie militaire américaine consistant à infliger à un ennemi le plus de dommages et le plus rapidement possible. La nouvelle administration américaine n’a pas oublié pourquoi elle est aux manettes, mais, déjà, elle a dessiné ses priorités. Trump II, chapitre 1, sera celui des résultats visibles. Et tant qu’à faire, de ceux obtenus sur l’immigration. Un des rares sujets sur lequel la Maison-Blanche dispose d’une marge de manœuvre susceptible de contourner l’inertie habituelle des institutions américaines.
Tout sur l’immigration
Sur une terre marquée par l’immobilisme politique, vieil héritage des Pères fondateurs qui craignaient que les élections ne servent uniquement à nourrir l’appétit de revanche politique à chaque alternance, tout changement brutal est presque irréalisable. La difficulté d’amender la Constitution (requérant un vote des deux tiers dans les deux chambres du Congrès et la ratification par trois quarts des États) illustre à la fois le besoin de stabilité comme la difficulté à réaliser des changements profonds dans un pays fédéral où l’on s’est toujours méfié de Washington, sauf en temps de crise. Ajoutez à cette structure institutionnelle, un empilement de juges fédéraux hautement politisés et une Cour suprême pas toujours en phase avec le peuple et vous obtenez un pays presque irréformable.
En signant dès son premier jour 26 décrets présidentiels (sur les 100 qu’il a promis en cent jours) lors de sa prise de fonction, Donald Trump sait qu’il ne changera pas fondamentalement le fonctionnement de son pays, mais en tirant tous azimuts, il agit, comme l’a fait Franklin Roosevelt avant lui, en maître incontesté des décrets présidentiels (il en signa 3 721 en douze ans) qui ont façonné son New Deal, puis la conduite de la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, être qualifié de roi est toujours perçu comme une insulte. Le roi Trump, lui, s’en moque pas mal.
À lire aussi : Trump réélu : analyse de son entourage
Disposant d’une majorité faible à la fois à la Chambre des représentants (cinq petits sièges républicains) et au Sénat (il a fallu la voix prépondérante de J. D Vance pour confirmer Tim Hegseth, le nouveau secrétaire à la défense), Trump, comme Roosevelt avant lui, n’a pas d’autre choix que de renforcer l’exécutif. En bouleversant en profondeur les actions des agences d’immigration, en redéfinissant les conditions d’attribution des visas, en déployant l’armée, et non la Garde nationale à la frontière sud, Trump réalise sa promesse, lancée sous forme de boutade, de commencer son mandat « en dictateur ». Ça tombe bien, Trump voit la lutte contre l’immigration illégale comme une guerre menée contre une invasion étrangère, où il s’octroierait tous les pouvoirs.
À l’évidence, il lui est plus facile de signer un executive order ordonnant l’expulsion de migrants coupables d’infraction que de décréter que la douzaine d’œufs ne dépassera pas 5 dollars (le blocage des prix était d’ailleurs dans le tiroir des décrets de Kamala Harris si cette dernière avait été élue). En la matière, Donald Trump, qui jure qu’il conduira une opération d’expulsion « jamais vue dans l’histoire du pays », a quelques illustres prédécesseurs qui n’y sont pas allés de main morte quand il s’est agi de refouler des immigrés.
Herbert Hoover[1], aux premières heures de la Grande Dépression, puis (encore lui !) son successeur, Franklin D. Roosevelt, ont à eux deux, de 1932 à 1939, sans passer par le Congrès, expulsé plus de 2 millions de personnes, souvent des descendants de Mexicains qui étaient restés aux États-Unis, en particulier sur la côte ouest, après l’annexion de la Haute-Californie et le traité de Guadalupe. L’opération connue sous le nom de Mexican repatriation avait mobilisé l’armée, les fonctionnaires du service fédéral d’immigration et de naturalisation (ancêtre de l’ICE, et dépendant alors du ministère du Travail), les shérifs locaux et parfois certaines milices… Le gouvernement démocrate faisait du Trump avant l’heure en annonçant dans la presse les opérations d’expulsion, en photographiant menottées les personnes interpellées dans des camions de police et en les filmant pour les actualités destinées à la diffusion dans les cinémas. Comme en 2025, certains migrants choisissaient ce qu’on appelle aujourd’hui « l’auto-expulsion » plutôt que l’humiliation. Déjà, son prédécesseur, Herbert Hoover, dénonçait la concurrence déloyale des agriculteurs latinos à une période où le chômage touchait un quart de la population américaine et à une époque où les principaux syndicats affiliés au Parti démocrate, comme l’American Fédération of Labor (l’AFL), marchaient main dans la main avec le National Club of America for Americans, faisant pression sur le gouvernement pour renvoyer les Mexicains travaillant dans les fermes, non sans une certaine arrière-pensée raciale, tendance eugéniste, plutôt à gauche dans ces années… Un tiers des Mexicains ainsi expulsés sous Hoover, puis sous Roosevelt, étaient nés aux États-Unis, ou étaient des citoyens américains. On pardonnait à l’exécutif ses excès de zèle. L’Amérique ne s’embarrassait pas beaucoup avec la lecture du 14e amendement, portant sur le droit du sol et dont l’interprétation – dans son automaticité – est remise en cause aujourd’hui par un décret de Trump, actuellement bloqué en justice. Républicains comme démocrates ne faisaient pas dans la dentelle et, à l’exception de quelques églises catholiques, la société civile, encore très majoritairement de culture anglo-saxonne et protestante, n’y trouvait rien à redire pourvu qu’on sauvât la jeune nation américaine de la déferlante hispanique… Il a fallu attendre 2005 pour que le gouvernement fédéral et l’État de Californie présentent ses excuses au gouvernement mexicain.
Affirmer l’autorité fédérale
L’affirmation de l’autorité fédérale, la démonstration, même pour quelques séances photos, de l’ascendance de l’exécutif sur le législatif (d’autant plus tangible que, pour l’instant, les deux chambres du Congrès soutiennent le président) sont au pays du check and balance un fait inhabituel. Pas étonnant que Trump fasse de la problématique migratoire son « urgence nationale », statut qui lui donne des pouvoirs exceptionnels, comme ceux d’envoyer l’armée, de procéder à des expulsions accélérées sans contrainte judiciaire. Il n’y a ni roi ni tyran aux États-Unis, sauf, pardonne-t-on outre-Atlantique, en cas de guerre. Une logique qu’ont bien comprise Stephen Miller, chef adjoint du cabinet de Donald Trump, spécialiste de la politique trumpiste migratoire, parfois jusqu’à l’obsession, et Tom Homan, tsar des frontières, vétéran des expulsions sous Obama, recordman au xxie siècle en la matière, lui qui fut surnommé « the deporter in chief ». Les deux hommes, véritables rédacteurs des décrets, ont eu quatre années pour réfléchir à un plan d’action contre l’immigration illégale mis en œuvre uniquement par l’exécutif, orchestré comme s’il s’agissait d’entrer en conflit et que le territoire même se trouvait sous la menace immédiate d’une puissance étrangère.
À lire aussi : États-Unis : les suicides n’ont jamais été aussi importants
Chef d’une guerre qui ne dit pas son nom, Donald Trump a ainsi ordonné au commandement militaire nord des États-Unis (Northcom) d’élaborer des plans de bataille opérationnels pour réprimer l’« invasion », accordant à l’armée une autorité sans limites géographiques à l’intérieur même des frontières américaines. Classant dès son arrivée au pouvoir les cartels, groupements criminels opérant de part et d’autre de la frontière, comme organisations terroristes, il s’octroie dès lors des pouvoirs considérables, comme la création de tribunaux spéciaux ou l’ouverture de centres de rétention n’obéissant pas au droit commun ; les geôles de Guantanamo Bay utilisées par George W. Bush sont réaffectées à un autre axe du mal, celui du commerce de stupéfiants, de la traite d’êtres humains, du trafic d’organes.
La présidence de Trump n’aura rien de traditionnel, même si le républicain a toujours eu une vision très large du pouvoir présidentiel. Au cours de son mandat, il estimait que la Constitution lui permettait de réaliser ce qu’il voulait. Après sa présidence, il a suggéré d’abroger la Constitution afin de destituer Joe Biden et de reprendre immédiatement le pouvoir. Bien sûr, l’équilibre des trois pouvoirs est toujours une réalité en Amérique. Mais Trump, version deux, celui pour qui Elon Musk a tweeté sur son réseau « Le retour du Roi » quand le compte du président républicain a été réactivé sur X, à la différence d’autres chefs d’État américain accusés eux aussi de dérive monarchique, comme Lincoln ou Jackson, aime ces comparaisons et en joue. Roi populiste, il signe ses décrets devant ses partisans, à la Capital One Arena, comme s’il avait délocalisé le Bureau ovale. Il présente à la foule et met en scène sa famille comme s’il s’agissait d’une dynastie régnante. Confronté dès les premières heures de son second mandat à des juges fédéraux bien décidés à ce qu’il ne s’attribue pas tous les pouvoirs, Donald Trump est déjà en train de tester toutes les limites de son autorité, les repoussant en voulant nettoyer un « État profond », composé d’ennemis du peuple, d’élites qui, selon lui, détiennent illégitimement le vrai pouvoir décisionnaire. Il rêve d’abroger le 22e amendement limitant à deux mandats de quatre ans, consécutifs ou non, le temps passé à la tête de l’État, répétant, pas toujours sur le ton de la plaisanterie, qu’il se verrait bien se représenter en 2028. Toujours ce temps politique américain trop court pour réformer en profondeur et toujours ce besoin, chez Donald Trump, de réaliser rapidement, d’obtenir des résultats concrets, quitte à être le président le plus inorthodoxe qu’a connu l’histoire des États-Unis.
[1] Herbert Hoover, président républicain de 1929 à 1933. Franklin D. Roosevelt, président démocrate de 1933 à 1945.