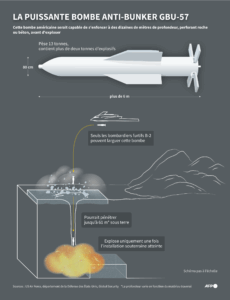Le général Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre, veut « hausser le niveau d’exigence de la préparation opérationnelle pour forger des hommes capables de combattre jusque dans les champs les plus durs de la conflictualité ». Cette prise en compte des évolutions de la guerre oblige à adapter la stratégie et donc la formation des soldats et des officiers.
Le monde n’a sans doute jamais été aussi volatile et imprévisible depuis la fin de la guerre froide. Certains états-majors en tirent des leçons pour leur fonctionnement, et c’est le cas, en France, de l’armée de terre. Le général Thierry Burkhard avait manifestement réfléchi depuis longtemps à une vision stratégique, qu’il a finalement partagée plus tard que prévu, du fait du Covid-19 (à l’origine, un événement massif était envisagé dans les camps de Champagne, avec l’armée de terre).
Ce constat d’imprévisibilité du monde et de la mission qui en découle, et donc du besoin de préparation à tout ou presque, est symptomatique d’une culture légion, dont est issu le chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT). Celui-ci a commencé sa vie militaire au 2e régiment étranger de parachutistes, déployé comme commando parachutiste (CRAP) durant la guerre du Golfe. Puis le reste de sa vie a été dédiée principalement aux opérations, au niveau tactique, opératif et stratégique. Thierry Burkhard a servi aux côtés du général Étienne Lecerf (alors commandant de l’opération Licorne), comme assistant militaire, mais aussi au Centre de planifications et de conduite des opérations (CPCO) de l’état-major des armées à deux reprises, comme traitant puis comme chef. Il a aussi pu approfondir sa culture du renseignement comme adjoint du coordinateur national du renseignement (CNR).
De armées enfermées dans un excès de normes
L’univers des règles et des normes, construites par la superstructure, ainsi que l’armée de terre elle-même ont contribué à réduire le train de marche et parfois à se lier les mains. Le CEMAT avait déjà interpellé les parlementaires il y a quelques mois sur ce sujet évoquant des « armées enfermées dans un excès de normes ». Les exemples sont multiples. Les règles sur les champs de tir, pourtant l’un des lieux d’entraînement les plus courants, sont très contraignantes. Ce qui n’empêche pas les accidents. Les communications sont compliquées. Seule une minorité de personnels est reliée à l’intranet défense. Dans un régiment, seuls les chefs de section et les officiers plus gradés y ont accès. La diffusion de l’information en souffre, mais également la capacité qu’on les militaires pour régler leurs tâches administratives et logistiques (commandes d’effets, permissions, etc.). Ce temps perdu et ce manque d’efficacité provoquent une baisse de rendement : les soldats ont moins de temps pour leur cœur de métier, c’est-à-dire l’entraînement, et sont parfois noyés sous les tâches indues. Or seul cet entraînement, qui forme le « fond de sac », permet aux militaires de pouvoir traiter la faible comme la haute intensité. À cet égard, le général Burkhard estime que cet entraînement doit être plus réaliste encore, car des conflits de haute intensité que la France n’a plus connus depuis la Seconde Guerre mondiale ne sont pas à exclure. Et si l’armée de terre est en pointe sur la simulation, tout ne se prépare pas dans les mondes virtuels.
A lire aussi : Robotisation du champ de bataille : défis, enjeux et risques
Un manque de stocks et de munitions
Cette remobilisation ne s’envisage pas que sous l’angle de l’entraînement, mais aussi en termes de stocks et de soutiens. On l’a bien vu lors du Covid-19, le système qui a fait confiance à l’externalisation peut être paralysé. La capacité de résilience des armées et de continuité des missions, dans un environnement très dégradé, doit donc être réel. Tout comme les stocks doivent prendre en compte de très fortes consommations de munitions. Or ces stocks ont été réduits à la portion congrue depuis la fin de la guerre froide. Certains restent homéopathiques, alors même que la complexité des armes amène désormais des cycles de fabrication bien plus longs (et des coûts bien plus élevés) que celles qu’elles ont remplacées. Combien de temps durerait le stock de missiles moyenne portée (MMP) dans un conflit conventionnel de haute intensité ? Seulement 1 750 ont été livrés entre 2018 et 2025. À comparer aux dizaines de milliers de Hot et Milan dont l’armée de terre bénéficiait pendant la guerre froide pour « casser du tank » russe devant déboucher de la trouée de Fulda. Le nombre de canons est également très bas. Certes, c’est une arme parfois jugée ancienne, et d’ailleurs rarement plus d’une demi-douzaine ont été déployés sur chaque théâtre au Levant et au Sahel. Toutefois, c’est une arme difficile à détecter et à contrer. En outre, les progrès réalisés dans le positionnement de la pièce et les fusées de guidage et d’effets en font une arme particulièrement efficace. Y compris sur la psychologie de l’adversaire.
Le travail en interallié reste plus que jamais nécessaire, ce qui nécessite une bonne connaissance de l’autre, mais aussi des modes opératoires communs, avec les canaux de communication idoines. À cet égard, les nouveaux systèmes d’information et de communication (SIC) doivent être capables de se parler, à tous les niveaux des opérations. Des matériels communs sont évidemment facilitants : c’est le cas avec la capacité motorisée (CAMO) belge, qui, à partir de 2025, équipera le pays des mêmes Griffon et Jaguar que la France. L’interopérabilité pourra donc être très poussée.
Le CEMAT a aussi glissé dans sa vision une place pour les réserves. C’est une force qui permet à la fois d’absorber les pics d’engagements, que ce soit en opération intérieure ou extérieure, mais aussi de faire autrement si le réservoir s’enrichit : c’est manifestement un axe majeur de la vision. La réserve pourrait devenir plus « à la carte » afin de tenir compte des réalités locales de besoins (les troupes qui assurent la mission Sentinelle en Île-de-France viennent de la France entière, et les réservistes sont en nombre très réduit). La réserve se prête bien à la mission intérieure : elle nécessite moins de savoir-faire (contrôle du tir en milieu urbain, éventuellement corps-à-corps). Deux réservistes au moins (un terrien et un aviateur) ont été à l’origine d’autant d’ouvertures de feu sur des terroristes (Marseille, Orly) ces dernières années sans pour autant que la précision du tir ait eu à en souffrir.
Chaque nouvelle opération le démontre, il n’y a pas de savoir-faire en trop dans l’armée de terre : le cas du 2e dragons, 800 personnels spécialisés dans le NRBC, a montré toute son utilité avec le coronavirus et pourtant, il n’est pas rare d’entendre parfois une volonté de se séparer d’une telle compétence, au motif qu’elle ne sert pas tous les jours. Cette menace est souvent en première ligne sur un champ de bataille (Kosovo, Levant, etc.), il est donc utile pour la France de la maîtriser. L’armée de terre doit aussi compléter les « trous dans la raquette » dans certains domaines, par exemple le combat dans les champs immatériels. Cette spécialité a pris de l’importance ces dernières années, notamment à la suite des actions de Daech et des Russes en Ukraine. Un combat peut basculer par un adroit usage des médias sociaux (qui ont insufflé la peur du combattant de Daech dans les armées irakiennes, qui ont déguerpi à son arrivée en 2014) et même de SMS (la Russie a ainsi injecté dans les téléphones portables de soldats irakiens l’envie de ne plus combattre) ! Ce ne sont que quelques exemples limitatifs, mais certains pionniers ont développé ce domaine alors naissant en France, notamment au CPCO. Le CEMAT veut développer cette filière à grande échelle, puisque chaque régiment devra avoir un référent et des correspondants du sujet dans chacune des unités. Tous les militaires doivent être formés au risque, d’autant plus qu’ils sont grands consommateurs d’internet et de réseaux. Et en parallèle, des spécialistes de la riposte, voire de l’attaque, doivent être préparés et aguerris. Ici ou là, certaines capacités existent, mais trop partielles, et avec des ressources humaines souvent inadaptées. Rapidement, l’armée de terre va devoir se mettre en ordre de marche pour ce nouveau type de combat.