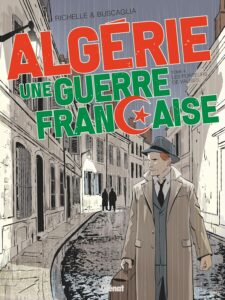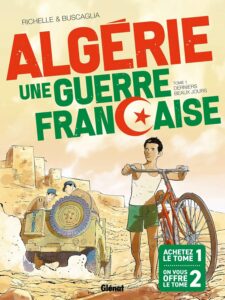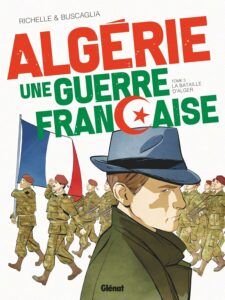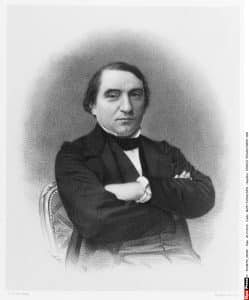Les éditions Glénat publient une série de BD consacrées à la guerre d’Algérie. Quatre tomes pour revisiter la complexité de cet affrontement.
Algérie – Une guerre française – tome 4 – Les porteurs de valises. Édition Glénat.
Ce quatrième volume de cette série que l’on pourrait rapprocher de celle que l’on a pu voir sur les écrans de télévision, « un village français », raconte avec nuance un épisode particulièrement sensible de cette guerre d’Algérie dont les cicatrices sont loin d’être effacées. Incontestablement le régime algérien qui s’est imposé depuis l’indépendance entretient une rente mémorielle, mais il convient de rappeler qu’il n’est pas le seul. L’instrumentalisation politique de la guerre d’Algérie peut rebondir à tout moment comme récemment à propos de la mauvaise volonté du gouvernement algérien pour reprendre ses ressortissants frappés d’OQTF.
Dans ce quatrième opus de cette série, nous retrouvons ce qui avait pu séduire au moment de la sortie du premier tome, à savoir la qualité du dessin et sa précision documentaire, dans le moindre détail du décor de cette histoire.
L’action se situe peu de temps après l’investiture du général de Gaulle comme dernier président du conseil de la IVe République, disposant des pleins pouvoirs et de la possibilité de proposer une nouvelle constitution. Les combats se poursuivent dans le djebel, mais c’est surtout la préparation du référendum du 28 septembre 1958 qui pose question. Dans le même temps, de jeunes militants se sont engagés dans le soutien actif au FLN, qui ouvre d’ailleurs un deuxième front en métropole avec des attentats. La stratégie du mouvement vise à susciter une réaction brutale de la population française contre la communauté immigrée, afin de ressouder les rangs ébranlés par les actions des armées françaises sur le théâtre algérien. Lors du référendum la population algérienne qui peut voter pour la première fois à l’égalité avec les Français ne tient pas compte de l’appel au boycott du FLN. Les prises de position du général de Gaulle suscitent d’ailleurs l’opposition du colonat qui rentre dans une logique de radicalisation dont les petits blancs paieront le prix.
La trame historique se superpose au destin individuel de personnages de fiction qui ne sont pas de simples symboles des prises de position de cette époque. L’un des personnages déjà présent dans le premier opus se retrouve impliqué dans ce que l’on a appelé la bleuïte, c’est-à-dire la dénonciation par des anonymes des acteurs actifs du FLN.
Un personnage féminin, Julia, est très clairement engagé dans le réseau des porteurs de valise qui soutient le FLN en lui permettant de transférer vers l’Allemagne l’argent collecté dans la communauté immigrée en France. Cet argent permet de financement des achats d’armement utilisé dans la guerre contre la France. La vie continue pourtant dans les domaines agricoles en Algérie même si l’inquiétude est directement palpable. Les Européens d’Algérie se retrouvent d’ailleurs piégés dans cette double logique qui consiste à vouloir rester dans leur pays natal, vivant parfois en harmonie avec une communauté musulmane qu’ils souhaitent pourtant continuer à dominer.
À lire aussi : L’Algérie doit plus à la France que la France à l’Algérie
Dans ce contexte, les déclarations du général de Gaulle à propos d’une éventuelle autodétermination de l’Algérie, à partir de 1959, suscitent énormément d’inquiétude. Le FLN entretient d’ailleurs un climat de violence aveugle contre des civils, contribuant ainsi à creuser un fossé entre les communautés.
Le récit montre que, dans cet affrontement, les positions ne sont pas forcément tranchées. Des Algériens manifestent leur volonté de conserver la présence française, tandis que des Européens d’Algérie ont parfaitement compris que le temps de la domination coloniale était terminé. Et c’est ce qui fait l’intérêt de cette série dont on attend le dernier album avec une certaine impatience.
Algérie, une guerre française – Tome 1, Derniers beaux jours
Philippe Richelle, Alfio Buscaglia
Glénat, 2019, 15,50 €
Ce n’est pas la première fois que la guerre d’Algérie, ou le contexte qui l’accompagne est mis en bandes dessinées.
Toutefois, ce premier tome, « Derniers beaux jours » est assez différent. Le scénariste qui est assez familier des histoires assez complexes, on se souvient notamment de la série « secrets bancaires », ainsi que « les mystères de la république », s’est véritablement immergé la période. On y retrouve incontestablement, notamment pour la constitution du comité révolutionnaire d’unité d’action, à l’origine du Front de libération national, quelques références au travail de Yves Courrière, et à son premier tome, les fils de la Toussaint.
On retrouve deux parties dans cet album, qui est d’ailleurs assez conséquent (76 pages) une série de trajectoires parallèles, avec des personnages emblématiques. Des enfants, fils de colons, et fils d’ouvriers agricoles musulmans que rien n’oppose véritablement, si ce n’est la marque de leur vélo. Leurs parents, fonctionnaires de l’État, colons, mais aussi ouvriers agricoles dépendants, vivent dans des univers différents qui se croisent parfois.
Une partie du scénario se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où la division d’infanterie algérienne est engagée dans la reconquête de l’Italie, du sud de la France, avant de parvenir en Allemagne. Dans cet affrontement, il n’y a pas de différence, cela a été plusieurs fois souligné, entre les soldats qu’ils soient « indigènes » ou européens. On notera toutefois que le commandement, même au niveau des officiers subalternes, reste clairement européen.
On s’attachera également à la trajectoire de cet instituteur, veuf, venu s’installer en Algérie avec sa fille Fiona, qui fait rêver évidemment ses copains de classe. Il raconte, à sa manière, les événements de Sétif dans le Constantinois en 1945, et la perception que les colons, mais aussi, une partie de la population algérienne ont pu en avoir.
En filigrane, avant que ne s’organisent les attentats du 1er novembre 1954, le lecteur découvre quelques signes avant-coureurs. Comme le hold-up de la poste d’Oran en 1950, avec, déjà, un certain Ahmed ben Bella, ancien sous-officier de l’armée française. Au moment où les attentats commencent, on trouve assez vite les lignes de force de ce conflit. Une population indigène qui reste dans un premier temps dans l’expectative, mais qui a bien compris que le statut de 1947, avec les deux collèges électoraux, relevait de ce que l’on appellerait aujourd’hui l’enfumage. Les autorités administratives locales, particulièrement réceptives à la pression des colons, truquent les élections, en toute impunité. Les grands noms de la colonisation sont d’ailleurs abordés, comme Borgeaud ou Schiaffani. Ici aussi on retrouve la référence de Yves Courrière. Les personnages attachant de Slimane, grand soldat, comme son père pour la Première Guerre mondiale, qui meurt de maladie à la prison de Barberousse, son petit frère Mohamed, brillant élève, mais ouvrier dans un garage, sont en quelque sorte les fils conducteurs de ce premier volume.
Les actions du 1er novembre 1954 suscitent une répression brutale, même si l’on aborde de façon implicite l’idée que le président du conseil, qui n’est autre que Pierre Mendès-France, pourrait envisager les réformes. On sait que celles-ci se heurteront au lobby colonial le 6 février 1955. Un an plus tard, jour pour jour c’est la journée des tomates, du 6 février 1956, qui conduira la gauche française à engager dans une guerre coloniale toute une génération de jeunes Français.
Le dessin de Buscaglia s’appuie sur une recherche documentaire particulièrement soignée, la mise en couleur traduit bien ces paysages d’Afrique du Nord, écrasés de soleil, tandis que dans les intérieurs, on ressent cette fraîcheur savamment entretenue par tout un jeu de courants d’air comme seuls les Méditerranéens savent le faire.
À lire aussi : Algérie : la victoire taboue
Le réalisme et la précision du dessin permettent de s’immerger dans l’histoire. Et si le tome deux est à la hauteur du premier, on pourrait sans doute disposer d’une remarquable « histoire des événements d’Algérie », car au-delà de la guerre, que l’on qualifie ainsi depuis seulement 20 ans, c’est tout le contexte de cette période qui s’éclaire. Et au final, même si les historiens connaissent la fin, on se met à espérer pour des personnages attachants, comme une sorte de happy end.
Quand on écrit ces lignes au moment où la jeunesse algérienne, qui ne connaît pas vraiment sa propre histoire, en dehors du mythe entretenu par la propagande du parti unique, descend dans la rue pour crier son aspiration à une meilleure gouvernance, on se dit que peut-être cet ouvrage d’accès facile, mais que l’on peut quand même lire avec beaucoup d’attention, peut-être utile.
Cela n’est pas forcément négatif pour peut-être introduire sur un sujet qui suscite encore, notamment sur la rive nord de la Méditerranée, beaucoup de crispations, parfois instrumentalisées par les politiques, avec la nuance et la précision qui conviennent.
Algérie, une guerre française – Tome 2 L’Escalade fatale
Présentation de l’éditeur
- Rentré à Paris, André fréquente les milieux intellectuels et découvre comment le conflit algérien est perçu en métropole. Loulou, lui, combat les maquisards du FLN dans le massif des Aurès. C’est dans ce cadre qu’il est recruté par un officier des services secrets français et pratique, pour la première fois, la torture. De l’autre côté, Mo, devenu agent dormant du FLN, commence à intervenir indirectement pour des opérations d’attentat…
Après Les Mystères de la République, Philippe Richelle poursuit son exploration des méandres obscurs de l’histoire de France à travers cette série illustrée par Alfio Buscaglia. Algérie, une guerre française : un récit passionnant, grand public, nourri aux meilleures sources documentaires, qui permet de mieux comprendre ces années noires de notre passé récent dont on s’évertue à dissimuler les cicatrices pourtant indélébiles…
Algérie, une guerre française – Tome 3 – La bataille d’Alger
Présentation de l’éditeur
Plus rien ne peut arrêter l’escalade de la violence.
Algérie, hiver 1956. Selon certains, le conflit qui a démarré deux ans auparavant pourrait bientôt prendre fin, mais André reste dubitatif… Les violences ne s’atténuent pas. Pire, les attentats sont maintenant monnaie courante. Larbi Ben M’hidi, membre fondateur du FLN, suit tout ceci de près. Un matin, Amédée Froger est abattu en pleine rue et Alger s’embrase ! L’air y devient irrespirable entre le couvre-feu et l’omniprésence des paras. Bientôt, un mouvement de grève générale menace de paralyser tout le pays. Dans ce contexte houleux, Loulou est recruté par les hommes de Robert Lacoste pour tenter d’arrêter les meneurs. Une chasse à l’homme impressionnante va se mettre en place dans ce pays au bord de l’implosion… Le FLN vit-il ses dernières heures ?
Avec ce 3e opus Philippe Richelle et Alfio Buscaglia poursuivent leur exploration des méandres obscurs de l’histoire de l’Algérie. Une série passionnante, grand public, nourrie aux meilleures sources documentaires, qui permet de mieux comprendre ces années noires de notre passé récent dont on s’évertue à dissimuler les cicatrices pourtant indélébiles…
À lire aussi : Albert Camus et la guerre d’Algérie