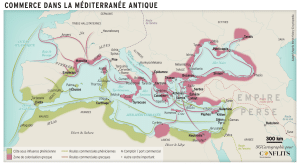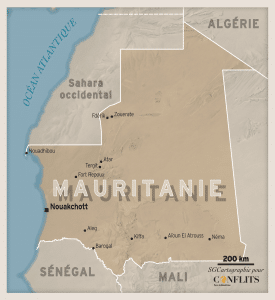Doté d’un territoire de près de 10 millions de km², soit le deuxième au monde en superficie après la Russie, le Canada bénéficie de trois immenses façades maritimes sur le Pacifique, l’Atlantique et l’océan Arctique, ce qui lui confère une importance considérable au plan géopolitique. Aux 4e et 5e places mondiales en termes de production de pétrole et de gaz naturel, le pays détient les gisements de terres rares (15,2 millions de tonnes) parmi les plus importants au monde.
Article paru dans le no56 – Trump renverse la table
Ce vaste pays partage avec les États-Unis la frontière la plus longue au monde entre deux États, soit 8 891 km. Mais avec seulement 41 millions d’habitants contre 341 millions d’Américains[1], une armée de 100 000 militaires d’active contre 1,29 million pour les forces armées américaines, un budget de défense de moins de 30 milliards de dollars contre près de 900 milliards de dollars pour les États-Unis, le contraste en termes de poids stratégique sur l’échiquier mondial est manifeste.
Outre cette asymétrie évidente, dès la guerre de la Révolution américaine, les États-Unis ont montré des velléités de domination vis-à-vis de leur voisin septentrional. En témoignent plusieurs tentatives d’annexion et la persistance de contentieux territoriaux[2]. Au vingtième siècle, le Canada, entraîné dans la Première Guerre mondiale, va cependant opérer un rapprochement avec les États-Unis. Les liens vont se renforcer pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide, jusqu’à donner lieu à un alignement quasi-total du pays sur la stratégie des États-Unis depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. À la suite de sa victoire lors des élections présidentielles de novembre 2024, Donald Trump a évoqué l’idée d’une annexion du Canada par les États-Unis. Lors de l’annonce de la démission du Premier ministre canadien Justin Trudeau, le 6 janvier 2025, il s’est dit en faveur de faire fusionner les deux pays : « si le Canada fusionnait avec les États-Unis, il n’y aurait pas de tarifs douaniers, les taxes diminueraient considérablement et ils seraient totalement à l’abri de la menace des navires russes et chinois qui les entourent constamment. Ensemble quelle grande nation ce serait !!! »[3].
L’encombrant voisin américain
L’ancien Premier ministre canadien Pierre Elliot Trudeau (père de Justin Trudeau), faisant référence aux relations avec les États-Unis, avait déclaré, lors d’un discours à Washington : « Être votre voisin, c’est comme dormir avec un éléphant : quelque douce et placide que soit la bête, on subit chacun de ses mouvements et de ses grognements »[4].
Dès le début de la guerre d’Indépendance des États-Unis, les troupes américaines envahissent le Québec et occupent Montréal (mai 1775-juin 1776). En 1812, le gouvernement américain déclare la guerre à la Grande-Bretagne et prépare une invasion du Canada. L’idéologie expansionniste de la Destinée manifeste (Manifest Destiny) en 1845 aggrave la tentation des États-Unis d’annexer l’ouest du pays. Les tensions s’accentuent pendant la guerre de Sécession.
À lire aussi : La guerre de Sécession : un conflit infini
En 1867, le Canada devient un dominion britannique : autonome en matière de politique intérieure, il demeure assujetti à la Couronne dans les domaines de la politique étrangère et de la défense. Le 4 août 1914, le pays est forcé de participer au conflit, la Grande-Bretagne ayant déclaré la guerre à l’Allemagne. Peuplé de seulement 7 millions d’habitants, le pays participe à l’effort de guerre avec plus de 700 000 soldats. La coopération avec les États-Unis (entrés en guerre en 1917) se renforce pour mobiliser hommes et ressources. Si l’identité du Canada en tant que nation va sortir renforcée de la guerre, le coût humain s’avère effroyable avec 63 000 soldats tués et 130 000 blessés.
L’après-guerre est marqué par l’autonomie progressive du Canada en matière de diplomatie, de défense et de sécurité. En 1931, le Statut de Westminster reconnaît la souveraineté externe de tous les dominions de l’Empire britannique. Tandis que les États-Unis mènent une politique isolationniste, le Canada s’affirme de plus en plus sur la scène internationale. Les forces canadiennes ne renoncent pas à élaborer des plans de défense contre toute tentative d’annexion américaine du pays. Cette défiance n’est pas complètement infondée. En 1941, le gouvernement canadien parviendra à repousser un projet américain d’intégration de la Colombie britannique dans un commandement militaire unifié sur la côte ouest en prévision d’une éventuelle attaque japonaise.
Le tournant de la Seconde Guerre mondiale
Le renforcement de la coopération militaire s’opère pendant la Seconde Guerre mondiale. Canadiens et Américains vont combattre ensemble à de nombreuses occasions. Plus de 1,1 million de soldats canadiens et terre-neuviens participent au conflit. 44 000 d’entre eux sont tués sur une population de 11,2 millions. Du côté des États-Unis (131 millions d’habitants en 1939), on déplore 416 000 tués.
En août 1940, le Premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King et le président américain Franklin D. Roosevelt, mettent sur pied une Commission permanente mixte de défense (Permanent Joint Board on Defence, PJBD), que viendra compléter en 1945 le Comité de coopération militaire. Lors de la conférence de Québec organisée par le Premier ministre canadien en août 1943, Roosevelt et Churchill planifient ensemble des opérations majeures qui vont sceller le sort de l’Europe et du monde.
L’alignement
Le Canada rejoint en 1948 le réseau secret d’échange automatique de renseignements entre les États-Unis et le Royaume-Uni, mis en place en 1943. L’Australie et la Nouvelle-Zélande lui emboiteront le pas en 1956, formant ainsi les Five Eyes. Il s’agit de surveiller l’Union soviétique ainsi que les mouvements anti-impérialistes dans le monde. Dès 1948, le gouvernement canadien se prononce en faveur d’une alliance transatlantique de sécurité collective. Le 4 avril 1949, le Canada devient l’un des douze membres fondateurs de l’OTAN. En 1951, des troupes canadiennes sont stationnées en France et en Allemagne de l’Ouest. À compter de 1963 jusqu’en 1984, les États-Unis déploient des armes nucléaires sur le territoire canadien. À ce jour, à l’exception de la guerre du Vietnam et de la deuxième guerre du Golfe, les forces armées canadiennes ont participé aux côtés des États-Unis à de nombreux conflits contemporains, tels que la guerre du Golfe (1991), la guerre du Kosovo ou la guerre d’Afghanistan. Devant les avancées soviétiques réalisées dans le domaine spatial, les États-Unis et le Canada mettent sur pied en 1958 le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (North American Aerospace Defense Command, NORAD), chargé de la surveillance et de la défense commune de l’espace aérospatial de l’Amérique du Nord et notamment du ciel de l’Arctique. Le Nord canadien accueille, à cette fin, depuis des décennies des stations radars du NORAD. Le NORAD ne fait pas partie de l’OTAN, même s’il en assure la protection du flanc ouest. Un accord de travail lie le Commandement des opérations interarmées du Canada, le United States Northern Command (USNORTHCOM) et le NORAD.
À lire aussi : Canada/États-Unis, Les enjeux d’une frontière, de Pierre-Alexandre Beylier
Depuis 2014, le Canada s’est engagé aux côtés des États-Unis pour soutenir l’Ukraine en augmentant la contribution canadienne à la présence avancée renforcée de l’OTAN dans les Pays baltes et en Pologne ; en lançant en 2015 la Mission UNIFIER d’entraînement des Forces armées canadiennes (FAC) en appui aux forces de sécurité ukrainiennes ; en octroyant une aide militaire et financière à l’effort de guerre ukrainien. Mais cet alignement implique d’appliquer des sanctions telles que la suspension de la Russie du Conseil de l’Arctique, ce qui, selon le spécialiste en études stratégiques, Frédéric Côté, pose un problème au Canada en raison de l’interdépendance des États dans cet espace situé à ses frontières[5].
L’alignement quasi-total du Canada sur la stratégie des États-Unis et la dépendance stratégique qui en a résulté ont entravé le développement des forces armées canadiennes. Si cette situation perdure, le Canada ne pourra plus prétendre qu’à un rôle de satellite de la puissance américaine et perdra toute marge de manœuvre face à son puissant voisin. En 2021, la non-participation du Canada, puissance du Pacifique, au nouvel accord AUKUS entre les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, a témoigné de ce risque de déclassement[6].
[1] https://www.census.gov/popclock/?os=__&ref=app
[2] Passage du Nord-Ouest (Arctique), Mer de Beaufort, Entrée Dixon, Détroit de Juan de Fuca, Iles San Juan, Ile Machias Seal et North Rock.
[3] « Le Canada devrait « fusionner » avec les États-Unis, répète Trump », Le Journal de Montréal, 6 janvier 2025.
[4]National Press Club, 25 mars 1969.
[5] Le Canada à l’aune de la guerre en Ukraine, Laval, PUL, 2024, p.4.
[6] « Trudeau assure que l’alliance Five Eyes est intacte », La Presse, 16 09 2021.