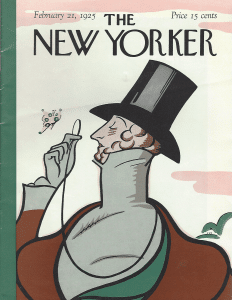« To keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down ». Une expression célèbre qui dit beaucoup des Anglais.
Article paru dans le N57 : Ukraine Le monde d’après
Encore une formule à laquelle l’anglais confère une densité difficile à rendre dans notre langue – la traduction pourrait être : « Garder l’Union soviétique à l’écart, les Américains impliqués et les Allemands soumis. » Elle résume les objectifs de l’Alliance atlantique selon son premier secrétaire général, lord Ismay, général anglais et ancien conseiller militaire de Churchill durant la Seconde Guerre mondiale[1]. Au lendemain de celle-ci, les nations d’Europe occidentale s’étaient coalisées pour prévenir la renaissance du danger allemand (pacte de Bruxelles, 1948), contrairement à ce qui s’était passé après 1919. Mais, comprenant que la menace principale était désormais plus à l’Est, elles avaient obtenu, là encore en rupture avec les années 1920 et 1930, un engagement américain sous la forme d’une alliance en temps de paix. Il s’agissait d’une rupture majeure dans la tradition diplomatique des États-Unis, car la pratique était formellement déconseillée par le « testament de Washington », cette lettre que le président fondateur avait laissée à son successeur en abandonnant le pouvoir après deux mandats (1797). Le Sénat avait d’ailleurs dû en valider la possibilité en 1948 à travers la résolution Vandenberg, qui devait conduire rapidement à la signature à Washington du traité de l’Atlantique Nord (avril 1949), rassemblant les États-Unis, le Canada et dix États européens.
Ce traité se définissait comme un pacte d’autodéfense, conforme donc à la charte des Nations unies. Il ne comporte aucune obligation militaire, envisageant seulement, par son article 5, une réponse solidaire à un acte d’agression, autorisant chaque partie à en déterminer la nature[2] – le Congrès américain étant seul habilité à déclarer la guerre, il était exclu de lui retirer cette prérogative ! Mais le maintien de troupes américaines en Europe et la mise en place d’une structure militaire commune, baptisée Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), dès 1950, assoient la garantie d’une intervention américaine, éventuellement, jusqu’à l’engagement des forces stratégiques (« parapluie nucléaire »).
Si les commandants des forces mises à disposition de l’OTAN sont des généraux américains, le secrétaire général de l’organisation est toujours un Européen ; lord Ismay le fut de 1952 à 1957.
Durant son mandat, l’organisation connut une inflexion majeure, en accueillant la République fédérale d’Allemagne (1955). Le réarmement allemand était voulu par les Américains, dans un contexte où les forces américaines étaient sollicitées en Asie (l’intervention en Corée commence en juillet 1950). Pour le rendre acceptable à des opinions encore traumatisées moins de dix ans après la fin de la guerre, la France avait proposé la Communauté européenne de défense, dont l’armée multinationale aurait été mise à disposition du commandement atlantique – il ne s’agissait donc pas d’une véritable armée européenne, en tout cas pas dans un sens autonome.
L’Assemblée nationale française écarta finalement la CED le 30 août 1954, sans débat de fond, car le projet était en butte à une coalition des deux extrêmes d’alors – les gaullistes et les communistes, tirant une part de leur légitimité du même mythe résistancialiste – mais aussi parce qu’il suscitait de plus en plus de réticences, notamment chez les militaires, certaines clauses restrictives risquant d’empêcher la réalisation d’une arme nucléaire nationale, alors dans les limbes.
À lire aussi : Mark Rutte, le bon élève de l’alliance atlantique
Finalement, la solution sera d’admettre The Germans in, comme aurait pu le dire Ismay, en renforçant l’Union de l’Europe occidentale et en mettant des unités allemandes à disposition des commandements atlantiques. En cette occasion, les Européens avaient compris deux choses : qu’il existait un risque de découplage américain et que, si le rapprochement franco-allemand était nécessaire à la pacification du continent, l’axe franco-britannique restait la pierre angulaire de sa défense contre les périls extérieurs. Soixante-dix ans plus tard, ils semblent le redécouvrir.
[1] Voir Conflits n° 54 (nov. 2024), p. 30.
[2] À ce jour, l’article 5 n’a été invoqué qu’une seule fois, à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Le président Trump, qui a le licenciement facile, devrait donc virer l’équipe qui lui prépare ses fiches. Ou en embaucher une !