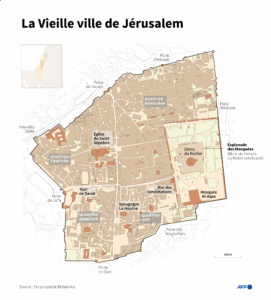L’Azerbaïdjan a financé la restauration d’une catacombe romaine, sous l’égide du Saint-Siège. Un signe de tolérance et de dialogue inter-religieux pour certains, un acte d’hypocrisie pour d’autres compte tenu de la situation des Arméniens au Karabakh.
À Rome, le 23 février 2016 est le jour de réouverture d’une catacombe paléochrétienne appelée « Saints Pierre et Marcellin » du nom des martyrs chrétiens qui y étaient enterrés. Un chantier de quatre années de restauration mené par l’Institut Pontifical d’Archéologie chrétienne se clôture. La catacombe est désormais rendue au public durant la première année jubilaire décrétée par le Pape François. À l’entrée du site, une plaque rappelle l’acte de générosité d’un mécène surprenant : la fondation Heydar Aliyev. Pour la première fois, une institution d’une nation musulmane chiite, issue d’une ex-République socialiste soviétique, contribue à la valorisation d’un monument chrétien.

Vue d’une fresque ornant un cubiculum, chambre funéraire de la catacombe. © https://www.santimarcellinoepietro.it/
Un patrimoine chrétien menacé de disparition
En Italie, les catacombes sont propriétés du Saint-Siège et placées sous sa tutelle directe. Ce sont d’anciennes carrières de tuf réinvesties en nécropole. Lors des persécutions des Ier-IVe siècles, les chrétiens qui n’avaient pas droit aux sépultures, enterraient leurs morts secrètement dans ces anciennes galeries abandonnées. À Rome, il en existe environ une soixantaine. Moins d’une dizaine sont ouvertes au public et les circuits de visite sont extrêmement limités par rapport aux kilomètres de galeries qui s’étagent sur plusieurs niveaux. Le site de « Saints Pierre et Marcellin », le long de l’ancienne voie romaine Labicana, à trois kilomètres des remparts de Rome, est surtout connu pour abriter une antique sépulture impériale. Constantin (274-337) a élevé ici un mausolée à sa mère Hélène. Celle qui a joué un rôle fondamental dans la conversion de l’empereur au christianisme repose au-dessus de la catacombe.
Malheureusement, ce patrimoine est difficile à préserver. Les contraintes du milieu souterrain sont diverses : humidité, développement de champignons sur les couches picturales, dépôt calcaire, soulèvement et effondrement des fresques… Une restauration est nécessaire à chaque génération. Aujourd’hui, le site archéologique fait partie de l’ensemble urbain de Tor Pignattara. La banlieue est de Rome, multiethnique, n’est pas franchement cléricale et présente un fort taux de criminalité. En répondant à l’urgence d’une restauration d’ampleur, le Vatican cherche à créer un pôle culturel attractif situé au cœur d’un quartier défavorisé.
La rénovation de la catacombe est l’occasion de révéler la valeur artistique et historique unique de ses fresques, exceptionnelles du point de vue de l’histoire de l’art. Les motifs picturaux témoignent de la composition multiethnique et multi-religieuse de la société romaine de la fin de l’Antiquité. Les figures reproduisent les passages de l’Ancien et du Nouveau Testament, privilégiant les épisodes du salut éternel. Dans l’art des catacombes de « Saints Pierre et Marcellin », l’on reconnaît aussi des signes, des images et des scènes d’un monde profane, encore lié à la culture religieuse de la tradition classique. La figure païenne d’Orphée revenu des Enfers par exemple, symbolise un Christ vainqueur de la mort. Son origine thrace est connue. D’aucuns sont allés jusqu’à supposer qu’Orphée était originaire de la mer Caspienne ! Un symbole opportun pour honorer un mécénat providentiel.
Les parrains de « Saints Pierre et Marcellin »
Ni européen, ni américain, mais bien caucasien : la fondation Heydar Aliyev est la seule à avoir répondu à l’appel pour venir au secours de « Saints Pierre et Marcellin ». Au siège du conseil pontifical pour la Culture, une convention a été signée entre la fondation Heydar Aliyev et la Commission pontificale d’archéologie sacrée. L’Azerbaïdjan s’est offert un partenariat culturel prestigieux, l’occasion pour l’autocratie de manifester doublement un message de soft power culturel : à l’Europe depuis la capitale de l’Italie, et au monde chrétien. Officiellement, cet accord entre le Saint-Siège et l’Azerbaïdjan est l’occasion de promouvoir le dialogue interculturel et religieux. Ce partenariat a pour visage celui de Madame Mehriban Aliyeva, épouse du président Ilham Aliyev, qui l’a nommée vice-présidente de la République. Sa fille Leyla Aliyeva, est la vice-présidente de la fondation.
Côté Vatican, c’est le cardinal Gianfranco Ravasi qui est l’interlocuteur privilégié en tant que président du conseil pontifical pour la culture (il le restera 15 ans). Bibliste et hébraïsant de renom, il prône le dialogue entre l’éthique laïque et la morale religieuse. Gianfranco Ravasi soutient une coopération qui contribue à l’échange interreligieux et interculturel dans l’esprit du pontificat du pape François. Mais cette acceptation d’un mécénat de la fondation azérie aurait surtout été incitée par l’urgence. Parce qu’il avait alerté en vain le monde chrétien de la menace d’effondrement de cette catacombe, Gianfranco Ravasi s’est tourné vers l’Azerbaïdjan. Deux pays que tout oppose se retrouvent sur le thème de la sauvegarde du patrimoine. Face à la mer Caspienne, l’Azerbaïdjan revendique une ouverture sur un espace d’échange commun comme pays ouvert sur les cultures et religions différentes. On y compte environ 500 communautés religieuses distinctes dans un pays d’à peine 9 millions d’habitants.
« Les catacombes du dialogue et de la tolérance » ?
2016 a été célébrée comme l’année du multiculturalisme pour la Fondation d’État, dont se fait écho le titre du dossier de presse sur l’ouverture du site : « Les catacombes du dialogue et de la tolérance ». L’Azerbaïdjan, dont le principe de laïcité est inscrit dans sa constitution, abrite une des communautés catholiques les plus petites du monde. C’est un des rares pays à la fois membres de l’organisation de la coopération islamique et du conseil européen.
Car ce mécénat a finalement trouvé son dénouement avec l’annexion du Haut-Karabagh quatre ans plus tard sur fond de conflit ethnique. La république autoproclamée du Haut-Karabagh a cristallisé les tensions ethnico-religieuses depuis des décennies entre l’Azerbaïdjan et le voisin arménien. Non reconnue par la communauté internationale, l’ancienne région autonome comptait une population d’environ 145 000 habitants en majorité arméniens (94%), vivant sur leurs terres historiques. Depuis son annexion en novembre 2023, la politique azerbaïdjanaise entreprend une politique d’effacement culturel. Environ 1 456 monuments arméniens sont menacés, dont 161 monastères et églises, 345 pierres tombales historiques et 591 khatchkars, stèles en forme de croix propres à la foi arménienne. Premier pays chrétien en marge de l’Empire romain, l’Arménie accuse l’Azerbaïdjan de se livrer à une destruction systématique et organisée de son patrimoine afin d’effacer toute trace de sa présence dans la région.
Instrument des relations internationales, la culture est devenue une cible stratégique que ce soit dans un objectif de tolérance ou inversement, de réécriture historique. L’Azerbaïdjan, tout à ses projets d’annexion, a su endormir à travers le Vatican, la communauté internationale sur ses intentions. Saint-Pierre et Marcellin, contemporains de la conversion du peuple arménien au Christianisme et décapités sous l’empereur Dioclétien en 304, doivent se retourner dans leurs catacombes !