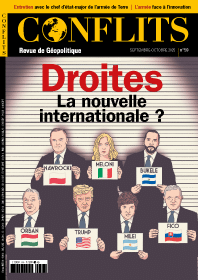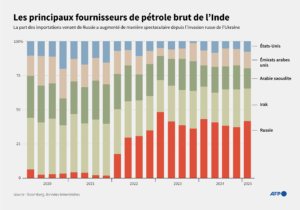L’annonce du partenariat entre la marque française Pimkie et le géant chinois Shein a suscité un tollé. Uniformisation, disparition des emplois, désertification des centres-villes : aucun reproche n’a été épargné aux deux enseignes. Shein s’est même vu menacé d’un moratoire et d’actions en justice. Pourtant, cet accord ne doit pas masquer les véritables raisons qui rendent nos artères commerçantes exsangues depuis une trentaine d’années.
Le procès intenté à Pimkie et Shein repose sur un réflexe commode : trouver des coupables tout désignés à la crise du commerce de proximité et à l’effondrement du textile français. Les fédérations professionnelles, les syndicats, la famille Mulliez – ancienne propriétaire de l’enseigne française – et même certains distributeurs concurrents ont sauté sur l’occasion. Dominique Schelcher, PDG de Système U, n’a pas hésité à parler de “collaboration avec le diable”. La Fédération du commerce et de la distribution a quant à elle dénoncé une “capitulation”. L’Europe, déjà vent debout contre l’expansion de Shein et Temu, s’agite pour exiger des mesures de rétorsion.
Pourtant, la réalité est moins manichéenne. La désertification des centres-villes, les faillites en cascade de commerces et la disparition de centaines de milliers d’emplois textiles n’ont pas attendu l’explosion de Shein. Depuis trente ans, le secteur s’effondre sous le poids des délocalisations, de la concurrence mondiale et d’un environnement économique qui pénalise lourdement les acteurs français : charges sociales massives, fiscalité étouffante, loyers exorbitants, urbanisme contraint, etc. À cela s’ajoute l’évolution des modes de consommation, accélérée par le numérique, le télétravail et les changements de mobilité. Pointer du doigt Pimkie et Shein revient à masquer cette vérité : si nos centres-villes se vident, c’est d’abord parce que la France a rendu le commerce de proximité économiquement invivable.
Un partenariat essentiel
Le partenariat entre Pimkie et Shein a été présenté comme une trahison, mais relève pourtant du simple pragmatisme. On peut ne pas aimer la marque asiatique, et il y a sans doute des raisons objectives à cela, mais doit-on pour autant reprocher à Pimkie, affaiblie par des années de pertes, de se chercher une planche de salut ? S’allier avec un acteur capable d’offrir une visibilité mondiale et une puissance logistique est une manière de rester en vie, ni plus ni moins. Et de continuer à employer au lieu de disparaître silencieusement, comme tant d’autres enseignes avant elle. Pimkie doit-elle s’excuser de chercher à survivre ?
On l’a dit, on peut bien sûr critiquer Shein, ses méthodes industrielles, ses conditions de production et son modèle hyper-consumériste. Mais réduire le problème du commerce français à un partenariat isolé est un contresens. Le vrai débat est ailleurs : comment faire en sorte que les commerces et enseignes locales survivent dans un marché mondialisé où la compétitivité se joue à chaque centime ? Comment réformer la fiscalité, les loyers, l’urbanisme et les contraintes réglementaires pour permettre aux commerçants d’exister sans subvention ni protectionnisme de façade ?
Car les chiffres sont implacables. Le textile français a perdu près de 400 000 emplois en trente ans : alors que l’Europe produisait 60 % de ses vêtements dans les années 1990, elle n’en fabrique plus que 3 % aujourd’hui. Le commerce de proximité n’est pas en meilleure posture. Entre 2010 et 2020, la France a vu disparaître 23 000 commerces indépendants dans ses centres-villes, selon la Banque des Territoires. Dans certaines villes moyennes, un local commercial sur quatre est vide. Chaque année, près de 6 000 boutiques ferment, victimes d’une équation insoluble entre charges sociales, fiscalité et loyers. Pendant ce temps, Shein, Temu ou Amazon captent la demande : en 2024, l’e-commerce a représenté 15 % de l’ensemble des ventes de détail en France, et Shein revendique déjà 23 millions de clients actifs dans l’Hexagone.
Ce n’est donc pas l’irruption d’un acteur chinois qui vide nos rues commerçantes, même s’il en profite, mais bien l’accumulation de contraintes internes qui rendent l’activité intenable. La Fédération du commerce et de la distribution évoque à juste titre la menace d’une “capitulation”. Mais ce n’est pas Pimkie qui capitule : c’est l’État français, qui refuse depuis des années de réformer son modèle pour donner à ses commerçants les moyens de se battre à armes égales.
Le scandale Pimkie–Shein, quoi qu’on en pense, a au moins une vertu : il met en lumière l’hypocrisie générale. D’un côté, on déplore la disparition des boutiques de centre-ville ; de l’autre, on laisse prospérer les coûts et les règles qui les étranglent. On dénonce le dumping étranger, mais on ne touche pas aux charges qui écrasent nos entrepreneurs. On s’indigne contre Shein, mais on ferme les yeux sur trente ans de délocalisations encouragées par nos propres choix économiques.
Il devient urgent de s’attaquer au cœur du problème : la France ne sait plus protéger ses commerces autrement qu’en désignant des coupables extérieurs. Tant que rien ne changera sur le fond, la prochaine enseigne à s’allier avec un géant étranger sera vouée au même procès médiatique. Et nos centres-villes, eux, continueront de se vider.