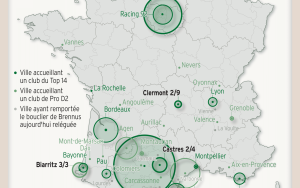Sous Louis XIV, les canons français affichent la devise : Ultima ratio regum – le dernier argument des rois. À partir de la Seconde Guerre mondiale, ce rôle d’arme ultime revient à l’aviation. Mais ce ne fut pas sans mécomptes ni désillusions.
Un article à retrouver dans le N60 de Conflits. Vatican. La puissance du temps long.
Comme toute arme nouvelle, l’aviation suscita bien des fantasmes. À peine la Première Guerre mondiale terminée, des théoriciens lui prédirent un rôle décisif dès le prochain conflit, où elle pourrait éviter les carnages terrestres en détruisant le potentiel économique et le moral des populations de l’ennemi, grâce à d’imposantes flottes de bombardiers lourds¹.
De Pointblank à la Black Week
Les nations anglo-saxonnes orientèrent très tôt leur flotte aérienne en ce sens. Avant même le déclenchement du conflit, les industries britanniques et américaines travaillaient sur des bombardiers bi ou quadrimoteurs à long rayon d’action. Par exemple, l’Avro Lancaster anglais ou le célèbre Boeing B17. Dès août 1941, les services de l’US Army – à laquelle l’aviation est encore rattachée sous la forme d’un Air Corps, puis d’une Air Force – fournissent à Roosevelt une estimation des moyens aériens nécessaires pour vaincre l’Allemagne nazie.
Les États-Unis ne sont alors pas encore en guerre². Juste après l’attaque sur Pearl Harbor (7 décembre 1941), la conférence Arcadie du 21 décembre, entre Roosevelt et Churchill, arrête les grandes lignes de la stratégie des Occidentaux pour vaincre : priorité à l’Allemagne, offensive amphibie depuis le Royaume-Uni et répartition des rôles dans la stratégie aérienne, entre attaques diurnes de précision pour les Américains et missions nocturnes « aveugles » pour les Britanniques. Début janvier 1942 est créée la 8e armée aérienne (AF pour Air Force) destinée à bombarder l’Europe depuis le Royaume-Uni ; elle mène sa première mission en Allemagne le 17 août.
Pourtant, les choix des États-Unis pour l’arme aérienne ne furent pas tous judicieux. La tactique initiale reposait sur des formations compactes de plusieurs dizaines de bombardiers, puissamment armés. Leur capacité à se protéger mutuellement rendrait les escortes de chasseurs superflues – ces derniers ayant de toute façon une autonomie bien trop limitée pour aller jusqu’au cœur du territoire ennemi. Cette illusion transparaît dans le surnom du B17 : la « forteresse volante », avec 10 à 12 mitrailleuses couvrant théoriquement tous les angles d’approche latéraux, supérieurs et inférieurs. Le général Arnold, chef de l’Air Corps en 1939, poussait pour cette stratégie qui était aussi, selon lui, la meilleure justification de l’autonomie future d’une armée de l’air. Inversement, il freinait le développement de chasseurs-bombardiers, qui pourraient appuyer des troupes au sol, fournissant ainsi un argument à l’armée de terre pour les conserver sous son contrôle.
Début 1943, la conférence de Casablanca confirme la stratégie de bombardement jour et nuit reposant sur la coopération anglo-américaine. De mars à juillet, la RAF entreprend une série de bombardements sur la région de la Ruhr, le principal pôle industriel de l’Allemagne occidentale – dont le célèbre raid des « briseurs de barrage ». En juin, la directive Pointblank fixe comme priorité de l’offensive aérienne l’attrition du potentiel de combat de la Luftwaffe, en ciblant particulièrement les usines de fabrication. Les Américains ont identifié comme installations critiques celles fournissant l’aluminium, le caoutchouc ou l’essence synthétiques et, surtout, les roulements à billes, dont 42 % de la production allemande provient de Schweinfurt, au nord de la Bavière. La 8e AF mène donc deux raids sur cette ville, le premier en août, le second le 14 octobre dans le cadre d’une série d’attaques connues ensuite sous le nom de Black Week. En effet, en dépit de résultats tangibles mais provisoires sur les usines visées, les pertes se révèlent terriblement lourdes – 60 bombardiers perdus en août, 77 en octobre, soit 26 % de la flotte d’assaut et 20 % des membres d’équipage.
Chiens de berger et nourrices
Il ne fut dès lors plus question de lancer de nouvelles attaques en profondeur sans faire escorter les bombardiers. Par chance, de nouveaux chiens de berger commençaient à équiper les unités de chasseurs alliées : le bimoteur Lockheed P38, le colossal Republic P47 et surtout le très racé North American P51. Déçus par les limites de ce dernier en haute altitude, les Anglais eurent la bonne idée de le remotoriser avec le légendaire Rolls Royce Merlin, équipant Hurricane et Spitfire, donnant naissance au P51B/C, que la RAF baptisa « Mustang ». Outre ses qualités de vitesse et de manœuvrabilité, le Mustang avait une autonomie exceptionnelle. Avec ses seuls réservoirs internes, il allait aussi loin que le P47 avec des réservoirs largables ; une fois doté de nourrices, il pouvait escorter les bombardiers³ jusqu’à Berlin (plus de 1 000 km), voire au-delà de Vienne (près de 1 400 km). Les premiers équipements de chasseurs américains en réservoirs largables sont réalisés à l’automne 1943, au moment où la 8e AF reçoit la mission de préparer l’opération baptisée Argument.
Si nombre d’aviateurs persistaient à penser que le bombardement stratégique finirait par ruiner la capacité de l’Allemagne à poursuivre la guerre, Arnold avait compris qu’il fallait aussi viser des objectifs à plus court terme, notamment dans la perspective du débarquement, prévu au premier semestre de 1944. Il nomma à la tête de la 8e AF un officier légendaire, qui partageait son analyse : le général James Doolittle, qui avait dirigé en avril 1942 le premier raid aérien, un peu insensé⁴, sur Tokyo. La planification de l’opération Argument prévoyait des attaques sur les principales usines aéronautiques du Reich, mais avec tout au long du parcours des escortes fournies ayant pour mission d’engager le plus possible les chasseurs allemands. Construire des avions ne leur servirait à rien s’ils n’avaient plus assez d’essence ou de pilotes pour s’en servir !
Pour atteindre cet objectif, un maximum de groupes de chasse dotés de P38, et surtout de P51, sont transférés à la 8e AF, qui compte en janvier 1944, 1 300 bombardiers lourds (environ 2/3 de B17, le reste en B24 Liberator) pour 1 400 équipages, avec plus de 2 300 appareils en cours d’approvisionnement pour combler les pertes, anticipées à 200 avions par jour. Le VIII FC (pour Fighter Command) qui lui est attaché, aligne quant à lui 1 250 chasseurs pour 1 140 pilotes, avec 2 500 avions de remplacement disponibles. Il ne manquait que quelques jours de beau temps pour pouvoir lancer la campagne. Le 18 février, la météo annonce un temps clair à partir du 20 – ce sera le premier jour de la Big Week.
La Luftwaffe n’a pas forcément été mieux inspirée dans ses choix stratégiques initiaux. Façonnée par Hermann Goering, un mégalomane incompétent malgré son passé de pilote, elle est conçue avant tout comme une force offensive. À ce titre, elle dispose d’un excellent chasseur de supériorité dès le début du conflit, avec le Messerschmitt Me 109 E, puis sa version F en 1940. En revanche, la défense du Reich n’est pas vraiment anticipée, puisqu’on espère que la Wehrmacht restera conquérante, et repose principalement sur la FLAK⁵, arme choyée par le régime, qui en 1943 reçoit encore la moitié des effectifs de la Luftwaffe, près d’un tiers des dépenses d’armement et 20 % des livraisons de munitions. Ses 1 400 batteries lourdes alignent plus de 8 400 pièces, dont plus des deux tiers sont les fameux canons de 88 mm.
Toutefois, leur efficacité s’érode, car, si le 88 porte en théorie jusqu’à 26 000 pieds⁶ (environ 9 000 m), sa précision diminue fortement passé 20 000. De plus, les contre-mesures alliées – essentiellement les bandelettes en aluminium Windows et des brouilleurs de radar – deviennent de plus en plus efficaces, car les Alliés ont capturé des radars embarqués sur des chasseurs allemands et adaptent leur riposte à leur fonctionnement. Alors que la FLAK revendiquait la moitié des avions alliés abattus en 1943, le pourcentage tombe à 10 % au début de 1944, où un calcul simple montre qu’il faut environ 4 000 obus pour abattre un seul bombardier allié !
“L’aviation devient une composante essentielle de la guerre”

Spitfire en action.
Le naufrage final de « Meier »
Il faut donc compter davantage sur les intercepteurs, dont l’inévitable Me 109, dans sa version G désormais⁷, qui s’avère toutefois un peu léger face aux B17 et difficile à piloter pour des novices – la pression alliée oblige à sans cesse raccourcir les temps de formation. Il est épaulé à partir de 1942 par le Focke-Wulf Fw 190A, moins agile, mais plus puissant. Le bimoteur Messerschmitt 110, dépassé dès 1940, trouve quant à lui une seconde jeunesse en devenant chasseur de nuit, puis destroyer aérien, une sorte de chasseur lourd chargé de faire éclater les box compactes de bombardiers, qui deviennent ainsi plus vulnérables aux attaques individuelles.
En 1943 est créé le Ier Jagdkorps, qui coiffe chasseurs diurnes et nocturnes. Sa dotation initiale est de plus de 500 monomoteurs. Mais, début février 1944, érodée par une série de bombardements nocturnes de la RAF, elle est tombée à 350 monomoteurs et une grosse centaine de bimoteurs (80 destroyers et seulement une cinquantaine de chasseurs de nuit). Les Anglais interviennent d’ailleurs encore aux premières heures du 20 février contre Leipzig, la principale cible du jour 1, avec 730 avions larguant 2 500 tonnes de bombes sans ciblage précis, avant tout pour compliquer la survie des habitants – dont le personnel des usines d’armement – et pour fatiguer la FLAK locale physiquement et matériellement (autant d’obus qui ne seront pas tirés contre le raid principal).
La 8e AF fut d’ailleurs loin d’être la seule à intervenir. Basée aussi au Royaume-Uni, la 9e AF contribua également par des attaques de diversion, notamment sur Berlin, un objectif éminemment sensible, d’autant que Goering avait déclaré au début du conflit : « Je veux bien être appelé Meier si une seule bombe tombe un jour sur Berlin »… Comme c’était arrivé dès l’été 1940⁸, les Berlinois et nombre de dirigeants nazis avaient bien sûr rebaptisé le Reichsminister de ce surnom péjoratif⁹, désignant une personne un peu simplette ! La 9e AF mena aussi des raids de bombardiers bimoteurs à basse altitude sur les défenses avancées telles que les stations radars et les aérodromes des Pays-Bas ou de Belgique, dont les avions pouvaient intercepter les bombardiers au début de leur pénétration ou sur le chemin de retour, où ils pouvaient cibler les appareils isolés ou déjà endommagés. Même la 15e AF, basée en Italie, devait intervenir contre des cibles au sud de l’Allemagne ou en Autriche, comptant sur la mobilisation de la défense allemande face au nord pour pallier l’absence d’escorte jusqu’aux objectifs.
Quel bilan ?
La météo contraria aussi les plans américains. Si les missions des 20 et 21 février se déroulèrent presque comme prévu et frappèrent le centre-nord de l’Allemagne (Hanovre, Saxe occidentale), la visibilité limitée sur certains objectifs réduisit leur efficacité, incitant à reprogrammer des attaques sur des cibles déjà traitées ou à délaisser les objectifs principaux au profit des subsidiaires. De son côté, la 15e AF ne put même pas franchir les Alpes à cause de nuages glaçants. Le 22, la majeure partie des attaques de la 8e AF est même annulée au dernier moment et seule la 15e AF, dans un ciel enfin dégagé, atteignit ses objectifs (Regensburg et diverses cibles en Yougoslavie). Les 23 et 24, la 15e AF renonce une nouvelle fois tandis que les escadres parties d’Angleterre attaquent des cibles en France. Le 25 enfin, dernier jour de cette Big Week, la 8e AF s’enfonce à nouveau loin vers le sud jusqu’à Augsburg, Stuttgart ou Regensburg. Parallèlement, la RAF continua toute la semaine ses attaques nocturnes plutôt dans l’ouest du pays (vallée rhénane, Ruhr) et c’est elle qui clôtura la campagne en bombardant une nouvelle fois, dans la nuit du 25 au 26, les usines Messerschmitt d’Augsburg. En mars, la 8e AF effectua quatre raids sur Berlin avant d’être affectée, à partir d’avril, à la préparation d’Overlord.
Le bilan de cette campagne a fait l’objet d’appréciations contrastées par les historiens. Ceux qui s’en tiennent aux objectifs industriels ont tendance à suivre les rapports des responsables allemands, qui minimisent le handicap subi par l’effort de guerre nazi. Sur les 16 usines désignées comme objectifs, 11 furent effectivement atteintes, dont 6 sérieusement endommagées, divisant par deux la production de chasseurs monomoteurs en mars et avril et d’un bon tiers celle des bimoteurs. Le niveau antérieur (2 000 appareils mensuels) ne sera retrouvé qu’en juillet. Cela peut sembler un résultat modeste pour près de 2 000 sorties et 5 000 tonnes de bombes larguées, et montre bien que l’anéantissement du potentiel industriel était illusoire – même les productions critiques pouvaient presque toutes être relocalisées ou obtenues depuis d’autres pays. Pourtant, l’essentiel est ailleurs.
Quand le temps le permettait, les trois escortes successives sur le trajet aller, puis au-dessus de la zone à bombarder, enfin pour le trajet retour, ont nettement limité les pertes : en plus de 3 300 sorties, la 8e AF n’a perdu que 137 appareils, soit 4 % de pertes, alors que la 15e AF, dont les missions étaient rarement escortées, et la RAF dans ses attaques nocturnes, perdaient respectivement 16 % et 6,6 % de leurs avions. Et surtout, la Luftwaffe s’est épuisée à riposter : si les 300 chasseurs perdus, dont 80 % de monomoteurs, pouvaient être remplacés en à peine dix jours de production du printemps, les 88 pilotes et 63 membres d’équipage de bimoteurs tués – sans parler des blessés, indisponibles à un moment clé de la guerre – le pouvaient plus difficilement, compte tenu des contraintes des programmes d’entraînement (instructeurs, avions, essence, météo…). Et ce résultat fut obtenu au prix de seulement une trentaine de chasseurs alliés perdus. À court terme, l’affaiblissement de la Jagdwaffe allait grandement faciliter la réussite du débarquement¹⁰ et, à long terme, le rapport de force avait définitivement basculé du côté des Alliés, techniquement et numériquement.
¹ C’est notamment la thèse du général italien Giulio Douhet dans un livre de 1921, Il Dominio dell’aria, (La Maîtrise de l’air).
² On remarque ainsi que l’effort de guerre américain, contrairement au premier conflit, commence bien avant leur engagement effectif. En 1941, portée notamment par la loi prêt-bail, votée en mars, l’industrie américaine produit plus de chars que n’importe quel belligérant et autant d’avions que toutes les nations de l’Axe réunies.
³ Ces données techniques confirment l’inanité du reproche parfois fait aux Alliés de ne pas avoir bombardé les camps d’extermination pour empêcher la Shoah : en dehors de la difficulté de localiser et d’atteindre ces objectifs peu étendus, seul le plus occidental, à Chelmno, était à portée des chasseurs d’escorte – mais pas avant début 1944.
⁴ Réalisé en pleine phase d’expansion japonaise dans le Pacifique et en mer de Chine, l’attaque fut conduite par 16 bombardiers moyens B25, lancés depuis le porte-avions Hornet, et gagnant ensuite la Chine.
⁵ Acronyme pour Flugzeug Abwehr Kanone : canons de défense (contre) avions, équivalent du français DCA.
⁶ Les aviateurs mesurent les altitudes en pieds, unité un peu plus fine que le mètre – il y a environ trois pieds dans un mètre. Les bombardiers américains volent en général entre 21 et 23 000 pieds pour les B24, et de 23 à 25 000 pieds pour les B17.
⁷ Sur 33 000 Me 109 construits, les différents dérivés de la version G en représentent les deux tiers.
⁸ Pour l’anecdote, le premier avion à bombarder Berlin fut un Farman de l’aéronavale française, le 7 juin 1940. Un raid plus conséquent fut organisé par la RAF le 28 août, en représailles d’un bombardement – accidentel – de Londres.
⁹ Ce ne fut que la première étape de la défiance croissante d’Hitler envers son compagnon d’arme : l’échec de la bataille d’Angleterre, la résistance obstinée de Malte, le fiasco du pont aérien sur Stalingrad, qui rendit inévitable la capitulation de l’armée de von Paulus, et la fréquence des bombardements alliés sur les grandes villes allemandes le firent mettre à l’écart des grandes décisions à partir de 1943, même s’il conserva officiellement son rang de successeur du Führer.
¹⁰ Le 6 juin 1944, la Luftwaffe ne put assurer que 300 sorties face aux… 15 000 alliées ! Quelques jours plus tard elle pouvait tout de même aligner 1 300 appareils.